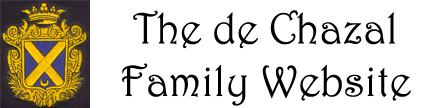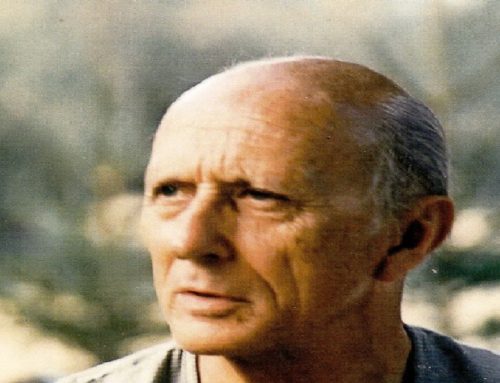Evenor de Chazal quitte Maurice en début d’année 1896 avec une partie de sa famille pour s’installer à Madagascar. Il débarque à Mananjary pour se rendre à Fianaranstoa, une ville à l’intérieur des terres à 30 jours de marche. A cette époque le seul moyen de locomotion est le filanzane, une chaise à porteurs. Voici sa description des préparatifs et du départ.
Evenor de Chazal quitte Maurice en début d’année 1896 avec une partie de sa famille pour s’installer à Madagascar. Il débarque à Mananjary pour se rendre à Fianaranstoa, une ville à l’intérieur des terres à 30 jours de marche. A cette époque le seul moyen de locomotion est le filanzane, une chaise à porteurs. Voici sa description des préparatifs et du départ.
DE MANANZARY A FIANARANTSOA
Les PREPARATIFS
Dès le lendemain nous faisons une première expédition de bagages, une seconde suit le samedi, et nous-mêmes nous partirons dimanche.
On ne saurait apporter trop de soins à la préparation d’un voyage qui doit durer plusieurs jours, pendant lesquels on sera complètement isolé du monde civilisé, sans communication aucune avec ses semblables, sans ressources, à la merci du moindre accident. Le filanzane doit d’abord attirer l’attention, car la commodité du transport dépendra du choix que l’on aura fait. Or il n’y a pas de filanzane à Mananzary, ceux qu’on y trouve appartiennent à des particuliers, qui d’ailleurs se font un véritable plaisir de les prêter. Mais il ne faut abuser de la générosité de personne.
Quand je suis passé par Tamatave je n’en ai trouvé que deux à vendre, je les ai pris, espérant en trouver d’autres sur les lieux. J’ai acheté un troisième d’un missionnaire Scandinave qui venait d’arriver avec sa femme et se préparait à se rendre par mer à Fort-Dauphin. On m’a prêté les autres.
Le filanzane, ou fitacon, se compose essentiellement de deux pièces de bois, de 3 mètres de long environ, formant brancards. Ils sont reliés au milieu par un siège de toile formant dossier, et 2 petites barres de fer transversales, celle de devant soutenant des cordelettes qui supportent une planchette mobile sur laquelle reposent les pieds. Cet appareil si simple et très léger se prête à tous les caprices de la marche et forme un fauteuil très commode.
Les barres sont séparées de la largeur du corps. Tous les filanzanes ne sont pas de la même largeur. Il est indispensable de les essayer avant de les acheter. On est balloté dans un filanzane trop large et les os des hanches se ressentent d’un séjour prolongé dans un autre qui serait trop étroit.
Un bon parapluie, une toile cirée pour les jambes, un pardessus en caoutchouc, complètent l’accoutrement. Les porteurs refuseraient de vous laisser emporter autre chose. C’est tout au plus s’ils ont consenti à me laisser attacher à l’un des brancards un petit sac de rabanne pour y mettre ma pipe et mon tabac et se sont formellement opposés à ce que j’y mette quelques cartouches.
Les filanzanes sont prêts, nous allons partir. Voici l’ordre de marche. Mes deux garçons de 13 et 15 ans. Ils ont chacun quatre porteurs. Puis viennent les jeunes filles avec six bourjanes chacune, dont deux de relais ; enfin, avec huit bourjanes dont quatre de relais à chaque fauteuil, la « nurse » avec son bébé, dans le filanzane double (acheté au ministre norvégien). Ma femme et moi formons l’arrière-garde, sxoit en tout sept fauteuils et quarante-quatre bourjanes. Vingt porteurs de provisions nous accompagnent avec la literie et les provisions de bouche pour la route. C’est dans cet ordre que nous partons et que nous arriverons sans encombre, s’il plaît à Dieu.
On a diversement parlé des bourjanes, du prix qu’ils demandent et du poids qu’ils portent, je crois nécessaire d’en dire un mot. Le bourjane ne constitue pas, comme on serait porté à le croire, une race à part. Bourjane veut simplement dire homme libre. Il ne doit pas la corvée. Il veut aussi dire porteur. Un Betsileo ou un Betsimesaraka est bourjane s’il porte des paquets ou des voyageurs. Mais il ne l’est pas s’il est pasteur ou cultivateur. Un Antemoor (sic) ou un Sakalave le serait aussi s’il faisait le même service, mais il ne le fait ordinairement pas. On confond assez facilement Betsimesaraka et Betsileo avec Bourjane, parce que ce sont eux qui font le plus ordinairement ce pénible service de porteurs, si rude et si peu rétribué, sur toute autre route que celle de la capitale.
À l’heure où j’écris, il est impossible de se procurer un bourjane pour se rendre de Tamatave à Tananarive et réciproquement, à moins de 15 F à 20 F pour le voyage. Cela devient coûteux quand on songe qu’il ne faut pas moins de huit à douze porteurs par fauteuil, indépendamment de ceux qui portent les effets personnels du voyageur. Cet enchérissement provient principalement du grand mouvement commercial qui existe entre les deux villes et du ravitaillement du corps d’expédition. Au Betsileo, il n’en est pas de même. Les voyageurs sont rares, rares les communications. Le bourjane est encore à un prix raisonnable. Il n’en sera pas longtemps de même. L’attention se porte sur Fianarantsoa. Dans un an, les prix auront doublé, les voyageurs aidant. Avant le passage du résident, on payait $1.25 le bourjane. J’ai payé $1 de plus, et le mois prochain celui qui me suivra paiera davantage. J’ai payé mes bourjanes, aussi bien les porteurs d’effets que les porteurs de fauteuils à raison de $1.50 par homme pour le voyage.
Ici l’on parle en piastres. La piastre est représentée par la grosse pièce d’argent français de Fr. 5, elle est subdivisée en morceaux coupés. La moitié d’une pièce de Fr. 5 s’appelle louch et représente Fr. 2,50, le quart kiroube = Fr. 1,25 ; un cigaz vaut 12 sous ou 60 centimes, un rouvouamar 8 sous ou 40 centimes, un vouamar 4 sous ou 20 centimes, et ainsi de suite jusqu’au grain de cascavelle qui vaut un sou ou 5 centimes. Chacun doit avoir sa balance, un petit trébuchet semblable à celui que chacun de nous a dans sa pharmacie de famille à Maurice pour peser le calomel ou la quinine, avec des poids appropriés. C’est un souci. Il faut s’y faire.
Je pèse déjà très proprement et « cause kiroube » ou « ilavouamartout » comme un vieux malgache. Les prix faits, il faut déterminer le nombre de bourjanes pour chaque fauteuil. Ce sont des discussions interminables. Le bourjane ne connaît pas la valeur du temps, pour un centime, il discutera une heure ! Nous avons vu plus haut comment les choses ont été arrangées, mais ce n’a pas été sans peine. Tout au long de la route, le bourjane se plaindra, et du poids et du peu qu’il gagne, espérant toujours tirer quelque chose du Vazaha. Le plus souvent il réussira. Peu de métiers sont plus pénibles.
Songez que pour ce faible prix de $1,50 (ou F. 7,50), il va porter pendant huit jours sur ses épaules des poids énormes, par des chemins à peine tracés, traversant marais et rivières, souvent dans l’eau jusqu’à la ceinture, haletant dans la montée, soufflant dans la descente, changeant souvent d’épaule, mais toujours sous le harnais. Il ne se doute pas de l’intérêt qu’il inspire et il est heureux quand il attrape un cigare ou un morceau de pain.
Le prix de $1,50 est donc uniforme, mais le poids à porter varie. Il dépend de la grandeur et du volume de la marchandise. Pour les filanzanes qui sont toujours portés à 4 sur l’épaule, j’ai dit que j’avais 8 porteurs, soit deux bandes de bourjanes se relayant, et ils se relaient souvent, tous les cent pas en terre plate, tous les cinquante pas en montée ou en descente difficile. Dans certains passages dangereux, ils s’attellent tous les huit ensemble à la chaise.
Le changement d’épaule se fait sans arrêt, d’un mouvement brusque, en même temps, dans la descente la plus rapide, souvent en courant, leur adresse est merveilleuse, jamais un faux pas, jamais une chute. Ces hommes sont de fer !
Quant aux porteurs d’effets, il y a ceux qui accompagnent le voyageur et qui doivent être rendus en même temps que lui aux stations d’arrêt, soit pour le déjeuner, soit pour coucher, et ceux que l’on ne revoit plus qu’à destination et dont on n’a pas besoin en route. Les premiers doivent être légèrement chargés, 25 à 30 livres au plus. Ils suivent ou précèdent les fauteuils et il est rare qu’ils ne soient pas en même temps que vous au village désigné pour le repas. Les autres peuvent porter jusqu’à 80 livres, mais ils mettent plus de temps à faire la route ; on ne les voit qu’à destination, où ils arrivent souvent malgré tout, presque en même temps que vous, bien qu’il ne soit pas rare qu’ils y arrivent 15 à 20 jours après.
Quand un bourjane porte 80 livres à lui tout seul, il faut que la charge soit divisée en deux paquets de 40 livres chacun. Il les porte sur l’épaule attachés au bout d’un bambou, comme les Chinois à Maurice. Si le paquet est encombrant, il le porte à deux, quelquefois à quatre. Une de mes malles pesait 160 livres et c’est une des premières arrivées. Elle était portée à quatre. Il eut été avantageux d’en faire 4 petits paquets de 40 livres que deux hommes auraient pu porter. Ainsi plus un bagage est volumineux, plus il demande de porteurs. On m’a raconté qu’un personnage pieux et généreux avait fait présent d’un piano à une des missions, et qu’il avait fallu 120 hommes, et une année, pour le porter. Ce qui étonne après que l’on a fait connaissance avec la grande route de Fianarantsoa, c’est que même avec 120 hommes on ait pu faire arriver un piano au bout d’une année.
Enfin les bagages sont prêts après les discussions que l’on sait. Chacun a son affaire et l’on peut être tranquille. Tranquille, je le suis sans doute, mais l’est-on toujours complètement, quand on sait que parmi ces bagages, il y a un simple panier de corvée, venu de Maurice, qui contient Fr. 5 000 en pièces de 5 francs. L’aurais-je toujours sous les yeux ? Quelle tentation pour le malheureux qui le porte !
Que dites-vous donc de mes bourjanes ? Des hommes que je n’ai jamais vus, dont je ne connais ni la langue ni les noms, que personne ne songe à garantir, qui s’emparent un beau matin d’un panier dont ils connaissent le contenu, qui le portent pendant 8 jours à travers monts et vallées, qui le déposent le soir dans quelque case enfumée, le reprennent et finissent par vous le rendre intact au bout de 8 jours, alors qu’il leur eut été si facile de dire qu’il était tombé au fond de la rivière, ou même de ne rien dire du tout, et de filer avec, s’assurant ainsi une existence facile pour le reste de leurs jours. Quel juge de paix pour les condamner ? Quel gendarme pour les poursuivre ?
DEPART
Dimanche 16 février, 15 heures. La pirogue est prête. C’est en pirogue que nous allons faire la première partie de notre voyage. Nous devons coucher à Sciatouche où nous trouverons nos filanzanes, qui nous attendent depuis le matin. J’embrasse mon garçon qui reste pour expédier les bagages au fur et à mesure de leur arrivée, je serre la main aux quelques amis qui nous ont accompagnés sur la berge, et… En route pour l’inconnu !
Ce n’est pas sans alarme que je me lance ainsi avec femme et enfants sur cette terre barbare, bien que, comme le présidentCleveland dans l’affaire du Venezuela, je connaisse la valeur de mes actes et que je sois prêt à en porter la responsabilité. Au cours d’une conversation que j’ai eu la veille avec le missionnaire Scandinave qui m’a vendu le filanzane double, je lui ai demandé en quel état était la route « Simply frightful » m’avait-il répondu. Cette réponse me laissait rêveur, nous allions bientôt en faire la triste expérience.
Pour commencer, c’était charmant. Le fleuve roulait majestueusement ses eaux vers la mer entre deux rives plates et boisées. Les pagayeurs, au nombre de huit à l’avant, pagayaient ferme en rasant la rive droite ; les points de vue changeaient, nous n’avions pas trop d’yeux pour regarder, mais je constatais, avec une certaine inquiétude, que le courant était encore fort et que nous avions peine à remonter. En se rétrécissant, le Mananzary devenait de plus en plus rapide, et le soleil baissait rapidement. Il a eu bientôt fait de disparaître, et la nuit se fait. C’est l’heure où les caïmans sortent. Que deviendrons-nous mon Dieu, si un faux coup de barre nous faisait chavirer ! Mon cœur se serre à la pensée que la vie de tant d’êtres chers tient à l’incapacité, ou à la faiblesse de la main qui gouverne. Les bateliers sont haletants, ils refusent d’avancer. Je crains d’être obligé de prendre terre et de passer la nuit sur cette terre inconnue. Ils finissent pourtant, à force de promesses, par se décider à avancer, et nous finissons tous ensemble, à notre tour, par arriver. Où ? À Isiarafatra. Retenez bien ce nom, lecteur, et que le ciel vous garde d’y arriver un soir de pluie à 10 heures, sans vous être fait annoncer et sans avoir donné des ordres pour votre dîner.
Des caïmans nous attendaient au débarcadère. Leur présence se révèle par une forte odeur de musc, on fait du bruit, on les éloigne, et le débarquement se fait à la lumière tremblotante d’une bougie. La terre est grasse, nous nous y enfonçons jusqu’à la cheville. On monte, on monte toujours la berge glissante et escarpée, puis on arrive sous des manguiers que nous distinguons confusément dans l’ombre. Au bout de trois quarts d’heure environ de cette pénible marche, le guide nous annonce que nous sommes arrivés.
Quelle détresse ! Une case, sale entre toutes, dont nous ne pouvons heureusement pas distinguer toute la lamentable charpente à cause de l’obscurité, nous offre son plancher branlant, ses nattes crasseuses, et son toit vermoulu, par où va bientôt passer la pluie qui a repris de plus belle. Il faut cependant manger, nous mourrons de faim. Heureusement que Monsieur Henderson, le deus ex machina que le ciel a placé sur notre chemin à Mananzary, a pris la précaution de mettre trois grosses miches de pain et deux volailles froides dans notre panier. Chacun de nous se coupe une grosse tranche, et une première miche a bientôt disparu. Il n’en reste que deux, et nous avons 5 à 6 jours de route à faire. Il va falloir être prudent et ménager ce qui nous reste.
On étend les matelas, et à minuit au sommeil. Le sommeil ! Il n’en est pas question ! L’eau coule du toit de toutes parts. On change les matelas de place, mais personne ne peut dormir.
Pour comble de malheur, il y a des cochons et des canards sous la maison. Les uns grognent, les autres couaquent, c’est un tapage infernal. Puis nous sommes envahis par les fourmis. On allume l’unique bougie. C’est une vraie fourmilière, on écrase ce qu’on peut, l’on se recouche. À quoi bon ? Il va falloir se lever et se mettre en route, il est 5 heures. Dourga, Baloolal, Boutman, allons, levez-vous, donnez de l’eau pour la toilette. Ou êtes-vous ? Oh ! Les gueux ! Mais où sont-ils ? Nos gaillards avaient trouvé à se réchauffer quelque part et s’étaient endormis. On se lève, on emballe et on appelle les bourjanes. Ou sont donc ceux-ci à leur tour ? Ils arrivent un à un, on les compte. Il en manque 7. Où les trouver ? Le boutman s’offre à aller les chercher à Sciatouche de l’autre cote du fleuve. Il part et revient à 9 heures avec 3 hommes seulement. Comment faire ? Cependant il faut partir à tout prix. Nous en trouverons d’autres en route. Partons, mais partons donc ! Je m’impatiente de tant de retards, mais suis impuissant à les supprimer.
Toute la population nous entoure. Évidemment, nous sommes un objet de curiosité pour eux. Un pauvre vieux s’avance, il a mal aux yeux et demande un remède. Je n’ai rien. Un autre a une plaie à la jambe, un troisième la fièvre. Tous me prennent pour un grand médecin et demandent un adoucissement à leurs maux, et rien, rien ! Quand je pense que j’ai toute une caisse de médicaments. 40 flacons de quinine, que tout cela est à bord du Columbus et que je n’ai pas eu la prévision de rien porter avec moi ! Mademoiselle M., l’institutrice que nous avons avec nous, voyant mon embarras, m’offre timidement, pour un homme qui a une fluxion, un flacon d’eau dentifrice. Dieu soit loué ! Voilà le remède trouvé. Ah ! Périndorge ! Vous n’avez jamais cru, en composant votre liqueur vermeille, combien de maux vous pouviez soulager avec l’eau dentifrice qui porte votre nom !
Vite, une tasse. J’y verse deux ou trois cuillerées à café de la liqueur bienfaisante et réparatrice que je mélange avec de l’eau du Mananzary. Les uns en boivent parce qu’ils toussent, les autres en pansent leurs plaies, tous s’en frottent, et je m’en vais faisant des heureux.
Jetons en passant, un coup d’œil sur cette case où nous venons de passer la nuit. Elle est sur pilotis, comme toutes celles qui l’entourent et comme toutes celles que nous rencontrerons sur cette route, élevée de 15 à 18 pouces au-dessus du sol. Je comprends, en l’examinant, les odeurs et le tapage de la nuit. Le dessous du plancher est en même temps poulailler, porcherie et le reste. Si maintenant vous vous figurez un plancher à jours, fait de lattes de raphia et recouvert d’une simple natte, et si par la pensée vous jetez un simple matelas bien mince dessus, il vous sera aisé de sentir, toujours par la pensée, heureusement pour vous, toutes les odeurs qui montent à votre nez de cette abomination de bêtes et de saletés ; Restons, en là pour aujourd’hui, nous trouverons bien autre chose dans la suite.
En route ! Nous voila partis. La terre est grasse, elle colle aux pieds. Des branches nous fouettent le visage. Le sentier est a peine trace. Nous longeons le fleuve jusqu’au prochain village, mais nous nous en éloignons, et nous ne tardons pas à le perdre de vue. Ce n’est que demain à pareille heure, que nous allons retrouver cette sale boîte à caïmans. Le site est beau, le soleil brûlant. J’ouvre mon parapluie, j’allume ma pipe, et je contemple le paysage qui fuit et les gens qui avancent. Pas un arbre, pays ondulé, dénudé, collines basses couvertes d’une herbe verte. On chercherait en vain l’ombre bienfaisante d’un arbre. Le Malgache, plus destructeur que l’Indien, a tout coupé, il a fait le désert autour de lui.
Le sentier monte, descend, s’allonge interminable, comme un grand serpent dans la vaste plaine. Le convoi en suit les sinuosités et s’arrête pour déjeuner à un village dont je tairai le nom, puisqu’il est encore plus long que le sentier. Deux heures de repos et nous reprenons notre route, sous un soleil de feu, jusqu’à Ambalafoutra, ou nous couchons. Le long des vallons se dresse, rigide, un curieux pandanande (pandanus) 20 à 25 mètres de hauteur, c’est le seul arbre que l’œil aperçoit. On l’a respecté parce qu’il n’est bon à rien. Son tronc est celui du vacoa, et sa tige terminale se compose d’une touffe de feuilles semblable à celle de nos vacoas. Le tronc, très droit, est couvert de feuilles cannelées, plus longues à la base du tronc qu’au sommet, ce qui lui donne un air de cône très pointu.