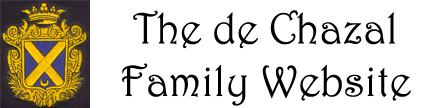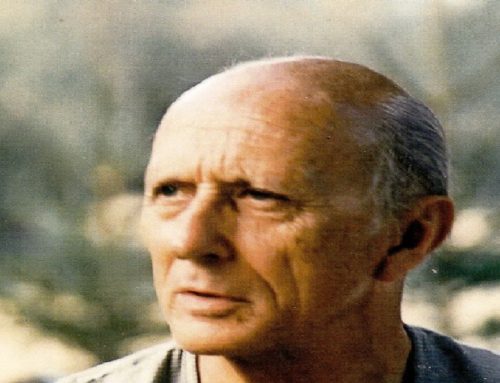Gaston Toulourge (1860) < Alice de Chazal (1839) < Furcy de Chazal (1810) < Toussaint de Chazal (1770) < Régis de Chazal (1735) < Noble aimé de Chazal (1706) < Jean-Baptiste Chazal (16..) < Jean II Chazal (16..) < Jean I Chazal ( 16..)
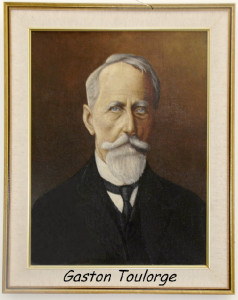 Journal de Gaston Toulorge
Journal de Gaston Toulorge
Jeudi 23 Février 1939
Ce matin, nous avons assisté en l’Eglise de N.D. du Rosaire, Quatre Bornes, à une messe dite par l’Abbé Guérin pour le repos de l’âme de Gabrielle. Il y a eu deux mois aujourd’hui de la mort de ma chère femme, survenue le 23 Décembre 1938 à 5½ heures du matin dans cette immense Maison de l’Avenue Hennessy que nous habitons depuis bientôt 9 ans.
Deux mois !… et pourtant c’était hier que la famille en larmes, agenouillée devant son lit de douleurs physiques et morales, suivait l’agonie de la douce créature du Bon Dieu, et attendait dans l’angoisse de la douleur, ce souffle dernier qui s’exhale d’une poitrine humaine pour faire comprendre aux témoins qui sont là que l’âme a quitté le corps mortel pour prendre son vol vers l’immortalité…
Mais on ne se sépare pas de la vie et des siens sans manifestation dernière ; sans adieu… apparent : après un dernier spasme son regard a cherché bien haut le ciel puis s’est tourné vers moi… sa main droite a cherché quel qu’appui devant elle… j’ai pris cette main qui a serré la mienne, tout s’est tu en elle, elle nous avait quittés !
O douleur cruelle ! O blessure invisible au cœur d’un époux qui n’a plus devant lui que la dépouille inerte de celle qui fut pendant plus d’un demi-siècle la joie de ses yeux, l’affection de son cœur, l’autre moitié de lui-même ! Combien est-il malheureux, et qui peut consoler sa peine indescriptible ?
Nos jours étaient les mêmes, nos joies et nos douleurs toujours confondues, toujours partagées, toujours également supportées. Notre vie était une, notre amour un seul amour éternellement juré le jour de nos fiançailles, consacré le jour de notre mariage et que rien dans la suite des jours n’a ébranlé !
Que peut être dure alors la peine que supporte maintenant le malheureux laissé seul sur la terre qui va pleurer, qui va appeler, qui va crier l’absente qui ne répondra plus jamais !
Quel poids dans cette croix dont ses épaules sont maintenant chargées ? Croix de chagrins, d’abandon, d’absence de soutien, de conseils, de soins, de tendresse. Le vide, vous dis-je, le vide que rien de terrestre ne comble…
Qui peut consoler une si grande douleur si ce n’est vous Mon Dieu ?
24 Février 1939
Une autre messe mensuelle, dite aujourd’hui à l’Eglise de St Jean par le Père Damoison, à laquelle ont assisté en même temps que moi Jean, Claire, Françoise, Alice qui était venue nous prendre en auto. Après la messe nous avons visité pieusement la tombe de mon amie et lui avons porté des fleurs, nos prières et nos larmes.
J’ai beau partir de ma demeure, y revenir,
M’asseoir, me lever, marcher ou m’endormir,
Toujours devant moi se trouve ma peine amère
Lourd fardeau qui pèse sur ma vie entière !..
J’ai beau me dire que bientôt, demain peut-être,
L’aile de la mort viendra toucher mon être,
Rien ne peut empêcher ma secrète douleur
De déchirer mon âme en même temps que mon cœur.
J’ai beau me dire enfin que nos âmes unies
Ne peuvent devenir l’une à l’autre étrangère
Quand la mort les sépare, ma vie sera amère
Jusqu’à ce que nos âmes enfin soient réunies.
GT
Ce fut à Caselà à la Rivière Noire chez mon beau-frère Henry Koenig qui administrait les biens de l’Assets Cie que je vis Gabrielle pour la première fois; elle était venue en visite chez ma sœur Mina où je me trouvais moi-même en « weekend end » vers le milieu de Septembre de l’année 1883. Vision fugitive qui malgré tout m’avait laissé une certaine impression qui devait s’accentuer au fur et à mesure que nous nous voyions. Elle habitait à Curepipe Road une campagne appelée « Les Quatre Vents“ dépendant d’une très grande campagne aujourd’hui disparue, de M. Vincent Geoffroy qui finit par morceler, démonter et vendre les trois ou quatre maisons qui en faisaient partie.
Gabrielle avait un culte, une adoration vraiment sincères pour ce coin des Quatre Vents où se trouvait sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Elle cultivait avec amour et beaucoup de succès de très beaux œillets qui eurent un prix à l’Exposition horticole 1884 à l’Institut de Port Louis.
Elle avait aussi une serre où se trouvaient de très jolies fougères et des plantes d’ornement.
A la mort de sa mère on lui confia l’administration de l’intérieur et l’éducation de ses jeunes sœurs et de son petit frère Léon. Elle accomplit sa tâche avec beaucoup de dévouement et de capacités et s’attacha à sa petite famille comme elle s’attacha aux lieux où tous vivaient.
Aussi ce fut un déchirement cruel lorsqu’en janvier 1885 la famille dut quitter Curepipe pour aller habiter la propriété Médine à la Rivière Noire dont M. Eugène Koenig était l’administrateur.
C’est depuis cette année (1885) que je l’ai vue souvent, allant moi-même à Caselà passer mes samedis et mes dimanches chez Henry et Mina et c’est pendant cette même année que se trama le tissu qui devait envelopper nos premières relations, l’inclination progressive de l’un pour l’autre, la déclaration de notre amour et la réalisation de notre bonheur.
Elle aimait beaucoup écrire ses impressions, et racontait ses journées et les événements qui se déroulaient autour d’elle, et c’est ainsi que j’ai pu suivre les étapes de son existence en lisant son cahier no 15 commencé le 30 janvier 1885 et qui finit le jour où je l’ai demandée en mariage. Janvier 1886 parce qu’alors elle n’avait plus rien à raconter, n’ayant d’intérêt que dans sa qualité de fiancée, et de temps à employer qu’à rendre heureux celui qui est aujourd’hui si malheureux de l’avoir perdue…
Cette année, préparatoire dirais-je, de 1885 fait voir son état d’âme et les vertus magnifiques dont elle était remplie. Désolée de quitter les « Quatre Vents » où s’était passée son adolescence, elle prend pourtant résolument son parti de vivre là où Dieu le veut et s’adapte à cette existence à Médine dont elle tirera le meilleur parti, remplissant avec avantage son rôle de maîtresse de maison, de petite maman de sœurs plus jeunes qu’elle, de fille chérie de son vieux père, de sœur aînée de frères plus âgés qu’elle. Elle était adorée de tous parce que la charité habitait en elle et que sa bonté soumettait tout à elle.
Quoique la vie fût plutôt monotone pour elle à Médine au moment de son arrivée, bientôt elle s’y fait tout à fait car les distractions s’y produisent par le fait du voisinage de parents et d’amis. La « Rivière Dragon », annexe de Médine était alors habitée par M. Alfred Koenig et ses enfants et plus loin il y avait « Caselà » où étaient Henry et Mina et leurs jeunes enfants.
Médine qui offrait beaucoup plus de facilités de mouvements et d’action devint bientôt le centre des réunions et les jolies jeunes filles de ce lieu attirèrent de suite parents, amis et connaissances.
Ce fut alors de constantes réunions où la musique, la danse, les diners, les promenades se succédaient tout à tour pour le plus grand plaisir de tous.
Gabrielle recevait tout ce monde avec aisance et amabilité, s’occupant de tous avec une grâce charmante, tenant son rôle avec autorité et c’est lorsqu’elle présidait la table familiale qu’on pouvait juger quelle femme précieuse elle serait pour celui à qui elle unirait un jour sa vie toute entière !..
Ayant perdu sa mère à l’âge de 17 ans, elle avait dû puiser du courage dans sa propre nature qui s’y prêtait et avec les conseils de sa tante Léonie qui lui servait de mère elle avait façonné sa force morale très heureusement et regardait venir les jours prête à les supporter avec l’aide de Dieu.
Son père était le roc auquel elle s’adossait pour tenir tête aux événements mais elle chercha parfois l’âme de sa mère pour qu’elle intercédât pour elle afin de voir clair en son cœur dans la grande question de son avenir et de dire à cette mère : Vois celui que j’ai choisi pour traverser la vie, fais qu’il sache et qu’il vienne à moi.
Il en fût fait ainsi !… Je dirai plus loin les événements qui se sont déroulés et comment pendant que son affection m’était déjà acquise, mon propre cœur lui était depuis de longues années bien solidement attaché.
Il me faut auparavant poursuivre le cours de cette année 1885 dont nous ne sommes qu’au début.
Bientôt la maladie frappe à coups redoublés sur cette famille charmante; la fièvre qui sévit à Médine terrasse les uns et les autres; l’ange tutélaire du foyer prodigue à tous les trésors de son dévouement. Elle soigne la grande maison, elle soigne au pavillon ses frères sans ménagement de ses forces, et sa constance, sa charité aimable eut raison du mal qui cède à tant d’affection. Que d’heures passées au chevet de son frère Michel qui avait une si grande affection pour elle, au chevet de la petite Agneau à qui elle servait de mère depuis la mort de la sienne !
Quand les jours tristes s’effaçaient, sa nature si gaie et si heureuse reprenait le dessus, et bien vite elle retrouvait le chemin de son devoir tranquille avec une bonne volonté qui lui facilitait toutes choses.
Pieuse vraiment, ayant reçu les principes chrétiens de sa famille d’abord puis élevée au Couvent des Lorettes à Curepipe elle avait une dévotion sincère, s’occupait des autels aux Bambous avec Pauline Koenig, travaillait au vestiaire de l’Eglise et catéchisait les enfants de ses serviteurs. Je la vois encore cousant dans la serre de Médine où je me trouvais un jour en compagnie de Gabriel Rochery, un des hôtes de là-bas, un surplis que devait porter le Père Maroëlle à une cérémonie des 40 heures qui devait avoir lieu le lendemain à l’Eglise des Bambous. Ses doigts agiles se pressaient pour terminer à temps le dit surplis qui fit grand plaisir au curé de la pauvre Eglise de ce quartier si peu habité de généreux paroissiens.
Elle aimait la poésie, les belles lettres, possédait un Album dans lequel elle avait inscrit bon nombre de jolis vers et des morceaux choisis, des pensées hautes. Elle faisait y écrire par les uns et les autres quelque pensée jugée belle et j’eus moi-même l’occasion d’écrire celle du Dante suivante :
« Nessum maggiore dolore que ricordarse
Del tempo felice nella miseria ».
Cette pensée que j’écrivis alors pour écrire quelque chose se réalise aujourd’hui avec une acuité poignante et Dante disait vrai, car il n’est pire douleur que de se souvenir d’un temps heureux dans les jours de malheur et les vers de Musset qu’Edouard Pelte a écrits au bas de ma pensée dans l’Album de Gabrielle sont impuissants à infirmer ce qu’a dit le poète Italien :
Douleur profonde, rien ne t’est comparable !
Elle aimait aussi la peinture en artiste, et je possède encore des gravures sur vélin et sur papier de riz que je lui envoyais dans le cours de nos relations. J’avais moi-même peint quelques gravures pour elle qui les aimait et sa modestie lui avait fait écrire dans son journal qu’elle était déconcertée de voir que ses peintures n’égalaient pas les miennes !.. Et pourtant !
La danse était un des plaisirs les plus vifs auxquels se livrait la jeunesse de la Rivière Noire et tous les samedis et les dimanches les salons de Médine étaient insuffisants à contenir les membres de la famille qui venaient prendre part à cet agréable amusement: du côté féminin on comptait Pauline et Louise filles du vieil oncle Alfred Koenig, puis Gabrielle, Coralie, Henriette et Agnès, toutes quatre filles d’Eugène Koenig. Du côté masculin il y avait Bernard et Michel, Léon, frères de Gabrielle, Louis, Etienne, et Alfred ses cousins Rochery parent de la famille, moi-même allié à la famille par le mariage de ma sœur Mina avec Henry.
Coralie tenait le piano et souvent lorsqu’elle ne jouait pas c’était Versange, un jeune domestique qui nous faisait danser aux sons de son accordéon et je puis déclarer que cet instrument habilement manié suppléait parfaitement à l’instrument à cordes de Coralie.
Valses, scottishs, polkas, mazurkas, quadrilles se succédaient tout à tour jusqu’à fort tard dans la nuit, et la soirée se terminait par un thé qui donnait congé à tout le monde.
Les habitants de Rivière Dragon remontaient dans la nuit pour chez eux, et Louis et moi nous avions notre chambre dans l’annexe de la salle à manger. Rochery couchait à R. Dragon.
Les dimanches « Médine » déjeunait dans la « serre », agréable pergola qui se trouvait adossée à un immense vivier qu’on avait asséché à cause des moustiques et des miasmes de fièvre.
J’étais souvent invité à ces bons repas et après déjeuner on formait les projets pour le samedi et le dimanche suivants.
On parlait alors d’aller passer l’après-midi, diner au Barachois à la Baie de Tamarin.
Oh ! Ce cher Barachois ! qu’il me rappelle de bons et doux souvenirs !.. Cinq voitures partaient de Médine remplies des deux familles et de tout le nécessaire culinaire pour combler nos robustes et jeunes appétits. Rendus au Barachois on procédait à l’installation de la salle à manger, aux apprêts de la cuisine et à la préparation du feu de joie qu’on devait allumer sur la plage pour faire tout autour la ronde, le « jangarna » et « en qui brûle ». Le diner vite avalé et le pousse café pris on remettait tout en ordre puis la bande joyeuse se précipitait sur la plage comme des écoliers en vacances.
Versanges nous suivait avec son accordéon et on se mettait en danse sur le battant de la lame. Je crois bien que nous avons été les inventeurs de la danse sur la plage. Je n’avais jamais avant cette époque, entendu parler de cette façon de s’amuser et je puis dire qu’elle avait un charme et une poésie extraordinaires.
Gabrielle aimait à m’avoir comme partenaire et je n’ai pas besoin de dire combien j’étais heureux de partager le plaisir qu’elle y trouvait. Enivrés par la danse il nous arrivait parfois d’atteindre la pointe du Barachois, oubliant tous les autres, et n’entendant même plus la musique restée avec la bande à l’arrière. Seuls nos cœurs battaient la mesure et le bruit des vagues nous servait d’harmonie.
O … tempora… tempora !…
Mais il fallait rentrer à Médine. On sautait la passe en pirogue, montait en voitures et au clair de lune souvent on parcourait la route en chantant toujours accompagnés par l’Orphéon Versanges.
On conçoit aisément que le charme devait fatalement se produire, et que le rêve que je faisais, et qui correspondait à celui de ma jeune amie (je l’ai su après) devait faire place à la réalité. Cependant ma nature froide et renfermée ne livrait rien pendant que brûlait en moi une flamme ardente. J’étais bien sûr de mes sentiments personnels mais pas assez présomptueux pour penser que j’étais entré bien avant dans le cœur d’une jeune fille bien élevée qui de son côté ne pensait pas avoir enchaîné le mien…
Ces petites réunions du samedi et du dimanche devenaient de plus en plus fréquentes au grand plaisir de ceux qui s’y amusaient, et l’intérêt réciproque en même temps que l’attirance progressait de semaine en semaine, troublant les cœurs de deux des personnes formant la petite société de Médine. On plaisantait la jeune fille, et elle se défendait n’ayant rien à livrer et personne n’osait s’attaquer à moi.
C’est ainsi que s’écoula une année toute entière avant que par l’intermédiaire de ma sœur Augusta qui était très amie à Gabrielle, je fis sonder la charmante jeune fille sur l’état de ses sentiments avant de déclarer les miens.
Son cœur était libre et le chemin n’en était ouvert qu’à moi seul !.. Je m’y engageai résolument, et priai ma sœur de faire savoir à Gabrielle que mon cœur lui appartenait depuis longtemps et qu’elle comblerait mes vœux en acceptant ma foi.
Ce fut tenu secret du 6 Janvier 1886 au 6 Mars; si secret, qu’il n’y eut même pas entre nous deux de communication directe pour la raison que j’étais tombé malade d’une fièvre grave à Port Louis, et obligé d’aller changer d’air à « Mon Léhu » chez Augusta au Phoenix où le Docteur Ernest Harel me traita énergiquement pendant plusieurs semaines pour m’arracher à la mort et au désespoir.
Ma fiancée « secrète » vécut alors des jours malheureux, ne pouvant ni me voir ni m’entendre, ne recevant de mes nouvelles que de temps en temps par des billets d’Augusta qui la consolait du mieux qu’elle pouvait, et l’encourageait à supporter avec résignation les contrariétés que nous éprouvions tous deux.
Enfin le jour vint où nous nous fîmes nos mutuelles déclarations. Le 6 Mars à Casela, je me dirigeai vers le rondpoint de la source, après avoir prié ma mère de dire à Gabrielle que je voulais l’entretenir d’une sérieuse question. Je la vis bientôt arriver à moi pâle et tremblante alors que moi-même j’étais d’une émotion indescriptible.
Quel moment terrible et délicieux !… Terrible à cause de la victoire que j’avais à remporter sur ma timidité et ma réserve. Délicieux pour les résultats que j’entrevoyais au profit de mon bonheur !
Avec beaucoup d’émotion dans la voix ma question fut posée et la réponse me vint qui pénétra mon cœur d’une joie débordante; nous nous assîmes ensuite sur le petit banc de bois du rondpoint pour ouvrir nos cœurs qui ne contenaient que… nous-mêmes ! Notre conversation dura quelques minutes et nous nous séparâmes à regret pour ne pas attirer l’attention de la société qui était réunie dans le pavillon de la salle à manger à luncher.
Mon père devait en parler aussitôt au père de Gabrielle et lui demander officiellement le droit de me dire son fils.
Monsieur Eugène Koenig reçut favorablement ma demande de la main de sa fille et nos fiançailles devinrent officielles le lendemain 7 Mars à Médine.
Elles devinrent officielles pour la famille directe de Gabrielle et pour la mienne (c.à d. entre nous) mais tous les parents de ma fiancée se trouvaient à Médine au moment où tout se cousait et je crois que ce fut un secret de commère que bien vite les oncles, cousins, et cousines avaient découvert en voyant mon père embrasser ma fiancée, Mr Koenig embrasser ma mère, tous les frères et sœurs embrassant mes sœurs et enfin Mons Koenig nous appelant devant la cheminée de la varangue pour nous dire : Embrassez-vous mes enfants !..
Dans la soirée, nous partis pour Casela, Mr Koenig en fit part à son frère Alfred, et le lendemain tout Rivière Dragon était avisé.
Je fus alors admis à faire « ma cour » et alors comme tous les chemins mènent à Rome, tous ceux de la Rivière Noire, de Casela ou le chemin de fer de Port Louis à Petite Rivière ou on me faisait prendre en voiture me menaient à Médine aussi souvent que les circonstances le permettaient. Ma joie éclatait, mon bonheur grandissait à chaque fois qu’il m’était possible de de me sauver de la rue St Georges pour aller rejoindre ma tendre amie en dehors des samedis et dimanches officiels. Tous les prétextes étaient bons pour nous voir et nous revoir ; et lorsque vraiment il était impossible de s’absenter de la Ville nos lettres portaient à l’un et l’autre l’expression de nos tendres sentiments et les regrets que nous causait l’absence.
Doux temps des fiançailles qui sert à faire connaitre à ceux qui vont s’engager dans les liens du mariage le caractère de chacun et le degré de force de l’amour qu’on déclare ! Se peut-il qu’il y ait des individus qui étalent aux pieds de leur fiancée un tapis merveilleusement brodé de sentiments peut-être sincères au moment même, et qui dans la suite des jours voient ces sentiments perdre toute leur chaleur jusqu’à se refroidir complètement, et des mariages malheureux dans leur suite succéder à d’heureuses fiançailles !..
Pour nous je puis le dire, le bonheur commencé au jour de nos mutuels aveux parcourut le long chemin de cinquante-trois ans d’existence commune avec toute la sincérité de notre foi jurée pour toujours.
Notre mariage eut lieu le 7 Septembre 1886 en l’Eglise de St Sauveur aux Bambous (Rivière Noire) et fut béni par l’Abbé Cooney curé de l’endroit que nous connaissions beaucoup et qui nous affectionnait. Parents, amis, connaissances, réunis à St Sauveur furent les témoins du bonheur qui éclatait sur nos figures heureuses, et lorsqu’à mon bras j’emmenais ma femme pour nous rendre à Médine, une joie bien douce envahissait mon cœur. La voiture attelée du fringant cheval « Captain » et conduite par le vieux cocher Henri nous déposa au vieux perron où nous descendîmes pour aller au salon attendre les compliments de tous et les embrassades d’un grand nombre.
Le tiffin était dressé dans la serre et je suis peiné de dire qu’à l’heure des discours on attendit vainement celui que Monsieur de Mazérieux qui était mon témoin était supposé devoir faire aux mariés. Il est vrai qu’on ne lui avait pas demandé de le faire, ce qui l’excuse. Je ne me souviens plus qui l’a fait à sa place et s’il a été fait, mais comme tout se passait en famille il est possible qu’on n’en ait pas vu la nécessité ou l’importance.
Journée fatigante qui me causa une affreuse migraine dont je ne fus débarrassé qu’au succulent diner donné par Mr Koenig et qui réunit les principaux membres de la famille.
Nous passâmes notre lune de miel à Osserre, campagne annexe de Médine à cinq minutes de marche de Médine où M. Koenig nous accompagna le soir du 7 Septembre/86 jusqu’à la varangue, me confiant avec émotion sa fille chérie, la joie de son foyer qui devenait ma joie à moi, mon bonheur et ma vie.
Nous passâmes à Osserre les mois de Septembre et d’Octobre 1886 à jouir d’un bonheur immense, prenant nos repas du matin dans une petite salle aménagée dans ce but, et les repas du soir à Médine avec la famille. Nous faisions des courses à travers la propriété dans une petite voiture à mule mise à notre disposition par mon beau père et que je conduisais moi-même pour être nous deux tout seuls jusqu’au moment de rentrer à Osserre où les journées passaient au milieu d’infinies contemplations de deux êtres de qui Dieu venait de remplir les cœurs d’un si réel bonheur.
Notre séjour à Osserre fut interrompu par la mort de Mme Vincent Geoffroy tante de Gabrielle, à la Meilleraie à Curepipe et nous dûmes monter aux Quatre Vents passer quelques jours pour les obsèques de la morte.
Gabrielle tout en étant chagrine de la mort de sa vieille fut heureuse de se retrouver dans sa demeure des Quatre Vents au milieu de ses parterres, de ses fleurs, de ses petites affaires de jeune fille dans l’atmosphère de Curepipe embaumée d’œillets, baignée de fraicheur, et c’est le cœur attristé que nous dûmes redescendre à Osserre après une telle dilatation de son cœur généreux causée par la pleine satisfaction d’avoir à la fois son mari auprès d’elle et ses « Quatre Vents » à ses pieds…
Après quelques visites de nous autour de nous, nous partîmes pour la Rue St Georges à Port Louis qui était mon domicile. Pauvre fleur transplantée, enfant tant chérie de son père et des siens, ce ne fut pas sans un serrement de cœur qu’elle laissa derrière elle tout ce qui faisait jusque-là sa raison de vivre, et j’ai retrouvé dans son album de Pensées les vers de Victor Hugo écrits par son père à cette occasion :
« Va, mon enfant chérie, d’une famille à l’autre
Ici l’on te retient, là-bas on te désire,
Donne nous un regret, donne leur un espoir
Sors avec une larme,
Entre avec un sourire. »
Et c’est bien avec le sourire qu’elle entra dans ma maison, sourire qu’elle conserva toujours et que je vois encore sur sa bonne figure qui est là devant moi dans son cadre sur mon bureau dont la photographie a été prise dans notre jardin le jour de nos “Noces d’Or“ …
La chaleur de Port Louis et la fièvre nous obligèrent bientôt à mener une existence nomade. Nous quittions la ville pour Médine passer quelques mois puis pour Curepipe pour la naissance de notre premier enfant : Marie; on retournait à Port Louis puis à Médine puis encore à Curepipe pour la naissance de notre premier fils : Emile (1889) puis encore à Médine, puis en Ville où naquit notre second fils Jean (1891) retour à Médine, à Port Louis où nait notre 3ème fils Philippe (1893) où Gabrielle a été si souffrante qu’on partit pour Médine et c’est à St Sauveur qu’on baptisa Philippe.
Enfin en 1893 tout le monde quitta Port Louis. Une épidémie d’influenza régnait à ce moment en ville et mon père et ma mère furent gravement malades. Mon père ne pouvant plus continuer son travail, dut prendre sa retraite et alla habiter à Casela chez Henry avec ma mère. On vendit les meubles et ferma la maison. Gabrielle les enfants et moi nous partîmes habiter Médine avec la famille. On nous installa dans le pavillon des jeunes gens et Bernard alla occuper « Le Colombier « contre la grande maison. Ce Colombier tirait son nom de ce que ce pavillon avait été aménagé pour nous lorsque nous allions faire des séjours à Médine et que le pigeon et la colombe n’étaient encore que deux, attendant les pigeonneaux qui ne tardèrent pas à arriver les uns après les autres dans la suite.
Nous restâmes à Médine jusqu’en 1894 où la fièvre déprimant nos jeunes enfants nous dûmes nous décider à aller habiter les hauteurs, et nous habitâmes une campagne que Vincent Geoffroy possédait à Rose Hill, et qu’il nous loua sous le nom de « Mofine « … La maison était restreinte et les aînés grandissaient et grossissaient, prenant toute la place, ce qui nous obligea à changer de maison et d’habiter tout à côté celle de M. Maulgué où sont nées Wilhelmine aujourd’hui Mère Marie du St Abandon (1895) puis Alice, aujourd’hui Madame Xavier Koenig (1896). C’est dans cette maison que j’eus une crise de rhumatisme musculaire des plus virulentes qui me priva d’être aux côtés de Gabrielle à la naissance de Mina parce que j’étais immobilisé comme un cadavre sur mon lit de douleurs, raide comme une planche de la tête aux pieds, ne pouvant même pas remuer la tête. On dût me porter sur une couchette le lendemain de la naissance de ma fille dans la chambre de ma femme pour la féliciter et embrasser la mère et la fille.
Mon père mourut dans cette maison Maulgué à l’âge de 68 ans. Il était parti de chez Henry à Casela après la mort de ma mère ( 1896) et vint habiter chez moi pendant que les gens de Casela se dispersaient et venaient habiter Quatre Bornes, et que mon beau-père et les siens les suivaient dans ce même quartier après les revers de Médine et le changement d’administration.
Cet excellent quartier de Quatre Bornes nous attira nous-mêmes en 1898, Julien Couve me trouva la Campagne Rault sur la route St Jean, que nous habitâmes treize années !..
Mon propriétaire bien complaisant augmentait la maison au fur et à mesure de l’arrivée d’enfants nouveaux, moyennant une légère augmentation du loyer, naturellement, mais dût cesser enfin un beau matin d’agrandir parce qu’il me venait trop d’enfants et qu’il n’avait pas suffisamment d’argent pour me suivre sur le terrain des agrandissements.
Là sont nés en effet Louise, petit ange envolé au bout d’un mois, Lily, Joseph qui fut mourant d’une entérite, et que Noel Couve sauva de la mort par des médicaments inconnus des médecins qui le soignaient, Jacques, qui mourut plus tard à Munneville et enfin Claire, dernier enfant que nous eûmes.
Cette période de notre existence (de 1898 à 1911) a contenu trop d’événements pour que je ne m’étende pas un peu à les dérouler sous mes propres yeux, et sous ceux de mes enfants qui liront ceci un jour.
Nous vécûmes là très modestement mais très heureusement, la famille de Gabrielle habitait à deux pas de la Campagne qui appartient aujourd’hui à M. Gaston d’Hotman. On pouvait se voir à chaque instant ce qui rappelait un peu l’existence à Médine. C’est dans cette maison que mourut mon beau-frère Bernard en 1899. On l’avait transporté très malade de Médine d’un mal que ni le docteur Chateauvieux ni les autres appelés en consultation n’ont jamais pu diagnostiquer (paralysie spinale a-t-on dit plus tard).
Monsieur Eugène Koenig le suivit quatre ans plus tard dans la tombe et Henriette en 1906 partit à son tour réduisant ainsi les anciens habitants de Médine à cinq membres que la mort devait encore ravir dans les années qui suivirent.
C’est pendant notre séjour à la maison Rault que nos aînés firent la première Communion et leur confession. Gabrielle les y prépara avec un soin jaloux, pour plaire à Dieu et ne ménagea jamais ses peines et ses fatigues pour y réussir. Elle entreprenait à pieds la longue route de St Jean deux fois par jour et assistait aux instructions que leur faisaient les bons pères Haaby, Bonjean, Bourbonnais et Pellerin rentrant chez nous lasse, mais satisfaite de son religieux labeur qui conduisait au Bon Maître toutes ces petites âmes dont Dieu nous confiait l’avenir.
Puis ce fut le tour de l’instruction des mioches: diligente et patiente elle les préparait à se présenter à la petite école de « Mimi » Ribet qui avait comme professeur Jeanne Hall et ses sœurs Coralie et Agnès (les 2 sœurs de Gabrielle) et Monsieur Emile Pascau. Les enfants restèrent là jusqu’au jour où il fallut les mettre au Couvent des Lorettes ou au Collège Royal pour faire leurs grandes classes.
On allait le dimanche en procession à la messe de 8½ à St Jean et comme il fallait habiller 10 enfants avant de songer à soi-même on était généralement en retard sur l’horloge du Père Haaby, et le vieux frère Faustin qui faisait partie des religieux de la Paroisse nous avait surnommés « La Famille du Gloria » parce que c’était à ce moment de la messe que nous entrions triomphalement dans l’Eglise.
Nous avions comme voisins d’un côté la famille Charles Rousset, les Jamet ; derrière, les Ribet, et à droite les Brown pendant un moment puis Ernest Lacoste qui avait épousé Valérie Ducray en 1ères noces et en 2ème noces une cousine à lui Mlle Madeleine Lacoste (de Bordeaux).
J’avais commencé à m’occuper de cyclonomie en 1892 pendant que nous habitions Rose Hill et à la suite du cataclysme qui se produisit le 29 Avril 1892 et que je raconterai sans doute plus loin, et je continuai mes études à Quatre Bornes avec une passion qui était entretenue par les relations que j’avais avec le Commandant Jean Bertho Capitaine de port à la Réunion, avec lequel j’ai entretenu une correspondance pendant 20 ans faisant des observations de chaque cyclone à Maurice pendant qu’il en faisait également à la Réunion, nous contrôlant mutuellement ce qui nous permit d’avancer considérablement dans l’étude de ces météores.
Le Gouvernement Français me décerna en 1908 sur les démarches de M. Bertho le brevet d’Officier d’Académie pour « Services rendus à la Science »….
Je me souviens de l’émotion que j’éprouvai un soir au retour de la Ville quand Gabrielle vint épingler à ma boutonnière la rosette lilas que M. Bertho lui avait envoyée pour me faire la surprise et me dit qu’elle avait commandé un bon diner pour fêter cette distinction qui la rendait « fière et heureuse « . Quelques temps après mon brevet me fut remis officiellement au Consulat de France par le Consul Lafond qui m’épingla la Croix ou plutôt les Palmes académiques et qui entre parenthèses se piqua cruellement le doigt et saigna abondamment. Ce jour-là aussi (un 14 Juillet) 1908 Camille Sumeire reçut la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur pour sa noble conduite pendant le cyclone du 29 Avril 1892.
Ce fut une époque de merveilleuses observations cycloniques faites par M.Bertho et moi et le souvenir que j’évoque aujourd’hui de ces choses me rend bien heureux.
Heureuse aussi était ma chère femme de suivre les développements de ces observations et des bons résultats qui en découlaient. Elle était fière de répondre à tous ceux qui envoyaient aux nouvelles pendant les passages des ouragans et rassurait ou alarmait suivant l’opinion que je lui disais de transmettre aux envoyés, alors que gravement sérieux devant mes instruments je calculais et supputais… et elle lisait ensuite avec joie les compliments qui m’étaient faits dans la presse à la suite de mes publications, surtout lorsque M. Claxton le directeur de l’Observatoire était pris à partie par le public pour ses erreurs d’appréciation et que des louanges m’étaient adressées par le même public sur la justesse de mes observations.
Il ne faudrait pas croire à de la fatuité de ma part de raconter ce qui précède. Je n’ai été qu’un simple « Observateur Amateur » mais mes études étaient faites en collaboration avec mon collègue de la Réunion (je dirai : mon Maître) et comme à cette époque l’Observatoire n’entretenait aucune relation télégraphique avec Bourbon, nos conclusions à M. Bertho et à moi avaient le mérite d’un contrôle sévère qui leur donnait une grande certitude.
La maison Rault devenait parfois un hôpital : épidémies de « Mal de moutons » de « Vérette volante », de « Rougeole ». Dix enfants sur les cadres et leur vaillante mère veillant à leurs chevets et les remettant sur pied après tant de soins donnés sans souci de sa propre santé, voilà ce qu’on voyait en Gabrielle et qu’on admirait sans réserve.
Mes enfants lui doivent beaucoup de reconnaissance pour sa tendresse si maternelle et sa grande sollicitude pour eux. Ce sont tous des hommes et des femmes mariés pour la plupart et qui ayant à en user de la même façon à l’égard de leurs enfants doivent se rappeler de leur mère…
Nous partîmes un beau jour de cette Campagne Rault après treize années d’occupation pour aller habiter celle de M. Robert Giraud appelée « Château Candos » où nous restâmes quatre ans. Ce « Château » était en effet une belle demeure qui nous plaisait beaucoup par ses beaux appartements, sa romaine et son immense cour. Quatre années de bonheur encore, mitigé pourtant par des séparations de nos aînés qui rendus à l’âge où il faut travailler, s’employèrent à diverses fonctions. Emile entra à la Mercantile Bank, puis à la Poste Centrale il partit même sur les propriétés sucrières Constance et la Gaieté et Astréa. Jean alla à Bassin propriété voisine de Quatre Bornes que la fièvre l’obligea bientôt à quitter de même qu’Emile quitta Constance pour les mêmes raisons et alla à Astréa qui ne lui fut pas plus clément.
C’est alors que se déclara la grande guerre de 1914 à 1918 et mes deux aînés, fils de français furent appelés sous les drapeaux et restèrent absents du foyer pendant ces quatre années de guerre.
Leur mère ne vécut pour ainsi dire pas pendant cette période de son existence. L’anxiété, l’angoisse, le chagrin de les voir si exposés avaient fait d’elle une vraie martyre. Elle vivait hors de Maurice attendant à chaque heure du jour une lettre qui lui donnât des nouvelles de nos soldats, hantée de l’idée qu’il leur serait peut-être arrivé malheur sans compter que les jeunes gens, après leur instruction militaire étaient partis pour le front d’où il n’était pas facile de correspondre avec la famille. Ernest Harel ami d’enfance de mes fils, qui faisait ses études de médecine à Paris et qui était sujet anglais n’était pas tenu de servir, nous servait d’intermédiaire et c’était à lui que nous adressions nos lettres qu’il faisait parvenir aux « poilus » dont il suivait la trace postale.
- et Mme Anatole Barraut, gendre et fille de mon collègue Bertho vinrent passer à « Candos » quelques semaines. C’étaient des hôtes très agréables et cette Fanny Barraut était la plus endiablée des petites personnes qui mit beaucoup de gaité et d’animation chez nous pendant son séjour.
Nous avions comme voisins la famille Henry Genève. Madame était une excellente musicienne qui très souvent faisait danser la jeunesse aux accords de mon piano. Cette jeunesse se composait de mes fillettes, des de St Félix Harel et des jolies demoiselles Genève. On faisait le Croquet, le Tennis et on terminait la soirée au salon par de la musique et des danses.
Ma femme et mes enfants me pressèrent un jour de faire bâtir un campement à la Baie de Tamarin et je me laissai tenter. Emile, Jean et moi nous nous occupâmes à tour de rôle de suivre les travaux de construction du dit campement qui commencée tardivement dût être activée pour nous permettre de faire la saison en temps voulu…C’est ainsi que nos effets arrivèrent au Campement un 31 Juillet, alors que les ouvriers avaient à peine terminé le matin le chalis du campement où les pieds des meubles s’incrustèrent profondément.
Tout de même, ce fut un temps heureux que ce séjour à la mer, Gabrielle était dans toute la joie de son âme de se trouver si près de son cher « Barachois » témoin de notre amour commençant et que des revers de fortune vinrent arracher aux habitants de Médine.
Notre campement exista deux ans. Un beau matin je reçus une dépêche de mon gardien, un créole du nom d’ »Ayo » m’annonçant que mon campement avait brûlé pendant la nuit !… « Ploré, ploré mo lizié »… il nous fallut contenir notre immense chagrin de la perte de cette petite paillotte qui avait abrité nos joies pendant ces deux années, et nous désolés d’avoir à renoncer désormais à ces délicieux séjours au bord de la mer que nous avions adoptés depuis quelques temps avant notre construction car avant de bâtir nous prenions en location le campement Merle près de la Croix de la Mission.
Lorsqu’on partait pour Tamarin pour un séjour d’un ou de deux mois, « Candos » était confiée à la garde du vieux Papin (Eugène) ancien serviteur des familles Koenig et Geffroy qui était un Michel Morin. Il était un peu facile dans son gardiennage, et laissait entrer dans la Maison nos amis du voisinage qui usaient fréquemment du téléphone et laissa mourir de faim de jolis serins de France qui chantaient à gorge déployée sous la varangue.
Le jour où nous partîmes pour le campement dans l’auto du Crédit Foncier que le Manager M. Eugène Gallet avait mise à ma disposition, il nous arriva une aventure qui aurait pu nous être funeste, mais la Providence veillait sur nous et ne permit aucun malheur : rendue en face de l’entrée de la propriété Pierrefonds, notre auto collisionne avec celle de M. Georges Bonnin qui sortait sur la route sans s’assurer que la route Royale était libre, et un choc terrible s’ensuivit. La « Mitchell » du Crédit Foncier qui était plus puissante et voyageait à une rapide allure poussa devant elle l’autre auto à une distance de 50 pieds où les deux machines s’arrêtèrent. Un bruit formidable s’était produit au choc et nous pensions tous être morts alors que personne ne fut atteint. Il y avait dans notre voiture ma femme, mes enfants, un chien braque, un télescope, des paquets et de quoi nous entraver s’il avait fallu sauter. Seule la vitre a été brisée, les pneus éclatés, l’axe un peu faussé. Nous voilà en panne, obligés de descendre à Pierrefonds où le vieux M. Bonnieux nous reçoit en attendant qu’une autre auto commandée à Quatre Bornes par l’entremise de M. Constant Le Meur qui passait sur la route vienne nous prendre pour aller à Tamarin.
Lorsque M. Giraud nous réclama sa campagne pour l’habiter lui-même, nous partîmes pour celle de M. Desjardins à l’opposé ouest de Quatre Bornes. Grande maison de 8 à 9 pièces avec varangue tournante bien agréable, mais à l’aspect triste. Elle le fut pour nous en tout cas en 1915 lorsqu’y mourut notre pauvre Philippe d’une septicémie causée apparemment par des injections hypodermiques faites sans soin sur la propriété Mon Désert à Moka où il travaillait. Gabrielle s’acharna à le sauver par des soins inlassables secondant le Dr Harel qui malheureusement ne réussit pas à le tirer de là. Après la mort de notre petit ange Louise en 1906 ce fut notre plus grand chagrin de voir partir ce beau garçon de 20 ans si gai si vivant et qui était aimé de toute la Société de Quatre Bornes par le concours qu’il prêtait aux concerts, représentations et autres fêtes de charité.
C’est chez Desjardins que se fiança Marie à Joseph Koenig, elle s’y maria aussi et je fis une salle verte sous la varangue de derrière qui était très longue. Jacques Levieux porta un toast aux mariés et fit allusion à l’absence de mes deux fils aînés qui étaient à ce moment à la guerre.
Oh ! la guerre !… les veilles de départ du courrier la salle à manger restait éclairée tard dans la nuit et autour de la table Gabrielle et moi écrivions des volumes à nos soldats leur racontant notre vie du moment et les interrogeant sur la leur dans les tranchées en France, en Macédoine, à Bone, sur les Croiseurs partant pour Salonique dans toutes les parties de la France où on les dirigeait selon les nécessités, changeant de garnison à tout bout de champ si bien que nous perdions leurs traces constamment et que Ernest Harel nous remettait au courant de leurs positions géographiques.
Nous quittâmes la Campagne Desjardins en 1917 pour aller habiter « Passy » campagne enclavée dans la propriété Trianon où nous séjournâmes quatre années et que nous dûmes quitter pour la mauvaise raison invoquée par Henri Ducray le mandataire des propriétaires, qu’il avait besoin de démonter les maisons qui s’y trouvaient pour les faire reconstruire sur la propriété pour les employés. C’était pendant la grande guerre et la crise des logements était intense et, il n’y avait pas une maison à louer et le Sieur Henri Ducray était derrière moi pour m’obliger à m’en aller. Je trouvai enfin une maison appartenant à M. Maugendre que je louais à Rs 175 par mois !… Nous quittâmes Passy avec regrets à cause de la bonne existence que nous y avions menée là.
Il y eut à Passy plus de joies que de chagrins : c’est là qu’Alice se fiança et se maria, que nos soldats vinrent en permission, que le Crédit Foncier me donna une pension de retraite de Rs 15 000 – que Gabrielle me demanda d’acheter deux autos (1 Buick Rs 4000 et 1 Ford Rs 3000) pour faire du « Taxi », que le Crédit Foncier me nomma co liquidateur de cette Compagnie à Rs 6000, que je cultivais des cannes qui une année me rapporta de quoi payer une année de locations, mais c’est là aussi que nous revint Jean frappé d’un mal extraordinaire qui nous avait fait bien craindre pour sa vie. De tous les médecins qui l’avaient vu seul Duvivier avait déclaré avec raison que ce n’était qu’un choc de guerre mal tout à fait nerveux qui devait céder un beau matin ce qui se produisit en effet. Là encore nous traversâmes une épidémie d’influenza Espagnole qui jeta tout le monde par terre mais dont nous sortîmes saufs alors que l’on mourrait comme mouche partout ailleurs dans la Colonie.
Nous étions entourés de Champs de Cannes de Trianon qui un jour brûlèrent à la ronde. Ce fut un émoi très grand dans le quartier où l’on pensa que la famille Toulorge rôtissait au centre de l’incendie. Gabrielle m’avait téléphoné en Ville pour me demander ce qu’il fallait faire des autos et de leur provision d’essence. Je lui répondis de les faire sortir de leurs garages et de les faire conduire sur la grande route pour éviter tout accident. L’incendie fut heureusement circonscrit et tout rentra dans l’ordre.
De « Passy » nous allâmes louer à la Campagne Maugendre où nous ne fîmes pas long feu : six mois. La maison était bonne pour un ménage ordinaire, mais nous logions aussi Alice et Xavier et la petite Françoise se permit de venir en ce monde, ce qui nous mit bientôt à l’étroit. Sans compter qu’il m’était difficile de supporter plus longtemps un loyer aussi onéreux. Le Comptoir Franco Mauricien dont j’étais l’Administrateur délégué branlait dans le manche et mes ressources s’en ressentaient.
C’est alors que le vieux Frédéric Rouillard me proposa d’acheter une Campagne nommée « Eureka » voisine de celle du Dr Harel et fit pour moi l’affaire, c. à dire qu’il prit hypothèque de Rs 15 000 sur la maison que M. Colin avait saisie sur un nommé Metha et revendu à Rouillard qui me la revendait.
Là nous restâmes neuf années. Un peu serrés au début parce qu’Alice et Xavier nous y avaient suivis et qu’entre temps d’autres enfants y naquirent ce qui obligea Alice et Xavier à nous quitter pour prendre une maisonnette près du Rosaire.
A « Eureka » nous eûmes la grande douleur de perdre notre petit Benjamin (Jacques) enlevé par une typhoïde en 1923 le 7 avril, date de mon anniversaire. Quel déchirement pour ma pauvre Gabrielle qui s’était tant dévouée à son rétablissement. Elle le soignait nuit et jour et priait Dieu avec ardeur lui demandant le retour de ce fils chéri à la santé. Elle m’avoua plus tard qu’elle avait été si désorientée de cette mort survenue après un mieux si sensible reconnu par les médecins qui criaient au miracle qu’elle avait éprouvé un vague absolu lorsqu’elle entendit les uns et les autres circuler autour du disparu, ne se rendant compte de rien. Oh cœur de mère comme tu es parfois douloureusement frappé et que de mérites tu entasses lorsque tu acceptes avec résignation ces sanglantes douleurs…
(Ici, j’ouvre une parenthèse pour dire que j’écris ce qui précède le 7 Avril 1939, et que c’est la date anniversaire de la mort de Jacques (16 années). De plus, nous allons retourner habiter cette même maison qui m’appartenait en 1923 et que j’avais vendue. Gabrielle ne sera pas des nôtres quand nous y entrerons à la fin de ce mois. De sorte qu’en l’espace de neuf ans deux des habitants d’Eureka seront partis pour l’autre monde, un monde où l’on ne pleure plus lorsqu’on a trop pleuré et trop souffert dans celui-ci et que Dieu a bien voulu mettre un terme à vos souffrances.)
Jeudi 15 Juin 1939
Je ne saurais mieux faire puisque j’ai parlé plus haut d’Eureka ou Munneville le Burgard, que de continuer sur ce sujet car nous y sommes de retour depuis le 1er Mai 1939. Marie et ses enfants ont été prendre possession de la maison qu’ils ont fait construire dans l’Avenue Farquhar, nous (Jean, Claire et moi) sommes venus occuper Munneville, Rue Brown Sequard.
Meubles et effets ont été remis aux mêmes places qu’il y a neuf ans, on dirait que nous n’en étions jamais partis. Il manque toutefois cette présence de Gabrielle qu’on revoit cependant partout, tant elle vit dans nos cœurs, et à nos yeux. J’ai repris mon ancien bureau dans lequel Jacques est mort en 1923, et j’ai placé dans le panneau où se trouvait son lit trois tableaux de nos trois disparus. Le portrait de Philippe, celui de Jacques, et la grande photographie de Gabrielle, pour que ces objets me remettent à chaque instant en présence des événements déroulés à cette place, le dernier soupir de mon benjamin, la ruelle du lit où sa mère passait tant de jours et de nuits à son chevet priant et pleurant pour obtenir la guérison de celui que Dieu réclamait pour son Ciel.
Ma chambre, vide du grand lit remplacé par le petit lit sur lequel est morte Gabrielle paraît immense, et je me retrouve seul, combien misérable dans cette solitude !
Mes pas résonnent dans ce grand vide, mais rien ne répond aux mystérieux appels de mon cœur. L’écho répond « pitié » comme disait le poète Dayot dans son poème intitulé « Le Mutilé »
Pitié ! oui il faut avoir pitié du malheureux dont la vie est brisée, qui se trouve toujours en face de lui-même privé de toutes consolations parce que la seule créature qui le consolait et le réconfortait dans les jours si mauvais qu’il traverse encore lui a été ravie.
Ce serait injuste de dire que mes enfants m’abandonnent à moi-même, et je ne l’ai jamais pensé; ce que je veux comprendre, c’est que deux âmes unies pour la vie s’imprègnent l’une dans l’autre pour former une seule chose qui subsiste alors en entier. Séparer cette chose en deux, la partie envolée laisse l’autre partie à une instabilité qui ne peut plus être rétablie et ce manque du point d’appui qui était nécessaire à l’âme qui demeure disparaissant, cette moitié de deux âmes court sans cesse vers l’autre par simple attraction.
La tendresse des enfants ne ressemble en rien à l’âme de votre âme.
Il me reste à parler de la Campagne Courchant de Sablons dans l’avenue « Hennessy » et que nous allâmes habiter en quittant la première fois « Munneville » en Septembre 1930 après avoir fait revente de la campagne à Frédéric Rouillard. Louis Koenig, mandataire de Mme de Sablons nous écorcha pendant plusieurs années en comptant le loyer de cette demeure à Rs 100 par mois !..
C’était une très grande maison il est vrai, avec une superficie de terrain de près de 2 arpents mais la maison était délabrée et la cour ne contenait que des goyaviers dont Casimir Nairac qui l’occupait avant moi faisait commerce.
Demeure agréable au demeurant, par la spaciosité de ses appartements et les varangues circulaires qui facilitaient considérablement les services.
De ce fouillis de savane j’avais réussi à faire une cour sortable, avec un parterre et un potager, mais la cour avait cet inconvénient que donnant sur deux avenues, le chemin était ouvert à tous les voisins et amis de connaissance qui nous demandaient l’autorisation de traverser devant le perron pour raccourcir leur route.
Existence normale menée là pendant cinq ans. En 1935, à la mort de Joseph Koenig, (Mai/35) je proposai à ma fille Marie de venir habiter chez nous pour alléger ses frais et elle vint avec ses sept enfants jusqu’à notre départ commun. (1939).
C’est alors en 1935 que progressivement la santé de ma bonne Gabrielle s’altéra sensiblement. Elle traversa les jours dans un long martyr qu’elle supporta avec un courage et une résignation vraiment admirables. Elle sentait que Dieu lui envoyait une croix lourde à porter mais qu’elle ne devait pas refuser parce que c’était pour elle le moyen d’acquérir les mérites sans nombre qui lui donneraient le droit de dire aux portes de l’éternité : « Mon Dieu voyez mes mains, elles sont pleines des bonnes œuvres que vous exigez pour le salut des âmes, j’ai prié, j’ai souffert à votre exemple et j’ai tâché de ne jamais me plaindre des maux qui m’ont frappé. Vous avez fait de moi ce que vous avez voulu et j’ai accepté toutes les peines de la vie » Et Dieu dans sa grande miséricorde, dans son infinie bonté et dans sa justice n’aura pas longtemps différé l’entrée de sa belle âme dans son éternelle lumière. C’est là qu’elle habite désormais compatissante à nos pauvres misères, elle qui n’a plus les siennes et qu’elle nous attend tous un jour !
15 Août 1939 Mardi
Car elle a beaucoup souffert sur la terre. Non sans mon affection ou sans celle de ses enfants et de ses proches qui ne lui ont jamais fait défaut, mais elle a souffert de voir le monde irréligieux, pervers, égoïste, impie !… Les chemins tortueux offensaient sa droiture et toute l’offense faite au Beau et au Bien l’offensait elle-même. Elle souffrait du manque de pitié et de charité, elle qui se dépouillait volontiers pour soulager une misère et ne comprenait pas l’insensibilité des cœurs fermés à toute générosité.
Enfin elle a souffert physiquement dans une grande mesure: sa vue, à la suite d’opération d’une double cataracte devenait de plus en plus mauvaise ; elle était privée de son grand plaisir d’écrire et dût abandonner toute correspondance dans les derniers dix-huit mois de son existence et ce fut pour elle une grande douleur de ne plus pouvoir écrire à ses enfants absents du pays.
Puis ce fut le tour de la locomotion; une grande faiblesse des jambes lui causait souvent des chutes dont elle se relevait meurtrie mais sans proférer de plainte encore que cet état de chose lui causait du chagrin. Elle souffrit alors de ne plus pouvoir aller à l’Eglise assister aux Messes et faire ses longues prières à genoux. C’est alors que je m’entendis avec le Curé de St Jean, le Père Demaison pour qu’il lui porta la Sainte Communion une fois la semaine. Et c’était fête religieuse alors tous les lundis lorsque dès l’aube le branle-bas commençait dans la maison pour préparer dans la chambre un autel digne de recevoir le divin visiteur qu’elle accueillait avec toute la foi et la piété désirables.
La médication suivie dans sa dernière maladie fut pénible et douloureuse et là encore elle souffrit de son incapacité à se mouvoir librement, de supporter les heurts et les secousses de nurses un peu rudes pour les applications de ventouses, de piqûres, d’enveloppements et de sondages etc
Elle fut par contre entourée de dévouement précieux de ses enfants; Claire fut une bonne garde malade et Jean fut le plus précieux des infirmiers. Il la distrayait de son mal en lui tenant assidûment compagnie, l’intéressant de sa conversation, la faisant manger quand elle rechignait à le faire, l’aidant dans sa marche quand elle voulait à tout prix se déplacer, la menant à l’air lorsque le temps le permettait.
Toutes ces souffrances devaient avoir une fin avec la permission du Bon Dieu, qui jugeant que la mesure était « pleine, passée bien remuée » mit fin à toutes ses angoisses à toutes ses douleurs à toutes les larmes qu’elle versait constamment après de constantes prières, pour lui permettre de s’endormir dans Sa Paix.
23 Août 1939
Huit mois aujourd’hui de la mort de Gabrielle … J’ai raconté au début cette mort dont le navrant souvenir se dresse aujourd’hui devant nous et dont rien ne nous distraira jamais plus. Ma vieille tête blanche se courbe sous le poids d’une si grande douleur et ne se relèvera que pour chercher au Ciel celle qui me fera connaître que nos prières et nos supplications lui auront enfin ouvert ce séjour et qu’elle a demandé à Dieu une place, toute petite place auprès d’elle là-haut pour moi qui en ai occupé une si grande dans son cœur pendant sa vie terrestre.
La veillée mortuaire fut digne de l’affection que tous lui portaient. Parents, amis, simples connaissances, humbles serviteurs tous sont venus répandre leurs prières autour de sa funèbre couche et protester devant Dieu de sa grande sainteté et de son immense charité.
Vers le matin du 24 Décembre on la déposa dans son cercueil qui fut transporté de sa chambre au salon en traversant mon bureau et le cercueil resta ouvert jusqu’au jour. Elle avait été habillée du grand scapulaire du Tiers Ordre dont elle faisait partie, et portait le voile noir de la profession. Sous cet aspect, je la revoyais telle qu’elle se montrait toujours aux réunions qui avaient lieu mensuellement dans la Chapelle du Couvent de Belle Rose (Bon Secours) récitant l’office ou écoutant les Conférences qui s’y faisaient.
Ce qui me brisa le cœur avec le plus de violence fut de voir cette physionomie si douce me retracer dans sa mortelle rigidité le « film » entier des cinquante-deux années de notre commune existence avec toutes ses péripéties, ses souvenirs, ses douces joies, ses épreuves, ses luttes vaillantes, tout le rappel des jours heureux que Dieu nous avait consenti. Ce lien qui nous unissait était rompu là sous mes yeux et les morceaux qui gisaient devant moi qui criais intérieurement de désespoir de ne pas pouvoir empêcher un si mystérieux abandon.
Comment ne pas passer le reste d’une existence qui elle aussi s’achèvera bientôt, à revivre tout le passé qu’on a vécu à deux et à ne plus vivre que pour ce passé. Rendu à un certain âge, il faut faire abstraction de l’avenir qui n’existe plus pour vous et s’arrêter sur la route, à la barre où vous avez vu disparaître votre compagne, l’attendre, et si elle ne revient pas l’implorer, l’appeler jusqu’à ce que par la grâce de Dieu elle revienne vous prendre par la main pour vous faire monter les degrés des célestes parvis…
7 Septembre 1939
Nous étions deux jusqu’ici à compter nos années de mariage et en avions compté 52 le 7 Septembre de l’année dernière
Aujourd’hui seul et triste j’en ajoute une au nombre de celles écoulées et je pleure en pensant que Dieu a voulu qu’il en soit ainsi.
Quel autre moyen de nous réunir tous les deux mystiquement, si ce n’est de nous confondre en Dieu par la prière, et par la réception pour moi de la Sainte Communion qui me rapprochant de Dieu, me rapproche aussi de celle qu’il m’a ravi ? Cheminant pieusement ce matin vers l’Eglise du Rosaire j’ai prié pour elle en lui demandant de prier pour moi si abandonné maintenant; et en rentrant à la maison j’ai promené dans le jardin de mes souvenirs sentant qu’elle était à mes côtés, m’encourageant à la résignation et m’assurant qu’un jour bientôt peut-être, nous ferions ensemble le parcours d’une route infinie sous l’œil et dans la bénédiction de Dieu !
Je me reporte en pensée à ce 24 Décembre de l’année dernière au moment de son départ définitif de la maison. Au milieu d’une foule de parents, d’amis et de connaissances, mes petits-fils enlevèrent le cercueil du salon et le portèrent jusqu’au bas du perron de la varangue d’où les porteurs funèbres l’emportèrent.
Close dans sa prison de chêne et de plomb elle traversa l’allée qui conduit à la grande route insensible aux parterres et aux fleurs qui lui disaient adieu…. Pour toujours et nous prîmes la route de St Jean suivis par cette longue file d’assistants aux cœurs émus.
La cérémonie religieuse fut grandiose; l’Eglise tendue de noir, les bancs déjà occupés par ses sœurs Tertiaires de St François d’Assise, plusieurs prêtres dans le chœur où on plaça la bière. Une grand-messe de requiem fut dite et les chants liturgiques accompagnés par l’orgue ont bien fait voir combien la Pompe religieuse est émouvante dans ses manifestations. On courbe la tête dans ces moments-là, on pleure, on prie. Dieu voit ces larmes; il entend ces supplications. Il comprend nos douleurs. Il nous met l’Espérance au cœur et nous promet l’immortalité, et sa bonté nous console, et nous fait des résignés. Espère donc, O mon cœur, crois ô mon âme !…
On se dirige ensuite vers le cimetière: une simple fosse reçoit bientôt la dépouille de celle qui occupa toute ma vie et la froide terre la recouvre l’isolant bientôt du reste du monde et mettant entre elle et moi cette distance infinie qui sépare la terre du Ciel, son corps mortel de mon pauvre cœur meurtri…………
Le pauvre tertre visité le lendemain, encore couvert des nombreux bouquets dont la flétrissure va bientôt s’emparer ! C’est sous ce tertre que repose à jamais celle que je voudrais tant revoir pour l’avoir tellement aimée. C’est là que je vais venir aussi souvent qu’il me sera possible lui parler le seul langage qu’elle comprend désormais, le langage de la prière.
Mon Dieu ! faites que je sache la parler cette langue en employant les termes que vous acceptez de façon que vous sachiez bien que je vous parle de ma compagne disparue, que je vous demande de la recevoir dans votre beau Ciel et que vous en preniez grand soin, pour la rendre à mon amour dans votre amour lui-même…..
Une poésie d’André Rivoire que j’ai lu ces temps derniers et que je fixe dans ce Recueil m’a incité à en faire une adaptation qui répond à un état d’âme dans lequel je me suis trouvé en en faisant la lecture et qui s’applique parfaitement à mon sentiment. Je l’intitule :
A son âme
Dans le Ciel où tu es, songe à ce qui fut nous,
Revois de si haut ma tendresse à genoux
Mes yeux levés vers toi, qui t’ont si bien connue,
Mes mains qui malgré moi ne t’ont pas retenue
Ma poitrine où ta tête aimait à se poser ;
Tu te rappelleras ma bouche et mon baiser
Mon sourire triste, mes battements du cœur
Qui mêlés aux tiens formaient notre bonheur…
Aux heures de vieillesse ou le présent n’est rien
Je me recueille et cherche en mon cœur ancien ;
Je recommence à vivre un peu toute ma vie ;
Je me blottis le soir, t’y voyant endormie,
Dans ce nid du passé, tendre et délicieux
Et des pleurs sans nombre coulent de mes yeux.
Je vois passer ton ombre, seul vivant souvenir
Des bonheurs passés que je n’ai pu retenir
Et ma prière monte au plus profond des cieux
Pour qu’un jour nous soyons réunis tous les deux :
Toi, que la mort cruelle arracha de mon cœur,
Moi, dont l’âme est remplie d’une grande douleur !
GT
10 Octobre 1939
La Guerre !… une nouvelle guerre commencée le 3 Septembre se poursuit actuellement en Europe.
Il y a 25 ans mes deux fils, Emile et Jean partaient pour France appelés à sa défense contre la même ennemie qu’aujourd’hui : l’Allemagne. Demain après-demain peut-être Jean partira de nouveau rejoindre sa classe (1911) et se mettre à la disposition des autorités pour une participation quelconque à la force nationale française qui doit vaincre le sanguinaire Hitler, spoliateur de la Pologne et qui veut maintenant se retourner contre les armées alliées qui combattent sur la frontière et sont même entrées en territoire allemand.
Notre nombreuse famille qui se composait naguère de treize membres est aujourd’hui réduite à mon foyer particulier à trois personnes (Jean Claire et moi) et lorsque Jean se sera embarqué dans deux jours nous ne serons plus que deux à la maison…
Deux seulement ! et lorsque appelé en Ville pour mon travail aujourd’hui bien réduit Claire sera seule à la maison. Comme elle ne peut pas rester seule en face d’elle-même, elle ira chez sa sœur Alice qui habite à deux pas de chez nous y passer ses journées et attendre mon retour l’après-midi de sorte que la maison sera vide de ses habitants.
Vide, cette demeure si pleine autrefois ! vide et confiée à la garde d’une femme de chambre qui se tient chez elle dans une dépendance tout le jour.
Quel revirement dans l’existence d’un homme si entouré de se voir triste et solitaire au milieu d’appartements fermés, vivant de ses tristes pensées et de ses poignants souvenirs… n’est -ce pas là une mort anticipée ?
12 Octobre
Jean ne partira pas maintenant. Il a des difficultés avec le Consulat de France et a été obligé de produire un certificat du Dr Henri Levieux qui justifie d’un délai de départ. Quand je ne sais.
Mais le Courrier me porte une lettre de Joseph datée du 1er Septembre dernier. Il est mobilisé et partira le 7 pour son dépôt à la Rochelle et de là je ne sais où ? Il est plein de courage et devait conduire sa femme et sa belle-mère à Chateauroux dans l’Indre pour les mettre à l’abri des accidents de guerre puis gagner la Rochelle. Que Dieu le garde, le pauvre enfant.
Caselà (Elégie)
Case Là ! doux souvenir d’une époque lointaine,
Patrie où habitaient l’amitié et l’amour,
Qu’a fait de tes lieux le temps, ce grand vautour
Qui détruit les demeures et les nids dans la plaine
Et ne laisse debout ne pouvant l’engloutir,
Que le cher souvenir qui lui ne peut mourir ?
Plus d’un demi-siècle s’est abattu sur toi
Ravageant tes bosquets, ta source, ta colline,
Les sentiers par lesquels nous passions, elle et moi,
Les arbres qui donnaient leur ombre grise et fine
Et dont les troncs inertes aujourd’hui dévêtus
Offrent leur nudité à nos regards émus !
Je reviens à toi avec toute ma peine ;
Moi aussi j’ai perdu celle que tu vis un jour
Près de ta claire source me dire son amour.
Moi aussi j’ai vieilli, comme toi l’âme pleine
Du regret d’être seul maintenant à gémir
Sur la pauvre cité et sur son souvenir.
Evoquant le passé je vous revois tous deux,
Et des pleurs doucement coulent de mes yeux.
GT
16 Octobre 1939
Je retrouve ce qui suit dans notre petit carnet de nos fiançailles, écrit de la main de Gabrielle à la date du « Vendredi 18 Juin 1886, 4½ heures :
« Ami ce sera la 1ère fois qu’à Casela vous lirez l’expression de mon amour. Oh ! Cher, que j’ai envie de revoir avec vous ce cher Case-là, cette source où j’ai entendu vos premières paroles de tendresse !… Que j’ai envie de me retrouver partout là-bas où votre cœur a battu pour la première fois pour moi !..
Mon bien aimé, si vous allez à la source, rapportez m’en une petite fleur, un brin d’herbe… et donnez votre plus tendre pensée à votre Gaby qui vous aime plus que tout au monde »…….
On comprend bien dès lors que ce si doux souvenir m’ait inspiré l’élégie ci-dessus qui reflète tellement tout ce que mon cœur et ma mémoire conservent de ces heureux jours hélas ! évanouis dans l’ombre du passé.
2 Novembre 1939
C’est la « Fête des Morts » ! C’est la fête à ma Morte,
Encore qu’une année ne soit pas écoulée
Depuis le triste jour où dans son envolée
Ton âme sainte a fui en franchissant la porte
De ma pauvre demeure où je gisais en pleur,
Secoué de sanglots et criant ma douleur.
Tu partis me laissant ta dépouille glacée
Que j’ai fait déposer sous une froide pierre
Là-bas, où déjà dorment en leur nuit effacée
Nos enfants disparus, tes frères, puis ton père
C’est là qu’à tout instant mon pauvre cœur m’entraine
Pour être rapproché de ton âme lointaine.
J’ai cueilli les roses de notre beau jardin
Pour en faire une gerbe qu’au long du grand chemin
Qui conduit jusqu’à toi j’arroserai de pleurs
Pour qu’elles soient plus belles mes chères fleurs,
Et te disent que ma pensée ne peut mourir
Car elle garde toujours ton cher souvenir.
Prends alors mes fleurs pendant que Dieu daigne
Entendre la prière de mon cœur qui saigne ;
C’est la « Fête des Morts », c’est ta fête ô ma Morte
Que le Ciel aujourd’hui t’ouvre grande sa porte.
GT
Samedi 24 Février 1940
Quatorze mois écoulés hier depuis la mort de Gabrielle. La Messe du 23 a été dite au Rosaire, et celle de ce matin 24 à St Jean par le P. Nadon curé. Nous avons d’abord passé au cimetière déposer sur son mausolée nos prières et nos fleurs.
Après la Messe, les enfants sont retournés en auto à la maison et moi je me suis à pied dirigé vers la Chapelle du Couvent de Bon Secours (Belle Rose) qui est celle de la Fraternité du Tiers Ordre de St François, pour assister à une réunion de cette Fraternité présidée par le Visiteur de l’Ordre, le P. Sheitoher, supérieur des O.G. du St Esprit à Maurice.
Lorsque j’eus franchis l’entrée du Couvent qui donne sur la grande route, l’émotion s’empara de moi au souvenir du temps passé maintenant où notre auto Buick nous y transportait à l’occasion des réunions mensuelles et je gravis cette allée rocailleuse et montante ou si souvent nous avions passé tous deux jusqu’en Janvier 1933 ! où l’infirmité a commencé à s’emparer de ma douce compagne et où il n’a plus été possible d’accomplir cette pieuse cérémonie et cette consolante dévotion.
Mon émotion grandit lorsque je pénétrai dans la chapelle et que j’allai me mettre dans le 3ème avant dernier banc à droite, sous la fenêtre, dans lequel nous étions toujours agenouillés l’un à côté de l’autre, priant l’un et l’autre et l’un pour l’autre !…
Ma prière pour toi, ô ma disparue est sortie de mon cœur, est sortie de mes lèvres montant au Ciel pour qu’il te soit clément et Dieu l’a certainement entendue.
Mais ta prière à toi pour le solitaire maintenant, je ne l’ai point entendue ?… Si je ne l’ai point entendue, j’ai bien senti en mon âme cette vibration qui l’agite un instant, puis la plonge dans un calme religieux qui révèle une communication entre le Ciel et la Terre, entre l’âme envolée et l’âme encore prisonnière.
La paix dont tu jouis sûrement maintenant a pacifié mon cœur, a pacifié mon âme, car tu as demandé à Dieu de venir en aide à ma résignation !…
A cette douleur de l’âme Française qui habite en moi se joint l’autre douleur d’un cœur de Père, qui s’émeut de savoir ce qu’est devenu son fils dans cette grande tourmente. Joseph, où est-il ? que devient-il ? S’il avait été repris au Service après ses 6 mois de réforme temporaire, il était aux armées, dans l’Artillerie lourde dans les lignes de combat ou bien dans la ligne Maginot. Je suis sans nouvelles de lui et de sa femme depuis trois mois. Est-il vivant ? prisonnier ? libre mais en pays occupé ? Car il habitait Courbevoie dans le voisinage de Paris et que toute la France du Nord jusqu’à l’Oise est occupée par les Vandales. Quelles sont les conditions de son existence, pauvre diable, et quand connaitrai-je son sort ?
Je bénis le Ciel que Jean ait rencontré des difficultés de départ à l’époque où sa classe a été rappelée autrement il y serait aussi, dans cette fournaise ardente qui s’appelle la domination allemande.
Dimanche 14 Juillet 1940
« Quelle joie de songer que l’anneau d’or de la prière nous unit toujours à ceux « qui dorment dans le Seigneur », et que nous pouvons toujours leur parler, et prier pour eux ! »
Cardinal Gibbons (La Foi de nos Pères).
Ecoute ! entends ma voix, elle est douce et profonde.
Elle vient de mon cœur qui fut toujours à toi,
Pour redire sans cesse un refrain plein d’émoi
Que tu dois entendre, là-bas, dans l’autre monde !
Puisque pour se parler il faut que l’on soit deux,
Redis à mon oreille qui se tend vers le Ciel
Les paroles si douces et que j’entendrai mieux,
Que ta chère tendresse me versait comme un miel.
Causons alors, veux-tu ? et de toi et de moi.
De ton âme envolée et de sa destinée,
De ton triste abandon et de tout mon effroi
De penser que toujours ma vie en sera peinée…
Mais tu ne réponds pas ! Tu dors dans le Seigneur;
La paix règne en ton âme, alors que la mienne
S’agite et reste encore dans l’amère douleur
De n’être point unie tout à fait à la tienne.
Dieu veut que ce qu’il a réuni sur la terre
Ne soit pas désuni. Il faut qu’alors un jour
Ce désir s’accomplisse en sa céleste sphère
Et que je dorme aussi en Lui à mon tour,
Pour nous réveiller à la fin de tous les temps
Dans sa grande lumière et dans sa Charité,
Tous deux ressuscités dans l’Immortalité
« Beate qui dormiunt in Domine »… Amen !
GT
9 Janvier 1941 (Jeudi)
L’âme est parfois chevillée au corps, et l’on s’étonne, après une grave maladie, de voir que « petit bonhomme vit encore » et qu’au lieu du repos que l’on croyait prendre éternellement il faut recommencer, ou continuer à lutter pour finir cette existence qui en somme n’a été qu’une lutte perpétuelle contre les coups du sort…
Il y a eu quatre mois le 4 Janvier que terminant ma besogne en Ville à mon bureau (le 4 Septembre 1940) je me suis senti tout à coup un chatouillement dans la gorge, comme une envie de rejeter des flegmes et que j’expectorai une gorgée de sang vif du plus beau rouge. Inquiet, je me mets debout et me dirigeant vers la fenêtre de mon bureau je continue à rejeter du sang… L’anxiété s’empare de moi et je me demande ce que cela pouvait bien être. Je ferme mes affaires et me dirige vers la Place d’Armes, prendre un taxi pour retourner à Quatre Bornes.
Rendu chez moi, je dis à Jean de téléphoner à un Médecin de venir me voir de suite. Duvivier n’ayant pas le téléphone chez lui, c’est Arthur de Chazal qui arrive vers une heure p.m. Il prend ma tension artérielle qui marque 24 ! chiffre exagéré parait-il et qui expliquait l’hémophysie qui s’était produite. Arthur me fit alors une piqure de morphine au bras et une injection de citrate de soude à la jambe droite pour coaguler le sang et arrêter l’hémorragie. Il me fit une seconde visite le lendemain puis me dit : si vous avez besoin de moi, faites-moi savoir.
Cet accident se termina rapidement et quinze jours après je quittais le lit et m’habituais progressivement à refaire ma personnalité pour retourner à mes occupations lorsqu’un fait nouveau vint m’obliger à me remettre au lit pour un long temps.
En effet une « phlébite » se déclara à ma jambe gauche qui me cloua au lit pour un mois et demi dans l’immobilité absolue de cette jambe encadrée de sacs de sable et dus prendre une « nurse » (Mlle Delaire) pendant quinze jours à six roupies par jour, puis une « garde » (Mme Elysée) pendant 25 jours à Rs 2 par jour…
La médication était cependant bien simple: repos absolu, fomentations chaudes sur la jambe. Régime : sans sel, pas de viandes, pas de café, pas de cigarettes, rien de ce qui fait apprécier l’existence.
Au bout de 45 jours de lit je descendis de ma couche pour me rendre compte que lorsque les membres d’un corps ne s’exercent pas ils s’atrophient. J’eus mille peines à me tenir debout et soutenu par mon entourage je me jetais dans un fauteuil pour y passer quelque courts moments.
Jours après jours les forces revinrent avec parcimonie et traînant la jambe et le corps je fis une rééducation des mouvements et me servis d’une canne comme appui. Enfin je pus « mettre le nez dehors » après 3 mois de claustration et à l’heure où j’écris je n’ai pas encore pris la grande bordée et me demande si je retrouverai jamais ma belle santé d’avant ma maladie.
Je suis sorti une ou deux fois en auto pour aller voir Mina à la Réparation, faire une visite au cimetière et assister à une petite fête anniversaire du mariage de Lili et de Pierre chez eux.
Quels enseignements retirer de cette longue épreuve et quels avantages obtenus au profit de ma sanctification ?
D’abord Dieu m’accorda la vertu d’humilité. Oh ! Oui, ce fut une humiliation que j’acceptai d’ailleurs de voir l’état misérable où je fus plongé, dépendant de tous pour les soins, la nourriture, les moments de douleurs. Puis ce fut la vertu de patience, parce qu’il fallait accepter la Volonté de Dieu qui m’avait placé dans l’état d’incapacité d’agir pour un long temps et qu’il fallait supporter sans murmurer toutes les tribulations qui m’échurent et que sans révolte et sans mauvaise humeur je dus subir. Enfin ce fut une vertu de justice, parce que je dus rendre à chacun de ceux qui s’occupaient de moi, matériellement et moralement, les mérites qui leur revenaient : dévouement, charité, bonté de cœur, chacun en fut remercié.
Le souvenir de ma vieille compagne qui au temps où elle n’était pas elle-même accablée par l’infirmité aurait trouvé la force nécessaire pour me prodiguer ses excellents soins auxquels elle m’avait habitué toute sa vie, me fut un point d’appui pour supporter ma maladie et je suis persuadé que me voyant si malheureux dans la maladie, elle aura prié Dieu d’alléger mes souffrances ou de les accepter pour mon salut.
Les “ secours de la Religion“ m’ont aussi été prodigués: le curé de N. D. du Rosaire, le père Guérin est venu plusieurs fois à mon chevet, entendre mes confessions et me porter la Sainte Communion. Ces saintes cérémonies me renvoyaient à deux années en arrière, où le Père Demaison venait tous les lundis porter la Sainte Communion à Gabrielle, moi faisant office de servant pour la visite du Bon Dieu chez moi. Comme l’histoire se répète, et que la vie ressemble à elle-même. Dieu est immortel et immuable, il n’y a que les hommes qui changent et à qui il faut faire comprendre que la bonté du Maître est toujours là, à la disposition de ceux qui l’aiment et veulent le servir.
Tertiaire de St François d’Assise, j’aurais été malheureux si j’avais été l’objet de l’indifférence des autres tertiaires pendant mon temps d’épreuve. Mais il n’en fut pas ainsi.
La sœur Thérèse du Cœur de Jésus (Mlle Thérèse Olivier) vint me voir et s’entretint avec moi de choses saintes. Elle me porta quelques pieuses prières et m’envoya ensuite des brochures et une Vie de St François qui me tinrent longtemps sous un charme religieux par les saintes lectures que j’y fis.
Enfin je pus sortir et même aller une fois à pied à l’Eglise du Rosaire le jour de Noël. Mais ce ne fut pas sans fatigue et je préfère encore pour le moment user de la charité d’Alice ma fille qui vient me prendre en auto les Dimanches pour aller à la Messe à laquelle j’assistai jusqu’ici dans la Sacristie, et que depuis 3 semaines je suis dans mon banc.
PENSEES
26 Janvier 1940
Je transcris ici les pensées que j’ai récoltées de mes lectures pendant mes 5 mois de maladie et de convalescence et dans la suite :
15 Octobre 1940 : Montre-moi tes chemins Seigneur et enseigne moi la perfection de tes sentiers. (Vie de St François d’Assise)
21 Octobre 1040 : Quelle netteté dans la foi des enfants :
« Ils suivent leur père ils aiment leur mère, ils ne souhaitent nul mal au prochain, ils ignorent le souci des richesses; nulle envie, nulle haine, nul mensonge, ils croient ce qu’on leur dit et font confiance à qui leur parle ! Hâtons-nous donc de revenir à la simplicité des tout petits, car si nous y parvenons, nous rayonnerons tout alentour l’humilité même du Sauveur » (S.Hilar) (Par les sentiers du Maitre).
21.10.40
« Ah ! Quelle force étrange et quelle intime consolation transformerait en invincible espoir nos agonies les plus solitaires si de notre âme d’enfants de Dieu, nous restions convaincus de l’éternelle rencontre dans la Maison du Ciel ou l’on ne meurt plus !
Car la souffrance de nous séparer ainsi de nos bien aimés, l’amertume de nos inquiétudes à les savoir loin de notre vigilante affection, s’apaiseront en une confiante prière si nous songeons à la Bonté de Notre Père dont le tout puissant amour veillera sur eux jusqu’à l’heure bénie du revoir au cher foyer humain ou dans l’éternelle demeure de l’au-delà.
Oh ! ce regard de ceux qui vont mourir !… Regard synthétique sur notre vie qui va s’achever, regard de joie pour la tâche accomplie…, de douleur de remords au souvenir des faiblesses trop nombreuses et des erreurs coupables… regard de confiante espérance vers l’au-delà qui se rapproche !
- de la Chevasierie S.J. (Par les Sentiers du Maitre).
23/11/40 – « Qui d’entre nous n’a pas reçu sa croix ? Et sur le chemin de nos pas, en plus d’une circonstance déjà ont dû laisser sur le sol que nous foulons leur trace sanglante. Souvenons-nous… Croix que nous imposent nos relations forcées avec ce prochain de notre famille, de notre groupe de nos apostolats : Croix de nos inquiétudes pour la santé de cet enfant malade, de ces parents âgés; croix de l’insuccès réel ou imaginaire; souffrance des âmes qui ne répondent pas à nos soins, qui nous déçoivent ou qui se moquent.
Et croix dont nous sommes à nous-mêmes l’occasion ou la cause: blessure d’amour propre, angoisse pour les forces qui déclinent, pour notre vue qui baisse, pour nos mains qui tremblent, rude croix de l’impuissance, de l’immobilité de plus en plus complète, alors que d’immenses désirs nous dévorent, renouvelés à chaque aube nouvelle et déçus au retour des crépuscules dont les ombres nous étouffent.
Mais que dire des Croix de l’âme telles que le Seigneur notre Père du Ciel nous les offre ou nous les impose pour notre plus grand bien ? Sécheresse, ou torpeur dans nos plus ferventes prières, poursuite du remords qui de jour et de nuit voudrait notre plus ferme espoir; tentative de lassitude et de découragement devant l’inutilité de nos plus persévérants efforts: terreur de Dieu et de ses jugements de son au-delà ; nuits sans étoiles, interminables jours de désert sans ombre, peur, écœurement du « moi », de notre passé ; dégout du présent, épouvante de l’avenir, loin du Dieu qui fortifiait notre jeunesse.
Oh ! Croix de l’âme tous ceux qui les ont connues n’en parlent qu’avec un frisson dans la voix, à moins qu’ils ne se hâtent de détourner leur attention vers un autre sujet moins intime et moins douloureux. R.P. Chevasnerie S.J. « Par les Sentiers du Maitre ».
5/11/40. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ou vos voies mes voies. Autant les Cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pensée empruntée d’Isaïe par St François.
« In manus tuas commendo »
7/11 Les souffrances comme les joies terrestres ne sont que les incidents du pèlerinage ; ce qui importe, c’est d’être prêt, toujours prêt, pour la minute terrible. De Rosny.
12/11 « Taisez-vous ! Il ne faut pas canoniser les hommes tant qu’ils peuvent se damner ! » St François d’Assise.
Pour un esprit averti, notre forme représente nos habitudes physiologiques et même nos pensées ordinaires; à notre insu, notre visage se modèle peu à peu sur nos états de conscience ; on peut y lire non seulement l’intelligence ou la stupidité, mais aussi les secrets, les affections les plus dissimulées. L’âme se montre à fleur de peau…
Dr Carlos d’Echevannes, du T.O.
21/11 Que je plains ceux qui n’ont pas la foi ! Comment vivent-ils avec leurs morts ? Et ne pas vivre avec ses morts, c’est ne pas avoir de famille. Paul Bourget (L’Etape).
11/12 Les femmes n’ont été mises par Dieu auprès des hommes que pour les chérir, les plaindre, les consoler ! Georges Ohnet.
22/12 On ne supporte les pires douleurs qu’avec ceux qui les partagent.
26/12 « Le premier endormi a frayé la route pour que le survivant n’ait pas peur du sommeil éternel. » F. Maurice.
30/12 La vieillesse est la Sainteté du visage. Lamartine.
8/1/41 Ne faut-il pas souvent l’irréparable – la mort ou la séparation définitive – pour nous révéler la grandeur de nos sentiments ? Nous marchons dans la vie sans bien connaitre notre cœur et c’est la souffrance qui nous fait évaluer d’un seul coup l’étendue de nos pertes. H. Bordeaux (Le Pays Natal).
16/1 N’oubliez pas que la bonté de Dieu nous ménage un lendemain de la vie, et que dans cette vie même il peut y avoir plan pour le bonheur. Sachez aimer ce que vous devez aimer, oubliez le reste. Pierre Mahel.
Rien n’est grand comme la passion d’un honnête homme…
21/1 Il faut dans ce monde prier et souffrir, prier et pardonner, prier et mourir ! O. e Ravignau.
Tout ce qui a été senti en commun devient souffrance, lorsque l’on est seul à le sentir de nouveau… Extrait du Journal de Gabrielle du 29/2/1908 !
Réjouissez-vous… Vous êtes vieux vous êtes plus près de moi. Je vous attends… Je vous attends dans les profondeurs de Dieu. Nous qui nous sommes tant aimés, nous serons à jamais l’un près de l’autre. Et rien ne pourra plus nous séparer, rien !
4/2/41 Sortez de vous-mêmes. En vous-mêmes vous vous perdez. H. Bordeaux.
5/2/41 Un criminel peut expier son crime peut-être: il n’a jamais pu l’effacer.
7/2/41 Je crois ce que les Saints ont cru; ce qu’ils ont espéré, je l’espère. J’ai la confiance de parvenir aidé de la grâce là où ils sont parvenus.
21/2/41 L’âme est un esprit; le bonheur qu’il lui faut n’est donc pas placé dans la fange des sens: il est plus élevé, plus grand, plus beau, il est spirituel. Les sens y participeront sans doute, mais à condition qu’ils seront soumis à l’âme au lieu de la dominer et que dans cette lutte de la loi des membres contre la loi de l’esprit dont parle St Paul que ce soit la loi de l’esprit qui triomphe. J. Etchevery (S.J.)
12/3/41 « On aime la France pour sa raison, pour sa sagesse, sa gaieté parce que comme l’a dit Bazin, ce pays est le premier qui soit sorti de la barbarie et celui qui y est retombé le moins souvent, parce que la France est le seul pays ou le soleil sache rire sur une terre d’harmonie. »
18/3/41 Je la revois lorsque je soupire,
Sourire
Comme autrefois. Est-ce ton esprit
Qui me regarde et sans rien me dire
Sourit ? Vega
20/3/41 Tout homme doit travailler selon ses capacités et gagner selon ses besoins.
28/3/41 Les douceurs de l’enseignement du Maitre, l’amertume de sa mort, la gloire de sa résurrection. (Quo Vadis ?)
3/4/41 O ma bien aimée, vivre ensemble adorer ensemble le doux Seigneur, et savoir qu’après la mort nos yeux s’ouvriront encore comme après un heureux rêve, à une nouvelle vie !.. (Quo Vadis)
27 Janvier 1941
« Nessum maggiore dolore
Che recordarse del tempo felice
Nello miseria »…..
J’ai écrit cette pensée du Dante dans l’album de Gabrielle jeune fille il y a 55 ans, ne me doutant pas alors combien elle est toujours vraie, et combien de fois dans le cours de ma vie elle devait me revenir à l’esprit et me faire vérifier combien le grand poète Italien sentait profondément ce qu’il avançait avec raison, en dépit de la réfutation qu’en a fait Alfred de Musset dans de très beaux vers :
Non, il n’y a point de plus grande douleur que de se souvenir d’un temps heureux dans les jours malheureux !
A propos de quoi ?… tout simplement d’une promenade qu’Alice et Xavier m’ont proposé de faire en auto. Ils m’ont demandé ou je voulais aller; depuis le matin je pensais à Caselà me disant que si je pouvais me payer une auto je ferais volontiers le pèlerinage vers ce lieu que je n’avais pas revu depuis près de cinquante ans et qui m’attirait aujourd’hui sans que je puisse penser voir se réaliser mon ardent désir.
Partis vers cinq heures de l’après-midi de Quatre Bornes nous roulons sur la route asphaltée de la Rivière Noire jusqu’à l’entrée de Caselà. On s’engage dans l’ancien chemin qui menait à la maison, mais on dut s’arrêter à mi route les fondrières interdisant de continuer… On descend, et nous faisons à pied le reste du chemin qui est coupé de bosses, de canaux, d’herbes et de brousses. Je marche devant et suis arrêté par un ruisseau rapide couvert de grosses pierres et qui coupe la route; d’où vient ce canal ? D’où vient cette eau ? Que je n’ai jamais connus ?
Je poursuis ma route, et me voici en face de la réalité : Dieu ! où sont toutes les choses que j’avais connues ? Où est la Maison qui abritait de si braves cœurs, qui avait vu mourir d’abord ma sœur Mina en 1887 puis ma mère en 1896 ? Où est le pavillon du père Alfred Koenig où j’ai vu mourir Pierre Koenig le frère d’Henri peu de temps après Mina, en 1887 également, où est le jardin à gauche en regardant la Maison, et dont j’avais fait le plan sur la demande de Mina ! Où est le bâtiment qui servait de salle à manger et qui abritait le Davrinville, sorte d’instrument de musique à tuyaux et soufflet d’orgue et qui faisait de jolis morceaux tant appréciés par tous ceux qui l’ont entendu et dont le meuble (sorte d’armoire à glace) aujourd’hui désaffecté se trouve maintenant dans la salle à manger de Lili et de Pierre, et leur sert de buffet ?
Que mon cœur a saigné quand j’ai interrogé du regard l’emplacement vide où se trouvaient ces maisons et qu’il m’a répondu : Il ne reste plus rien de ce que tu as connu ; si tu veux tout revoir, consulte ta mémoire, rappelle tes souvenirs.
Ce que je fis… et alors « messine maggiore dolore…. » J’ai revu, oui, tout revu : chacun des chers habitants de l’endroit, le cœur de chacun, l’amitié qui nous liait, nos relations de famille. L’âme de mes morts a revécu en moi, je me suis senti imprégné de leur vie surnaturelle, j’ai senti leur bonheur présent qui dominait mon chagrin actuel… J’ai revu cette jeune mère de famille (Mina) s’en allant de ce monde sourde à nos supplications et aux déchirements d’Henri et de ses enfants et plus tard ma mère, si longtemps malade et si abattue par l’implacable mal qui l’enleva. Mon pauvre père dès lors solitaire, si éprouvé par l’absence et qui devait habiter quelques mois encore avec Henri et ses petits-enfants. J’ai revu avec gratitude le dévouement d’Elisabeth, soignant ma mère comme une fille, remplaçant celle qui était partie, Mina. Mon étonnement s’est renouvelé en regardant l’emplacement du Pavillon, de me rappeler la mort rapide de Pierre Koenig que j’avais le matin de sa mort laissé en proie à l’exaltation de la fièvre et qui marchait dans sa chambre, demandant un miroir pour voir disait-il comment mourait un homme, et que j’ai retrouvé 2 heures plus tard mort et déjà étendu sur un canapé en revenant de Médine où j’avais été apporter des nouvelles que j’étais venu chercher à Caselà.
Reprenant courage je m’adresse au gardien de la propriété (un bègue) où se trouve dans le fouillis actuel le sentier qui mène à la Source. Il me montre ce sentier et me précède, Alice, Xavier, Elsie, Marie-Hélène et Patrice me suivent : quel chemin, Seigneur, mène aujourd’hui à la Source et au rondpoint si pittoresques de naguère ! Quoi c’est par là que nous avions passé Gabrielle et moi, retournant justement de cette source dont le clair murmure avait retenti à nos oreilles au moment précis où nos cœurs se donnaient ! C’est ce casse cou rempli de lianes qui entravent ma marche, ces fosses qui manquent de me faire tomber, moi qui relève d’une grave maladie, et dont les jambes sont si peu sures ? C’est cette transformation qui a changé aujourd’hui ces lieux charmants en bassins ou canaux pour capter et conduire l’eau de la Source à l’irrigation des cannes de la propriété Médine ? Vandalisme des hommes, vous ne respectez rien ; vous avez saccagé les vergers de Médine pour y faire passer une ligne de tramway, vous avez abattu la maison d’Osserre ou nous avons passé notre lune de miel pour en faire du bois de chauffage à l’Usine, vous pouvez bien aussi ne rien respecter à Caselà pas même le souvenir et les lieux de nos heureuses fiançailles !
Je poursuis tout de même mon chemin et mon pèlerinage, me voici devant la « Source ». Xavier me fait remarquer que l’eau qui s’en échappe est claire comme de l’eau de roche, ce qui était dès l’origine. La Source bouillonne toujours mais avec moins de vigueur parce que plus élargie peut-être dans la suite des temps. Le Rond Point est là dans l’ensemble mais où est le plan exact de nos serments ? où est le banc sur lequel nous nous assîmes quelques minutes pour ne pas succomber sous le poids de nos émotions ? Rien ne me les fait voir et je suis obligé d’en chercher les traces dans mon souvenir.
Oh ! choses de la terre que vous changez vite aux regard de l’homme, et qu’il faut prendre soin d’avoir bonne mémoire pour conserver en soi un passé, un souvenir que la Nature efface et qui semblent n’avoir jamais existé aux yeux de ceux qui n’ont pas connu, si la tradition n’en est pas faite par ceux qui ont connu et qui la racontent…
Je suis retourné morne et désolé à l’auto qui nous a ensuite menés sur la plage de Tamarin, et l’impression que j’avais par avance éprouvée lorsque j’ai écrit (le 16 Octobre 1939) les quelques vers élégiaques sur Caselà n’a pas été exagérée en aucune façon, et reste l’expression vraie de mon sentiment de toujours.
Mes Mémoires ! 28 Janvier 1941
Pourquoi ne pas les écrire ? Ils en valent la peine quand ce ne serait que pour rappeler mes souvenirs et revivre toute ma vie, puis mes enfants ignorent tout ce qui a précédé leur existence, personne ne les ayant mis au courant des événements qui se sont déroulés avant leur apparition sur la scène du Monde…
Ma naissance, mes premières années :
Je suis né le 7 Avril 1860 à St Denis, Ile de la Réunion (Bourbon) de parents Français. Mon père Alfred était le 3ème fils d’une lignée de 3 garçons et d’une fille, nés de François Amable Toulorge, né à Coutances (Normandie) et de Wilhelmine Mazuel, née du Plain de St Albine et qui naquit à Paris. La mère de Wilhelmine Mazuel (Sophie de St Albine) avait épousé Mr Mazuel, un girondin, pour échapper à l’échafaud en 1793 sous la Révolution Française et était l’amie de Mme de Lamballe qu’on peut voir dans un médaillon conservé jusqu’ici dans ma famille.
Ma mère, Alice de Chazal, est née à l’Ile Maurice et a épousé mon père le 6 Octobre 1858 aux « Cassis » Château de mon Grand Père aujourd’hui disparu.
J’eus trois sœurs : Wilhelmine, née à la Réunion en 1859, qui plus tard épousa Henri Koenig ; Augusta née aussi à la Réunion et qui épousa Alfred Chevreau de Mont Léhu, et Mauricia, née à l’Ile Maurice, morte en bas âge.
La famille de mon père, issue de Normandie, se composait à la Réunion, outre mon grand- père et ma grand-mère de deux frères et d’une sœur: Emile, avocat de Paris qui plus tard entra au Ministère de la Marine, Jules, chirurgien à bord de la Frégate « La Belle Poule » qui avait été chercher les restes de l’Empereur Napoléon à Ste Hélène en 1840, et sur laquelle mon oncle est mort, et dont le corps fut immergé par le travers des iles Acores. Hortense leur sœur, morte en bas âge.
Ma grand-mère Toulorge avait une sœur qui épousa Mr Schneider frère de mon parrain Louis Schneider lequel vint à Maurice avec son fils Eugène (qui travailla à l’Union St Félix en même temps que Michel Koenig mon beau-frère), Marie, qui épousa le Docteur Cardoreau, Julie, non mariée et Adèle épousa Mr de St Félix qui n’était pas parent des de St Félix de Maurémont de l’Ile Maurice.
Notre demeure à Bourbon était sise Rue du Conseil, belle maison à étage à toucher la « geôle » (prison) de St Denis et se composait de 5 pièces au rez de chaussée qui servait aux Officines de mon grand-père, et plus tard de mon père qui lui avait succédé comme pharmacien chimiste, et qui plus tard avait agrandi son industrie en y annexant une fabrique d’eaux gazeuses et une chocolaterie. L’Etage se composait d’une galerie qui traversait la chambre de mon père, le grand salon et tout au fond de la galerie le petit salon ou ma sœur Mina étudiait son piano. A l’intérieur, il y avait : la chambre de ma mère, une 2ème chambre, 1 cabinet et la chambre des enfants, de nombreuses dépendances dans la cour, une étable où se trouvait une vache qu’on appelait « Cafrine » et qui probablement nous donnait son lait à l’époque du sevrage…. Il y avait dans la cour des arbres fruitiers.
Nous avons fait de nombreux voyages de Bourbon à Maurice pour venir voir nos parents des Cassis, de même que les parents de Maurice allaient souvent nous rejoindre à la Réunion. C’est de cette façon que je suis seul à posséder les photographies de mon grand-père Furcy et de ma grand-mère qui avaient posé devant l’objectif pendant leurs séjours à Bourbon alors qu’ils ne s’étaient jamais fait photographier à Maurice.
Ma grand-mère à un de ces voyages m’avait tenu sur les fonts baptismaux dans la Cathédrale de St Denis, et ce fut le Père Peyroux qui me baptisa.
Plus tard à Maurice ma tante Lucie de Chazal voulut avoir une reproduction du portrait de ma grand-mère mais on ne put jamais en obtenir une, la photo étant une daguerréotype qui ne se laisse pas reproduire parait-il. Je confiais à André de Chazal alors à Paris la photo de mon grand-père, il en fit faire des copies et m’en envoya une très bien faite et qui se trouve présentement dans mon salon. Mais je reste toujours seul à posséder le portrait de Grand-mère, ce qui chagrine la famille de Pierre Edmond mon oncle.
Ma grand-mère Toulorge était venue à Maurice pour demander la main de ma mère pour mon père et mon oncle Emile est aussi venu aux Cassis invité par mes oncles Pierre Edmond de Chazal et Rivaltz Chevreau de Mont Léhu qui l’avaient connu au lycée de la Réunion. Il a été gâté et choyé par la famille et à St Antoine, propriété du bon homme Edmond de Chazal au Mapou, les demoiselles en étaient « toquées », on pensait même qu’une d’entre elles Edmée de C. n’aurait pas hésité à se laisser emmener mais mon pauvre oncle devait à quelques temps de là mourir de fièvre typhoïde, jeune encore et si recherché pour son grand caractère.
Mes premières années à Bourbon n’ont pas été très nombreuses. De sorte que je n’ai pas beaucoup rayonné dans l’ile, pas plus que je n’ai connu de personnes et de choses n’ayant passé que cinq années là-bas. Mais tout de même ma mémoire assez fidèle me retrace les lieux que j’ai connus et les personnes que j’ai vues.
Pour ce qui est des personnes, je vois les connaissances de mes parents : Madame Pajot, Mr et Mme Tomei, les Gaubert, Léonce Popé et sa femme, leur fille Valentine amie de ma sœur Mina et Loulou mon petit camarade. Mr Séhneirès et ses filles, son fils Eugène jeune lycéen. Mr et Mme Nègre. Les élèves et employés de mon père : Hery, Le Roy, Grosset qui est venu travailler plus tard avec Henri Koenig à Wolmar et qui est mort ici.
C’est Emille Le Roy que mon père envoya un jour en bateau à voile arrivé de Maurice avec Mr et Mme de Malartic (fille de ma tante Félicie Le Vieux) qui devaient faire un séjour à Bourbon et à qui mon père avait donné leur signalement. Le Roy retourne à la maison et répond à mon père qui lui demande s’il a fait débarquer Mr et Mme de Malartic : mais non Monsieur, je n’ai pas vu de Monsieur accompagné de sa femme. J’ai seulement vu un Monsieur tenant un enfant dans les bras !… Il faut savoir que Mme de Malartic c.à d. Valentine Le Vieux était haute comme la botte ce qui avait dérouté Le Roy qui a été forcé de retourner vers les voyageurs après l’explication donnée.
Pour ce qui est de la mémoire des lieux je me souviens de certaines parties de St Denis capitale de la Réunion: les alentours de notre maison, le jardin du Roi, où j’allais promener certains jours et ce qui frappe encore mes yeux c’est l’emplacement à droite de l’entrée du jardin, où se trouvaient les volières et les singes. Sous la varangue du bâtiment central se trouvaient à chaque angle deux os de baleine qui partaient du sol et touchaient au plafond. La musique militaire y jouait parfois et c’était une cause de rassemblement.
Je me souviens encore du Couvent des filles de Marie où ma sœur Mina allait en pension et d’un jour de distribution de prix où la foule des participants était si compacte que j’ai failli être écrasé par elle, mon père étant obligé de me soulever dans ses bras pour éviter un accident.
La famille Potier possédait une petite propriété au « Dattier » où nous allions passer les vacances où se trouvaient beaucoup de litchis et où Mr Potier et mon père, encore jeunes tous les deux, lançaient des cerfs-volants que je regardais avec joie.
Puis il y avait le Brulée de St Denis où on allait changer d’air, quand les chaleurs de St Denis nous obligeaient à gagner les hauteurs. La « Maison Lausanne » était encore une habitation où on changeait d’air dans un des faubourgs de St Denis et c’est là que je vis un jour s’échappant d’un cocotier sur lequel on l’avait fait monter pour cueillir des cocos un homme de cour se déchirer les membres en tombant. On le transporta sur une civière à l’hôpital où il mourut du tétanos.
Vers 1865 mon père décide de venir tenter fortune à l’ile Maurice et de rejoindre toute la famille de ma mère. On quitta la Réunion; et mes souvenirs du dernier voyage furent notre embarquement dans la chaloupe au moyen d’une barrique qui glissait au moyen de corde et il fallait faire attention à la lame pour ne pas expédier le passager en dehors de la chaloupe. Rendus à bord du voilier on logeait dans des cabines étroites et sur des lits de paille avec comme nourriture les excellents biscuits d’arrow-root fabriqués à Bourbon.
Arrivée à l’Ile Maurice. « Les Cassis ».
Je vois vaguement la rade de Port Louis à ce moment de notre débarquement. Une chose me frappe seulement, l’existence d’un grenadier en fleur au « chien de plomb » là où plus tard on installa une fontaine pour donner de l’eau aux navires et bateaux.
Comment nous voyageâmes de la rade aux Cassis et qui étaient ceux qui étaient venus nous chercher au débarcadère, je ne puis le dire; mais je me vois arrivant aux Cassis, seigneuriale demeure de mon grand-père de Chazal, et la famille des Cassis entourant celle qui arrivait de Bourbon, et la connaissance faite des uns et des autres.
Les Cassis aujourd’hui disparus, se composaient du Château principal, immense bâtiment en pierres avec étage et combles et entouré devant d’une immense terrasse stuquée et bordée de murs stuqués aussi sur lesquels étaient posés de distance en distance des vases de bronze. J’oublie de dire que pour arriver à cette terrasse on pénètre de la route publique par une porte en fer encadrée de grilles également en fer massif. L’allée qui conduisait au Château était flanquée des 2 côtés de la porte d’entrée de deux loges occupées par les concierges qui en l’espèce remplissaient aussi les fonctions de serviteurs de ma grand-mère; cette allée bordée de haies d’ »orangines » déposait les occupants ou les visiteurs devant un perron de plusieurs marches et de là on se rendait à pied à la terrasse dont je parle en contournant un jardin ovale de bonne dimension; deux immenses palmiers de « Cayenne » se dressaient à droite et à gauche de la terrasse et formaient un encadrement du plus heureux effet.
Cette terrasse donnait accès au Château par 3 portes dont l’une s’ouvrait sur le « salon de marbre » qui à son tour s’ouvrait sur un grand couloir central menant à la varangue de derrière, lequel couloir communiquait à gauche avec les pièces occupées par ma tante Elsie Chevreau et sa famille et à droite par Madame Furteau une parente de ma grand-mère. Plus tard à la mort de Mme Furteau ces appartements furent occupés par mes cousines Elisa et Eva Chevreau et c’est dans la grande chambre que fut exposée en 1871 la dépouille mortelle d’Eva qui avait succombé à un accès hématurique.
Belle blonde d’une quinzaine d’années, elle n’avait vécu que ce que vivent les roses : l’espace d’un matin.
Un escalier partait du salon de marbre pour conduire à l’étage. Cet étage était occupé par mon grand-père, ma grand-mère et ma tante Inès de Chazal, puis la famille de mon oncle Pierre Edmond qui à ce moment se composait de ma tante Lucie et de deux filles : Antonia qui devait mourir si tragiquement à quelques temps de là, et Marthe qui mourut aux Cassis même.
Plus tard, Pierre Edmond, mon oncle, quitta les Cassis chassé par les fièvres et fit l’acquisition d’une campagne aux Vacoas qui s’appelait « Mesnil aux Roses » et qu’il habita le reste de sa vie et que ses enfants habitent encore.
Dans une des ailes du Château, à l’étage, habitait ma bisaïeule Mme Le Vieux, mère de ma grand-mère de Chazal, et je la vois encore, avec son foulard autour de la tête, tel que les portaient les vieilles de cette époque (1866).
En dehors du Château, il y avait d’autres habitations et bâtiments dans l’immense cour des Cassis : la maison occupée par les de Froberville, mes oncle, tante, cousins et cousines. Cette maison à varangue de marbre était au bout sud de la cour et tout contre le mur de balisage des Cassis séparant la propriété de celle des de Ravel, connaissances de la famille. Elle se prolongeait d’ajouts et était attenante à la Salle à manger de mon grand-père tout en étant un bâtiment séparé.
Puis venait la maison que nous occupâmes à notre arrivée de l’ile Bourbon composée de 6 pièces et d’une varangue adossée aux cuisines dont le four immense pénétrait dans la pièce de notre demeure qui servait de cabinet.
La salle à manger était un long bâtiment comprenant la salle elle-même puis une immense office qui contenait même les barriques de vin que l’on perçait pour mettre le vin en bouteilles. On traversait de cette office un espace de 25 pas pour atteindre la fenêtre de la cuisine par laquelle se faisait le service de la table, et le noir « Salomé » cuisinier pondichérien de mon grand-père brandissait de là son grand couteau pour faire peur aux enfants des Cassis lorsque ceux-ci s’approchaient de trop près pour voir ce que contenaient les casseroles.
Une très grande salle de bains se trouvait derrière la maison que nous occupions alimentée par l’eau abondante du Canal Dayot qui traversait la Campagne de mon grand-père venant de la Grande Rivière. Cette salle de bains contenait une immense cuve en fer, d’au moins dix pieds de diamètre et de 2 à 3 pieds de profondeur dans laquelle on se baignait à 5 ou 6 personnes en faisant toutes sortes d’acrobaties. Il y avait à l’un des angles du bâtiment un organo auquel était attachée une grosse corde de navire dont se servait mon grand-père pour sortir de la cuve aidé de 2 serviteurs indiens Lucknot et Badloo, lorsqu’il lui arrivait d’être obligé de prendre des bains la nuit comme sédatif de la moelle épinière dont il fut atteint à la fin de son existence.
Plus au Nord de la campagne se trouvaient d’autres bâtiments de moindre importance qui servaient à la préparation et à l’emmagasinage de la vanille qui était une des industries de la campagne des Cassis. Puis un Chalet occupé par le « bonhomme Carpin » intendant de ce moment de mon grand-père.
Puis, de nombreuses constructions tout autour de la propriété servant de communes, de demeures à louer etc.
Une immense porcherie de purs cochons anglais blancs et roses lorsqu’on avait fait leur toilette, et qui étaient nourris des pains rassis du marché de Port Louis, que mon grand-père faisait acheter à bon compte à cet usage, occupait le versant est de la propriété, et y attenant se trouvait le parc de tortues de terre dont les sujets faisaient la joie de Mr Alfred de la Hogue, parent de la famille, peintre distingué qui disait à mon grand-père : « N’oublie pas, Furcy, de m’inviter chez toi à chaque fois que tu serviras une tortue sur ta table. » Et le vieux n’y manquait jamais.
Les écuries et remises se trouvaient à l’ouest de la propriété, non loin de l’entrée principale et contenaient la paire de chevaux blancs et la grande volière de grand père. Les étables y étaient consignées, abritant vaches et veaux.
J’estime à présent que la superficie totale de la propriété de mon grand-père devaient être de plus de 25 arpents et composée d’immenses jardins potagers, de vignes, de vanille, citronniers, cacaoyers, vergers etc. Il y avait même des terres qui ne pouvaient être exploitées et qui se louaient à des métayers chinois et Indiens. L’eau du canal Dayot y était abondante et permettait une irrigation facile de toutes les parties de la propriété au moyen de canaux et de tuyaux. Mais l’exploitation de cette propriété avait considérablement diminué lorsque nous arrivâmes de la Réunion par suite de maladie sur la vanille et la défection des métayers qui émigrèrent à un moment donné.
Toutefois les potagers duraient encore à mon arrivée aux Cassis qui étaient une des ressources de la propriété et je vois encore les beaux légumes qui en provenaient et qu’on portait sur de longues tables à tréteaux placées à cet effet sur la grande terrasse et dont ma grand-mère prenait le compte avant la livraison aux « contracteurs » qui allaient les vendre au Marché de Port Louis.
Les habitants des Cassis
Les personnes qui habitaient les Cassis à mon arrivée de l’ile Bourbon étaient ma bisaïeule Mme Le Vieux mère de ma grand-mère de Chazal dont j’ai déjà parlé précédemment puis mon grand père de Chazal dont j’ai aussi esquissé le portrait lorsque j’ai parlé de la salle de bains. Madame Furteau, Madame Emler dont je ne vois pas bien la parenté avec la famille et qui sont mortes aux Cassis peu de temps après notre arrivée là. Puis par ordre de préséance, Edmond de Chazal (Pierre Edmond) sa femme Lucie fille de Edmond de Chazal propriétaire de St Antoine au Mapou et leurs enfants : Marthe, Antonia, Lucien, Pierre, d’autres enfants sont nés plus tard à Mesnil aux Roses aux Vacoas qui sont Edgar, René, Laurence, 2 Marc dont l’un était mort à la naissance du second et qu’on appela du même nom en souvenir et enfin Alix la dernière enfant. Ensuite vinrent Rivaltz Chevreau et sa femme Elsie de Chazal et leurs enfants Elisa, Alfred, Eva, Abel et Paul. Puis mon oncle Félix de Froberville, sa femme Claire de Chazal, leurs enfants: Félix, Léon, Nemours, et leur fille Noémie. Enfin, ma propre famille : mon père Alfred Toulorge, ma mère Alice de Chazal, mes sœurs Wilhelmine et Augusta et moi-même. Si je ne me trompe pas cela fait une trentaine de personnes en dehors des enfants de Chazal nés aux Ménils aux Roses et il faut croire que le Château des Cassis et ses annexes et pavillons étaient assez spacieux pour loger tout ce monde.
Que reste-il aujourd’hui (Mars 1941) de toutes ces personnes, établissons-en le compte.
Morts
- Mme Le Vieux ma bisaïeule
- Mme Futeau
- Mme Emler
- Claire de Chazal (ma grand-mère)
- Furcy de Chazal (grand père)
- Ines de Chazal (ma tante)
- Rivaltz Chevreau (mon oncle)
- Elise Chevreau
- Eva Chevreau
- Alfred Chevreau
- Abel Chevreau
- Pierre Edmond de Chazal (mon oncle)
- Lucie de Chazal (ma tante)
- Marthe “
- Antonia “
- Lucien “
- Edgar “
- Marc 1er “
- et 20. Félix de Froberville père et fils et Nemours
- Claire de Froberville (ma tante)
- et 23 Alfred Toulorge et Alice Toulorge
- Et 25 Wilhelmine et Augusta Toulorge
Vivants encore :
- Pierre de Chazal
- René de Chazal
- André de Chazal
- Marc de Chazal
- Alix de Rochecouste née de Chazal
- Laurence Moubras
- Noémie de Froberville
- Henri de Froberville
- Gaston Toulorge
Vingt-cinq morts et neuf survivants et de ces derniers des septuagénaires et des octogénaires qui ne tarderont pas à aller rejoindre leurs devanciers dans la tombe. Ainsi dans peu de temps encore il ne restera plus trace de ceux qu’on a connus et aimés sur cette terre qui en fait n’est qu’un lieu de rencontre où l’on vient se donner rendez-vous pour le Ciel !
La vie aux Cassis.
On y menait une existence très agréable. L’accord étant parfait entre les parents, les jeunes en bénéficiaient dans leurs relations entre eux. Il y avait sans doute quelques petites rivalités comme cela est inévitable quand on fait partie de différents groupes mais le soleil ne se couchait jamais sur les différends qui étaient réglés à la tombée du jour et l’on repartait à nouveau à l’aube avec la même camaraderie et les bons sentiments de la veille.
Tant que la plupart d’entre nous n’était pas encore d’âge à » aller à l’école » la journée n’était occupée que par les jeux et les ris et lorsque vint le moment de suivre les « grands » au pensionnat, on prit son parti en brave et le petit écolier partait sous la garde de la « nénène » pour l’école de Mlle Rosélia Lagesse située à 10 minutes de marche des Cassis, en face de l’Eglise du T.S. Sacrement alors en voie de construction. Beaucoup de petits élèves habitants de l’endroit sous l’œil vigilant de la Maitresse d’Ecole assistée de Mlle Rosalie qui savait si bien diriger nos petites personnalités et nous guider en toutes circonstances.
A l’heure de la sortie, le soir, c’est à qui prenait les devants sur la route, faisant courir les bonnes après nous parce qu’il fallait arriver le premier dans le parc des Cassis sous un grand dattier et sous un « carambolier » pour ramasser les fruits tombés pendant la journée et qui auraient échappé à la vue du passant.
Alors on se ruait sous l’arbre, se bousculant, et écrasant parfois les fruits qui ne servaient à personne.
Après le « gouter » de l’après-midi, chacun chez soi, on se réunissait sur des bancs de pierre ou sur la terrasse pour deviser ou se livrer à des jeux tranquilles, lorsqu’on était mal disposés, ou bruyants, tels les jeux de « barres de couque », de ronde lorsqu’on était en verve. La campagne se prêtait à l’ampleur de nos ébats, et nos promenades dans les jardins, dans les vergers et dans les allées d’ »orangines » étaient fréquentes et la vingtaine de petits enfants de Grand Père et Grand-Mère de Chazal faisaient un assez joli tapage pour être souvent rappelés à l’ordre par les autorités supérieures.
Pour réglementer la discipline chez nous mon oncle Félix de Froberville avait fondé un cours de gymnastique dont il était lui-même le professeur. Très bel homme, solide et fort, il était tout indiqué pour ce genre d’exercice, et prenait son rôle très au sérieux. Il avait fait installer sur un emplacement vaste entre le pavillon de la salle à manger et la Citronnerie tous les éléments nécessaires pour faire de la haute gymnastique : Mât pour grimper, barres parallèles, trapèze, cheval de bois, tremplin etc etc. Nous avions nos uniformes spéciaux, les garçons de culottes courtes avec blouses et une ceinture en toile épaisse munie d’un anneau de fer par lequel nous tenait mon oncle en cas d’accidents de chute. Les filles étaient en jupes courtes avec les mêmes accessoires. Et on commençait la leçon: marches, sauts qui duraient une bonne heure et se terminaient par la marche triomphale à travers toutes les allées de la campagne à la grande joie des grands-parents que nous rencontrions sur notre parcours.
Un de nos plaisirs journaliers était d’assister à la tombée du jour, à l’arrivée des beaux légumes du jardin sur un coté de la grande terrasse où Grand-Mère en prenait le compte avant la livraison aux contacteurs. Et notre présence-là était toujours intéressée car nous trouvions moyen de dérober quelques carottes appétissantes qui nous tenaient lieu d’apéritif avant le diner.
Les repas du soir avaient lieu dans l’immense salle à manger que j’ai déjà décrite, où la nombreuse famille entourait nos vénérables et vénérés parents. Seule la famille de Froberville prenait ses repas de semaine chez eux, mais ralliait la grande famille les dimanches.
Mon oncle Pierre Edmond de Chazal, parti pour Mesnil-aux-Roses, avait contracté l’habitude de déjeuner tous les Mercredis aux Cassis et arrivait vers les dix heures dans une grande « voiture de louage » à 2 chevaux qui le ramenait à son Bureau d’avoué en Ville après deux heures de station aux Cassis.
Il y avait beaucoup d’entrain et d’animation aux Cassis par le fait des relations que mes grands-parents entretenaient avec la famille extérieure et les amis nombreux. Ma mère, et ma tante Claire de Froberville étaient d’excellentes pianistes et de plus, ma mère avait une voix de soprano à laquelle celle de Mezze de ma tante donnait la réplique. Mon oncle de Froberville jouait de la Contrebasse et ma grand-mère de la Harpe. C’étaient alors d’agréables concerts que présidaient Mr Fournera le professeur de musique de ces dames. Ma mère avait un magnifique piano à queue d’Erard rapporté de Bourbon et ma tante Claire de Froberville un piano droit de Pleyel. Le piano de ma mère avait une réputation assise à la Réunion et était demandé par le Gouverneur et la Gouvernante de Bourbon à chaque fois qu’ils donnaient un concert à St Denis. De plus ce même piano a servi à faire de la contrebande de dentelles dont il était rempli à son voyage de Bourbon à Maurice. Ma sœur Wilhelmine qui avait commencé ses études musicales sur ce même piano à la Réunion faisait sa partie dans les concerts donnés aux Cassis et devint par la suite une très bonne pianiste sous l’instruction de ma mère.
Ma sœur cadette, Augusta, étudia aussi le piano, mais une très forte myopie fut pour elle un empêchement au développement de cet art si agréable et elle dut abandonner l’étude de bonne heure.
Nous grandissions ainsi en âge, et dirai-je en sagesse ?.. Pourquoi pas. Elevés chrétiennement par nos parents chrétiens nous devions marcher sur leurs traces. Ma grand-mère était excessivement pieuse d’une piété solide qui lui venait sans doute de ce que la Religion Catholique étant inconnue à l’Ile Maurice jusqu’aux abords du Concordat de 1801 qui établit dès lors officiellement le culte catholique en France et aux Colonies et ce ne fut guère que vers 1810 que l’Evêque de Ruspa s’occupa de diffuser la foi parmi les habitants de l’ile et convertit mes grands-parents qui instruits à un âge plus que de raison comprenaient bien les préceptes et les dogmes et se les assimilaient pour toujours. Ma grand-mère (et tous les siens) m’a-t-on raconté, avait été baptisée, communiée, confirmée et mariée le même jour et nulle plus qu’elle n’entretint « dans son cœur » toutes ces choses avec autant de fidélité dans la suite des temps.
Nous allions entendre la Messe à l’Eglise du T.S.Sacrement qui était desservie à cette époque par le Révérend père Beaud doux vieillard très instruit qui n’avait qu’un mince défaut: trop de longueur dans ses sermons. Il faisait porter un fauteuil dans la chaire et parlait sans se lasser pendant… des heures. Si bien que mon oncle de Froberville tirait ostensiblement sa montre pour attirer l’attention du Curé et des paroissiens sur la nécessité de voir terminer le prône parce que son estomac était rendu au talon et que le Dimanche on faisait bonne chère aux Cassis et souvent le Curé lui-même venait déjeuner avec nous. Alors il disait à mon oncle : « Froberville ! Je vous ai très bien vu manifester votre impatience à l’Eglise mais vous ne m’empêcherez pas de dire tout ce que j’ai à dire à mes ouailles. «
Epidémie de fièvre paludéenne de 1867
Une virulente épidémie de Fièvre paludéenne se déclara dans la Colonie et en fit le tour. On l’attribua d’abord aux fouilles faites pour l’installation du Chemin de fer (1866) puis à une infiltration du mal par violation de quarantaine d’un navire en rade porteur du mal. Cette épidémie à laquelle les habitants des Cassis échappèrent fut meurtrière ailleurs. Mais on fut sur les cadres pendant longtemps et le désarroi était si grand qu’on n’avait pas le temps de s’occuper de ses atours pour recevoir les visites officielles de Médecins et autres et c’est ainsi que l’Evêque de ce temps (de Ruspa je crois) fut reçu aux Cassis par ma grand-mère en grande blouse autant dire en chemise.
Le sulfate de quinine, antidote de la fièvre manquait dans le pays, ce qui fut cause de la grande mortalité. Il y eut toutefois un accaparement de ce médicament et un Courtier de l’époque (Hugues) fut caricaturé avec un collier de flacons de quinine autour du cou et la caricature distribuée dans le pays. Cette épidémie dispersa deux des familles des Cassis :
Pierre Edmond de Chazal et les siens allèrent se fixer au Phoenix « Mesnil aux Roses » et les de Froberville un peu plus haut à Darlonville. Il ne resta aux Cassis que nos grands-parents Chazal, les Chevreau et les Toulorge.
Le Collège des Pères du St Esprit :
J’entrai au Collège des Pères du St Esprit en 1869 en même temps que mes cousins Chevreau. Au début j’y allais chaque jour conduit par mon père qui s’était acheté une petite voiture et un cheval blanc que lui avait vendu mon grand-père. Puis voiture et cheval étant revendus, j’allais à pieds avec mes cousins Chevreau sous la conduite de Samy, un madras que mon père avait emmené de la Réunion avec lui.
Le Collège des Pères était très éloigné des Cassis et se trouvait à l’entrée du Champ de Mars, là où est aujourd’hui encore les vastes bâtiments en pierre occupés par un Collège de Frères de la Doctrine Chrétienne (Jean Baptiste de la Salle).
Ce collège du St Esprit où je passai neuf années de mon existence était d’abord composé de plusieurs maisons particulières et de cours différentes où les premières années du Collège commencèrent à rassembler des enfants de famille de la haute société. Peu de gens de couleur. Une dizaine en tout sur 150 ou 200 élèves. La 1ère Chapelle se trouvait dans un pavillon faisant face à la Rue du Gouvernement, aujourd’hui Rue Pope Hennessy du nom d’un gouverneur des plus populaires venu à Maurice pour installer la réforme électorale.
Plus tard vu le nombre croissant des élèves qui arrivaient de tous les quartiers de l’ile, les Pères se décidèrent à construire les immenses bâtiments qu’on voit aujourd’hui, et à démolir les maisons de bois qui existaient auparavant.
La Chapelle fut alors installée dans l’ancien bâtiment de l’ »Etude » qui faisait face au Champ de Mars et qu’on roula sur des cylindres à l’endroit désigné c.à d. contre la petite rue « Champ de Mars Row » où elle exista jusqu’à la fermeture du Collège, mais fut transférée plus tard dans la nouvelle « Etude » créée depuis l’achèvement des Bâtiments nouveaux.
Collège immense et prospère. Beaucoup d’élèves dont la moitié peut être étaient internes, venaient des quartiers. Vastes salles d’étude et de classes. Parloirs, procure, salle des repas, de musique, de dessins. Dans le préau un mât immense pour faire la « patelonge » avec des cordages au fond de la cour des communs, dans une des chambres desquels le frère Vital mon professeur de dessin a modelé la statue du Père Laval et l’a cuit au four. J’ai aidé le bon frère dans cette opération. Cette statue figure aujourd’hui au tombeau du Père Laval, à Ste Croix, et peut être admiré par tous ceux qui y vont en pèlerinage.
J’ai passé neuf années à ce Collège de 1869 à 1877 après y avoir fait toutes mes études y compris la Rhétorique et 6 mois de Philosophie. Je prenais aussi des leçons de dessin avec le P. Vital, et d’escrime avec le professeur Digard, un ami de mon père. Mes différents professeurs furent dans l’ordre des Classes : les Pères : Garmy, Guillemin, Commisigenger, Hagnart, Manger, Kempf, (un allemand), Jonau, Richaume, Power (anglais) Clark, Roserot, Ditner, (qui fut plus tard curé de N.D. du Rosaire à Quatre Bornes), Mingelle, et d’autres probablement que j’ai oubliés après plus de soixante ans de là. Les frères étaient des surveillants d’étude, P. Duboin, Guilloux (Supérieurs).
Ils s’appelaient F. Irénée, et deux autres dont j’ai oublié aussi les noms mais on avait donné à l’un d’eux le nom de F.Bifsteak parce que c’était celui qui faisait le ménage du Collège et allant aux provisions achetait le bœuf et la volaille, les légumes et les fruits.
En 2ème j’eus pour professeur le père Kempf qui mourut au cours d’une saison de cure à la Réunion.
En 1ère le Père Richaume qui fut aussi mon professeur de rhétorique et de philosophie.
Le Père Jonan fut notre professeur d’histoire naturelle, de chimie, de mathématique et de géométrie et trigonométrie. C’était un petit homme haut comme la botte tellement absorbé dans l’exposition des théorèmes sur le tableau sans dire un mot parfois pendant toute une classe, qu’il nous est arrivé une fois de vider la classe (lui au tableau, nous tournant le dos) et lorsqu’ayant terminé ses calculs il se retourna constata avec colère ce manque de respect et de discipline et nous le fit payer à la classe suivante.
Notre premier professeur d’anglais était M. Hatch, un doux vieil anglais au visage cramoisi, qui passait son temps à envoyer l’un de nous tremper son mouchoir au robinet pour se le mettre en fomentation sur la figure et éviter la congestion cérébrale. Le 2ème professeur d’anglais fut le Père Power qui faisait volontiers sa partie dans nos ébats en récréation.
Les condisciples qui montèrent avec moi de classe en classe furent : Xavier Le Vieux, Alfred Chevreau, Léon Langlois, Victor Lesur, Maurice Carosin, Ange Hardy, Paul Rivière (un Breton).
Les Chevreau nous quittèrent vers la 2ème pour entrer au Collège Royal.
Ce fut un heureux temps que ce temps de Collège où je n’eus qu’à me louer d’avoir été éduqué de façon si chrétienne par de nobles et vertueux professeurs que Dieu récompense pour le dévouement et l’apostolat qu’ils ont montré à l’égard de ceux qui leur étaient confiés.
Premières années de Travail – « Virginia ».
Je quittai le Collège en 1877 pour entrer dans la vie tenter de devenir quelqu’un ou quelque chose, et suivre l’exemple de tous ceux qui ont à se débrouiller dans l’existence du moment qu’on n’est pas fortuné et qu’il faut vivre.
Mon père m’admit d’abord comme élève dans son officine qui se trouvait dans la Rue de l’Eglise. Je fis là de la chimie pratique sous sa direction, en compagnie d’un jeune collégien mulâtre, Marins Bourelly, mais je ne fis pas longtemps à ce métier si peu lucratif encore que relevé, et mes aspirations me poussaient à plus d’espace devant et autour de moi, et aussi plus de moyens financiers, car les quelques mois que je passai chez mon père ne m’avaient rapporté que les maigres appointements de dix roupies par mois, ce qui était loin de me suffire.
Je me souviens que les premiers appointements que je touchai m’avaient été apportés sous forme d’un Billet Rose dans une enveloppe et portée sur le plus grand plateau de la Maison (3 pieds carré) par l’illustre « Valé », cafre donné à mon père par M. Robert de la Réunion. Valé était tatoué et avait des dents limées (pour manger de la chair humaine apparemment.) Ce me fut un plaisir de toucher le prix de mon labeur et je pouvais acheter mes cigarettes sans avoir recours à la bourse paternelle.
Comme je l’ai dit, ce modeste emploi ne dura que quelques mois et ma sœur Mina ayant épousé Henry Koenjg, en Novembre 1878, alla habiter Constance d’Arifat à Flacq que mon beau-frère administrait. Peu de temps après on proposa à Henry l’administration de la propriété « Virginia » au Grand Port et en 1879 je partis pour cette sucrerie appelé par Henry et Mina.
Je passai quatre années à Virginia où je fus très heureux. Le métier d’habitant m’allait tout à fait et j’aurais passé ma vie aux champs et à l’usine si le Bon Dieu l’avait voulu.
Mes premières occupations étaient de suivre Henry dans ses tournées d’habitation pour apprendre le métier. Nous étions toujours en voiture tirée par une mule et roulions à travers monts et vaux par tous les temps. En vrai citadin que j’avais été auparavant il me semblait que j’allais affronter de grandes intempéries de saison et je m’étais prémuni de « water proof » de grosses bottes caoutchoutées et de parapluie. Tartarin dans les Alpes, quoi !.. Mais bientôt je pus remiser ce gros appareillage pour le plus grand bien de ma santé et de mon travail.
Henry me confia alors le ré arpentage de toute la propriété pour ne pas se fier aux plans qui existaient, et pouvoir être sûr de la superficie des carreaux de cannes et fixer les rendements et le cout d’exploitation. Grâce à mes connaissances géométriques et artistiques je dressai un plan superbe qui fit force de loi.
A quelques temps de là, Victor Barbier, le comptable de la propriété, un Bourbonnais ancien frère de la Doctrine Chrétienne quitta la propriété et j’occupai son poste, touchant Rs 70 par mois. Pont d’or pour cette époque et fortune pour un garçon de 20 ans qui n’avait aucune charge habitant chez ma sœur et mon beau-frère. Cet argent servait à mon habillement et à mes petites fantaisies et il me restait de quoi me créer une réserve pour les temps à venir.
Tout en étant à la comptabilité je m’occupais aussi de l’Usine et me tenais au courant de la fabrication du sucre. Intéressant travail en dépit de l’ancienneté des machines et des procédés employés. Le générateur était uni-tubulaire et on employait des « Batteries » et des Wetzells ». Plus tard on monta un générateur multi-tubulaire, un 2ème vide, d’autres turbines.
Le sucre fabriqué au monosulfite et à l’appareil Giffard dans la « Batterie » était très blanc et en beaux cristaux, qu’on envoyait dans l’Inde qui tenait le marché de toute la coupe de l’Ile Maurice et les prix de vente étaient bien supérieurs à ceux d’aujourd’hui.
Virginia appartenait à Messieurs Alphonse Lagesse et Frédéric Robert à l’époque où j’y étais et avait appartenu avant eux à mon oncle Jules Le Vieux, frère de ma grand-mère de Chazal et était administré alors par Oscar Chevreau un parent à ma famille. J’avais même fait un séjour chez lui pendant mes dernières vacances avec mes cousins Alfred et Abel Chevreau en 1876 ou 1877 à ma sortie de Collège.
La Maison de Virginia était cette belle demeure que l’on voit aujourd’hui contre la gare de Quatre Bornes qui avait été démontée et reconstruite là après la fermeture de Virginia.
Henry et Mina habitaient le rez de Chaussée et moi j’occupais une très grande pièce à l’étage. C’est là que sont nés les premiers enfants de Mina, Wilhelmine et Henry des mêmes noms que leur père et mère. La première en 1879 et le second en 1881, c’est moi qui allais à chaque fois chercher le Docteur Vitry à Mahébourg où il habitait et était Médecin du Gouvernement. Je partais en voiture à 2 petites mules : Kastouri et Martin et roulais 6 milles à l’aller et autant au retour. Pour la naissance de Wilhelmine le Médecin eut à attendre les événements et monta coucher dans ma chambre. Nous avions causé une grande partie de la nuit pour prendre patience, et je finis par m’endormir ainsi que Vitry qui tracassé par les moustiques s’était jeté un foulard rouge sur la figure. Le lendemain à l’aube Vitry me crie : » Allez embrasser votre nièce ! ».. La petite était née depuis deux heures, et la besogne achevée le médecin était remonté se jeter sur son lit pour se reposer.
On menait une vie douce et tranquille à Virginia. Ma sœur Mina qui était d’une grande bonté et d’une humeur toujours égale embellissait notre petite existence à trois à laquelle nous trouvions beaucoup de charme. Mina était une bonne pianiste et moi j’avais un assez joli talent de chanteur. Nous faisions alors des petits concerts qui nous délassaient après les rudes journées de travail d’habitation ou d’Usine. Je nous vois encore déchiffrant la partition de la Favorite d’un bout à l’autre et Henry écoutait avec plaisir et y joignant parfois sa grosse voix.
Papa et maman ainsi que ma sœur Augusta venaient parfois faire des séjours à Virginia ainsi que M. Alfred Koenig et sa femme, Pauline et Marie Koenig, Etienne et Alfred leurs frères. C’est à un de ces séjours qu’Etienne tomba des falaises du Barachois dans la mer, et faillit rester au fond de l’eau.
Ce fut un drame que je veux raconter. Toute la famille était partie pour ce coin de mer dans 2 voitures et Etienne et moi déambulant plus vite que les autres étions arrivés à une crique d’un contour circulaire de cinquante pieds de diamètre environ et chacun se dirigea machinalement l’un au Nord et l’autre au Sud du Contour. Je faisais face à la mer démontée sur le pic Nord et Etienne tournait le dos aux vagues sur le pic Sud. On devisait à haute voix pour couvrir le bruit fracassant des vagues qui déferlaient dans cette baie avec des remous terrifiants, et nous fumions nos cigarettes. Tout à coup, une lame gigantesque a grimpé le long de la falaise au pic de laquelle se tenait Etienne, l’enveloppe de ses plis humides et le projette au milieu de la crique dans un saut de 25 à 30 pieds de haut !!!
Seigneur ! s’écrient tous ceux qui venaient d’arriver sur le théâtre de l’accident, Seigneur !… Il est perdu… C’étaient son père, son frère Henry, Mina, mon père à moi qui avaient vu Etienne s’élever de son socle et disparaitre dans l’abime.
Ce fut un affolement de chacun dans le premier moment: je courais à droite et à gauche du gouffre pour savoir ce que les grandes lames avaient fait d’Etienne et si par malchance il n’avait pas été englouti dans les cavernes en même temps que les vagues écumantes. Je le vis alors triste épave luttant contre le flot qui le portait vers les parois de la falaise puis l’en éloignaient dans leur remous. Les yeux désorbités, l’angoisse d’épouvante sur la figure il offrait le spectacle navrant d’un naufragé qui va mourir sous les yeux de ceux qui le regardent du haut de la falaise sans pouvoir lui porter aucun secours. Je le vois et je crie de toutes mes forces “ Henry !“ il est collé à la paroi du rocher qui surplombe le gouffre. Mais comment parvenir à cet endroit qui se trouvait à une cinquantaine de pieds au-dessous du niveau de la berge. Cours à l’Usine, me crie Henry et rapporte des cordages et de l’assistance. Je me précipite vers la voiture qui avait à traverser un bras de mer avant d’atteindre à l’autre bout du Barachois et de là gagner la route de l’usine à 10 minutes de là. Bientôt je revenais sur le lieu du « sinistre » et quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de voir Etienne affalé sur la berge, et Henry en caleçon de dessous !.. Voici ce qui avait eu lieu : d’abord Henry n’écoutant que son cœur de frère et son courage avait voulu se jeter à l’eau pour en retirer son frère. Sa femme s’était accrochée à lui pour l’empêcher d’aller au-devant d’une mort certaine sans profit pour le salut d’Etienne parce qu’en cet endroit et dans ce gouffre il était matériellement impossible d’opérer un sauvetage. Lutte alors entre les deux époux et victoire de l’épouse à qui Dieu donna raison en insinuant à Henry un moyen moins radical que le saut dans la mer, mais qui fut couronné de succès. Retirant son pantalon il en tint un bout dans les mains et lança l’autre à Etienne qui eut encore la force de le saisir et de ne pas le lâcher. Avec d’infinies précautions et retenu et aidé par Mina, Mr Koenig et mon père il eut la force de hâler le « gros poisson » qui s’évanouit en atteignant le roc ferme de la berge. Mon Seigneur et mon Dieu, avait crié le vieil Alfred Koenig, sauvez mon fils Etienne ! Et lorsqu’il le vit sauf il se jeta à genoux pour remercier Dieu de tout son cœur.
Le retour à la Maison de fit processionnellement et chacun se félicita de n’avoir pas eu à déplorer un grand malheur. Etienne remis de ses émotions après un bon « grog » jura qu’il ne recommencerait plus.
Cet accident ou incident fut l’objet de nombreux pèlerinages de la famille et tous les parents de la « Meilleraye » de Curepipe et d’ailleurs tinrent à visiter l’endroit tour à tour dans la suite.
C’est ainsi qu’en 1881 je crois, celle qui fut plus tard ma femme vint avec sa mère et d’autres membres de la famille de Curepipe passer une journée à Virginia mais je n’eus pas le bonheur de les y rencontrer étant parti engager des hommes à la Magistrature du Grand Port pour la propriété. Qui aurait pensé à ce moment-là que ma future Madame respirait pour un jour le même air que je respirais chaque jour !
Je vivais sans soucis à cette époque, libre de cœur et l’âme ne pensant, dans mes heures de loisirs, qu’à la chasse, et à la pêche. Je m’étais acheté un très bon fusil Lefaucheux chez Sères armurier, et papa était venu le choisir avec moi. Chaque jour, pour ainsi dire dans l’entrecoupe, fusil en bandoulière, à pied ou en voiture, j’allais braconner sur la propriété et rentrais avec du gibier pour la table. Ma chasse en voiture était plus fructueuse parce que je tirais les perdrix par surprise de la voiture même et souvent je visais la perdrix entre les oreilles de la mule et il m’est arrivé un jour d’avoir envoyé quelques grains de plomb dans les oreilles de la mule qui me trainait laquelle prit le mors aux dents et me renversa dans la poussière.
Henry mon beau-frère avait un très beau Lévrier braque d’un poil noir comme de geai qui arrêtait la perdrix avec « maestria » ; mais il n’aimait pas travailler pour des prunes. Il abandonnait aux champs le chasseur »mazette » et c’est arrivé que je le vis revenir à l’usine de Virginia pendant que je faisais mes comptes de paie et se coucha à mes pieds, après à peine quelques instants où je l’avais vu partir en compagnie d’Alfred Chevreau mon cousin à qui j’avais prêté chien et fusil pour une battue. Je flairai une mazetterie de la part d’Alfred et lorsque celui-ci revint plus tard des champs il me dit « mais quel espèce de chien tu m’as prêté pour la chasse ? il m’a planté là au bout d’une heure et est parti la queue en trompette pour retourner à la Maison !.. Tu as du manquer ton gibier lui ai-je répondu ; montre-moi ton carnier… J’ai manqué toutes les pièces que j’ai tirées m’avoua-t-il. Voilà la raison lui dis-je, Reek ne supporte pas chasser avec ceux qui ne tuent pas les perdrix qu’il lève. Sois plus adroit la prochaine fois.
Je chassais aussi la Poule d’Eau et la Poule Sultane dans les allées de « Fantaisie » annexe de Virginia ; ou bien j’allais à l’affut de l’alouette de mer qui aimait courir sur le sable du Barachois à la recherche des petits tourlouroux qui s’empressaient de regagner leurs trous pour lui échapper.
J’aimais beaucoup flâner dans les brousses sauvages du bord de mer, ou bien, m’avançant au-delà de ces grands fouillis je parcourais ces immenses falaises qui partent de Virginia pour s’étendre à perte de vue vers « Savinia » et plus loin encore abattant un oiseau de mer de temps à autre.
Ces falaises produit ou plutôt coulées volcaniques d’un temps préhistorique forment un vaste plateau désertique composé de parties creuses à l’intérieur formées par des coins d’air pendant les coulées de laves avec des solutions de continuité constituant des trous communiquant avec la mer; et lorsque celle-ci s’engouffre sous ce plateau, chassée par la pression des vagues immenses de cet endroit il se formait de petits « souffleurs » d’air pourchassé des cavernes intérieures.
Un jour mon cousin Abel Chevreau et moi fatigués d’avoir longtemps erré sur les falaises nous nous étions assis sur le roc et Abel avait placé son parasol tout ouvert à côté de lui. Tout à coup, nous voyons le parasol qui monte dans les airs comme un ballon gonflé et va se perdre à une longue distance de nous. C’était l’air pourchassé d’un petit souffleur peu visible qui élevait l’ombrelle et en faisait une« Mongolfière ».
Plus à l’ouest de cet endroit dont je parle se trouve le vrai « Souffleur » grand cratère au bord de la falaise que les gigantesques vagues qui y arrivent et s’engouffrant à la base chassent l’air du cylindre central et projettent une colonne d’eau à de hautes distances dans les airs. J’ai vu là en compagnie d’Henry et de sa sœur Marie Koenig qui étaient avec moi ce jour-là pendant un cyclone, une colonne d’eau de plus de 80 pieds de haut émerger du Souffleur. Spectacle magique occasionné par la mer démontée à cause d’un violent Raz de marée du au mauvais temps.
Entre Virginia et le Souffleur se trouve le pont Naturel, curieuse manifestation du travail de la mer et du temps. C’est un passage en roc (lave) de vingt à 25 pieds de long bordé de chaque côté de gouffres remplis de l’eau de l’océan et d’une profondeur incommensurable. C’est un coin des plus dangereux de ces endroits volcaniques, et la légende raconte qu’un … anglais a traversé ce pont naturel sur son cheval… Se non è vero ben trovato » diraient aujourd’hui les compatriotes de Mr Mussolini. S’il était tombé dans ce gouffre, son compte était clair et il aurait certainement été rejoindre Auton.
L’Eglise de la Plaine Magnien
Nous allions assister à la Messe à l’Eglise St Maurice à la Plaine Magnien à une demi-heure de voiture de la propriété Virginia. J’ai connu deux curés de cette Eglise pendant mon séjour à Virginia : Les pères Béchet et Guyon. Ce dernier était le plus jeune des deux mais le moins bien portant. Il était sujet aux crises d’épilepsie et un jour il en eut une pendant qu’il célébrait la Messe. On fut embarrassé dans l’église. Edouard Carosin et moi nous nous précipitâmes à l’autel pour empêcher le pauvre curé de s’abimer par terre et de se faire mal mais ne pûmes l’empêcher de tomber et se blessa à la tête, saigna abondamment. Nous le transportâmes à la sacristie et aidés d’autres paroissiens on réussit à lui rendre ses sens. Ce dimanche il n’y eut pas de messe et chacun s’en fut chez soi. Le Père Béchet lui était très âgé. Il allait quelques fois dire la messe dans une école du « Bouchon » et il nous est arrivé à nous d’y assister. L’endroit était très pittoresque, et prêtait beaucoup à l’élévation de l’âme vers Dieu.
Connaissances du Grand Port
Les habitants du Grand Port étaient assez éloignés les uns des autres par le fait de l’étendue des propriétés sur lesquelles ils se trouvaient. Mon Désert était le plus rapproché de Virginia. Ce lieu appartenait à Mr. Cloupet et était administré par Mr Maurice le père de Mr Maurice l’illustre baryton mauricien dont la belle voix nous a si souvent charmés dans la suite des temps. Maurice était un homme de couleur qui n’entretenait guère de relations avec la société du Grand Port mais il était un administrateur habile que les autres administrateurs voyaient souvent pour les besoins du métier. Carosin qui était le Comptable de Mon Désert a été un de mes bons amis de cette époque (1880 à 1882). Nous allions souvent le dimanche chez les Lamusse qui habitaient la Plaine Magnien. On dansait là dans la journée et souvent on nous gardait à diner pour re danser après diner. Les invités étaient les de St Romain, les Pastourel, Fondaumière, de Robillard, Vallet, et d’autres encore. Mr et Mme Lamusse avaient deux filles dont l’ainée a épousé Evenor Tostée un camarade de Collège à moi et la cadette Amélie épousa mon camarade Carosin dans la suite. Un fils, Léon Lamusse, qui épousa Mlle de St Romain. C’étaient des gens très aimables. Le père Lamusse était un bon vieux patriarche, qui vous recevait avec un cœur bien ouvert, et vous mettait tout de suite à l’aise chez lui. J’ai eu occasion maintes fois, depuis mon retrait de Virginia, de traverser la Plaine Magnien en auto et à plus de 50 ans de là. La petite propriété des Lamusse n’existe plus, la Maison a disparu. Les habitants sont morts ou dispersés.
Un peu plus haut que la campagne Lamusse se trouvait la propriété Mon Trésor appartenant à Madame Chauvin la mère du docteur Selmour Chauvin qui a épousé Henriette Daruty la sœur de Mme Despeissis, d’Albert de Clément, et d’Emile Daruty dont j’aurai l’occasion peut-être de parler plus tard. Henry Mina et moi allions voir la bonne Mme Chauvin qui vivait retirée dans sa propriété. Elle avait aussi une fille charmante qui s’appelait Henriette et qui a épousé Albert Daruty, le conservateur du Musée de Port Louis.
Mr Ferdinand Antelme administrait Savannah. Il avait trois filles et un fils qui fut plus tard député des Plaines Wilhems. Ses filles épousèrent l’une Mr Fernand Dumont et propriétaire au Grand Port, la deuxième Louis Koenig cousin de ma femme et la 3ème, Louis Baudot courtier maritime. Nous voyagions souvent par le même train, et dans le même wagon entre la gare d’Union Vale qui était notre gare de chemin de fer, et Curepipe où la famille Antelme avait de la famille. Moi je continuais pour Port Louis où j’allais régulièrement tous les mois pour affaires de la propriété. Un jour, au retour, les Antelme de Curepipe et moi de Port Louis il se trouve que la voiture de Virginia ne se trouvait pas à la gare pour me prendre. Mr Antelme m’offrit place dans la sienne, ce que j’acceptai. Mais lorsqu’il voulut me faire asseoir au fond de la voiture à côté de lui, et mettre ses jeunes filles sur la banquette, je protestai énergiquement mais dus céder à ses insistances par politesse ce qui me contraria fort, mais que ces demoiselles eurent l’air de trouver tout naturel.
La propriété Union Vale était habitée par ses propriétaires les Samouillhan avec lesquels nous n’avions pas de relations.
Savinia, propriété des Pierrot balisait avec Virginia. On n’entretenait que des relations d’affaire avec leurs habitants. Les Pierrot étaient des gens de bonne éducation que l’on rencontrait le Dimanche à l’Eglise. Mme Gualbert Pierrot était une demoiselle Pougnet, belle jeune femme blanche comme du lait et contrastait avec le teint coloré de son mari, qui par exemple était un bel homme de plus de 6 pieds de haut et d’une carrure appropriée à sa taille.
Bonne Source, petite propriété située au lieudit « L’Escalier » avait été achetée plus tard par Mr Lagesse et réunie à Virginia. Mons Edouard Roussel qui l’administrait entra dans le personnel de Virginia en sous ordre d’Henry Koenig, qu’il remplaça ensuite alors qu’Henry cassa les vitres avec le père Alphonse Lagesse et qu’il largua tout en paquet pour s’en aller. Nous avons toujours soupçonné Mr Roussel d’avoir travaillé son parent Lagesse pour se substituer à Henry dans l’administration de Virginia.
La propriété La Barraque qui appartenait à Mr Guimbeau balisait aussi avec Virginia et Sauve Terre. Elle était administrée par Mr Maucine venu de Bourbon je crois et qui avait épousé Melle Marabal, marchand de la Chaussée à Port louis qui fit une grosse fortune dans une petite échoppe en vendant du fil et des aiguilles.
Puis il y avait la propriété Plaisance qui appartenait aux Barlow, parents aux Rochecouste. L’administrateur en était James Barlow qui avait épousé une demoiselle de Robillard et dont le frère, Christian fut administrateur des propriétés du Mauritius Sugar Estates. Ils furent je pense dépossédés de Plaisance dans la suite car James ou Henry ? Barlow fut plus tard Inspecteur des propriétés de l’Agricultural ou j’étais employé moi-même.
Enfin il y avait Beau Vallon Rochecouste à Mahébourg, où j’ai connu Guillebert et Guy de Touris employés là chez qui Carosin et moi allions souvent déjeuner ou diner et qui étaient de grands organisateurs de soirées qui avaient lieu dans le bel immeuble du docteur Vitry qui le mettait toujours avec empressement à la disposition des danseurs.
Les soirs de bal je retournais en voiture avec Carosin qui me gardait à coucher chez lui à Mon Désert, et je regagnais Virginia au petit jour le lendemain pour être présent à l’appel de la propriété.
J’ai fait beaucoup de promenades et d’excursions pendant les quatre années où j’habitais Virginia. J’ai rayonné de tous les côtés dans ce quartier béni où il y avait de si jolis points de vue et d’endroits si pittoresques. J’allai un jour à Riche Bois voir Paul Chevreau mon cousin qui avait voulu embrasser la carrière d’habitant et que je vis ce jour-là perdu dans une pièce de l’immense château de Riche Bois construit par Mr Hervetson. Il était là, absolument seul sans une relation quelconque ayant l’air de s’ennuyer à périr. Il n’y fit pas long feu et quitta bientôt la propriété et le métier pour entrer à la Banque Franco Egyptienne que venait de créer Mr Black un Français. Là même il ne dura pas longtemps car il partit pour France se faire recevoir médecin.
Départ de Virginia. Port Louis. Autres emplois
Comme je l’ai dit plus haut Henry ayant donné brusquement sa démission à Mr Lagesse (près de la batterie dans l’usine de Virginia) à cause de l’attitude chicanière de Mr Lagesse travaillé par Mr Edouard Roussel qui ambitionnant l’administration de la propriété, travaillait le propriétaire, son parent, sans relâche et en dénigrant Henry dans son esprit. Henry quitta donc Virginia dans les 24 heures faisant pour ainsi dire un coup de tête en ne restant pas plus longtemps à son poste.
Mina et lui partis, ainsi que leurs 2 enfants à ce moment il ne me restait pas d’autre alternative que de donner aussi ma démission à Mr Lagesse et de m’en aller à mon tour. Je lui donnai cette démission au même endroit qu’Henry, c.à d. près de La Batterie dans l’usine; seulement comme j’étais le comptable de la propriété, j’avais des comptes à rendre et des Livres à mettre à jour.
Cela me prit une quinzaine de jours et ce fut pour moi un temps bien triste, que je passai dans cette grande maison de Virginia, vide de tous ses habitants et n’ayant pour tout mobilier (Henry ayant déménagé ses meubles depuis 15 jours) que mon lit, une table, une chaise et pour table à manger… une caisse posée par terre. Moi, je m’asseyais aussi par terre pour prendre mes repas … Un prisonnier dans sa cellule était plus représentatif que ma pauvre personnalité et quelqu’un qui aurait vu mon dénuement aurait pleuré avec moi cet abandon complet.
Un ami cependant vint me consoler. Edouard Carosin, le comptable de Mon Désert et sans administrateur aussi, mon compagnon des beaux jours passant à Virginia une après-midi me vit assis auprès de ma caisse table à manger, comme le plus grand des philosophes pleura sur mon sort malheureux en s’écrient : Jamais je ne permettrai une pareille chose mon bon camarade; quels reproches ne dois-je pas vous adresser pour ne m’avoir pas mis au courant de ce qui vous arrivait. Je vous aurais prêté au moins le nécessaire pour attendre le jour de votre départ définitif de la propriété. Vous avez manqué gravement à l’amitié et je vous en veux de tout cœur.
Pour réparer cette diversion exagérée entre amis je vous emmène séance tenante à Mon Désert où vous trouverez la table, le coucher, et je mettrai chaque jour à votre disposition une voiture de Mon Désert afin que vous puissiez terminer vos occupations à Virginia avant de tout quitter pour jamais.
Brave Carosin, je m’embarquai avec lui dans sa voiture après avoir fermé la maison en la recommandant aux gardiens de la Cour. Je passai 15 jours chez Carosin, revenant chaque matin à Virginia d’où je partis le 25 Décembre 1882 après avoir revu mes comptes et tiré mon coup de chapeau au représentant de Mr Lagesse, Mr Edouard Roussel.
J’ai quitté Virginia les larmes aux yeux. J’avais passé quatre années très heureuses là-bas, sans soucis, sans responsabilité qu’à moi-même pour entrer à un nouveau théâtre sur une scène nouvelle où j’aurais à remplir un rôle tout différent de celui que j’avais joué jusque-là et dont on verra les développements dans la suite.
J’avais alors 22 ans; une moustache naissante, un cœur libre et un gousset bien garni de mes petites économies faites pendant quatre ans de propriété sucrière. J’étais l’hôte de mon beau-frère et de ma sœur et n’y dépensais mes appointements qu’en proportion de mes modestes besoins, ceux d’un jeune garçon qui a tout ce qu’il lui faut.
Je déposai ma petite fortune entre les mains de ma mère qui la serra dans ses armoires ne me donnant que tout juste ce qui m’étais nécessaire pour mes maigres besoins, en attendant le moment où j’aurais trouvé un nouvel emploi.
Ce premier emploi fut celui de stagiaire à l’Etude d’Alphonse Geffroy, notaire. C’était l’oncle et le parrain de ma future épouse qui à ce moment était encore dans les brumes d’un lointain horizon et lorsque ce patron m’adressait d’un ton sec d’orgueilleux notaire riche la parole, ou un ordre je ne me doutais pas qu’un jour viendrait où il me recevrait chez lui la bouche en cœur et le sourire aux lèvres.
Je restai quelques mois seulement dans la basoche. Je connus là mon ancien condisciple Ernest de St Félix qui fut plus tard sous mes ordres pendant qu’il administrait la propriété Union Bel Air et que j’étais l’Agent de l’Agricultural Cy remplaçant pour un temps Amédée Hugnin fils parti pour la Maison Mère à Londres. Mais n’anticipons pas. Il y avait encore à l’Etude Geoffroy Auguste Boulanger, un parent de la famille Geffroy, les Guimbeau, Gustave et Adelson, Marquay etc.
Le métier de Clerc de notaire est un métier qui laisse beaucoup de loisirs aux Employés et ces derniers en profitent pour passer du bon temps. Lorsque le travail chômait les Clercs s’échappaient un à un ou plutôt deux par deux pour s’installer dans un couloir de la cour de l’Etude qui faisait face à la Cathédrale de Port Louis, et là, assis sur les paliers des portes on jouait aux échecs avec une attention soutenue ce qui faisait voir la longueur du temps qu’on pouvait dérober au travail sans être dérangés par les patrons sortis eux-mêmes à la recherche de clients ou d’affaires.
Métier stupide si on n’a pas l’intention de l’approfondir pour devenir notaire un jour et c’est ce qui m’échut un beau jour.
Mr Alfred Koenig le père d’Henry mon beau-frère se prit de passion pour moi et me procura un surnumérariat à l’Agricultural Compagny, une maison de Crédit pour Propriétés Sucrières et dont Mr Joseph de Coulhac Mazerieux un Bourbonnais ami de mon père était le « Manager ». J’entrai dans cet Etablissement en 1883 piloté par Mr Koenig qui me guida dans la suite, jusqu’au moment où la mort de sa femme l’ayant grandement abattu, il dut prendre sa retraite et aller habiter chez son fils Henry à Caselà, comme je le raconterai dans la suite.
Je passai trente-sept années dans ces deux institutions : The Agricultural Cy et The Credit Foncier of Mauritius Ltd. Toute une existence, n’est-il pas vrai ? Et après une quinzaine d’années passées à l’Agricultural dont je fus nommé Liquidateur, je fus versé au Crédit Foncier où je passai 22 ans, pour finir aussi par devenir un co-liquidateur de cette puissante Compagnie avec Messieurs Eugène Gallet et Camille Rey.
Les collègues de l’Agricultural étaient Mrs Berchon, père et fils, deux Bourbonnais, Parent, homme de couleur, Bourbonnais aussi (choisis apparemment par Mr de Mazerieux notre compatriote) Noel Cayeux qui devint fou plus tard. Julien Couve, Jules Bonnin, Eugène Domaire, Perindorge. Ceux du Crédit Foncier étaient Camille Rey, Arthur de Senneville, qui fut plus tard le parrain de ma fille Hélène, Henri Julienne, Edgar Julienne, Edouard Piat, Joseph Roussel, le fils d’Edouard Roussel le héros de Virginia dont j’ai déjà parlé, Seymour Hitié, homme de couleur, auteur de la brochure Le Théâtre à l’Ile Maurice de 1768 à 1915.
J’oublie à propos des employés de l’Agricultural, de mentionner le bon Léon Lailvaux, patira de tous les collègues et en particulier de Camille Rey et d’Henri Julienne. Il me suivit à la Maison Blyth à l’époque de la Liquidation de l’Agricultural, et nous passâmes là plusieurs mois jusqu’au moment où les propriétés Pieter Both, Médine, Union Bel Air Unité furent saisies sur moi Liquidateur par le Crédit Foncier et on se les fit adjuger pour se récupérer des avances faites à l’Agricultural et se chiffrait à des centaines de milliers de Roupies. A ce moment Lailvaux et moi retournâmes rue du Rempart pour faire partie du personnel du Crédit Foncier.
Un des satellites de l’Agricultural Cy était le Mauritius Sugar Estates Cy Ltd, Société par actions que l’Agricultural Cy faisait marcher. Elle avait pour « Manager » d’abord Mr Ferdinand Antelme l’ancien administrateur de Savannah et dont j’ai déjà parlé à propos de Virginia, puis son neveu Célicourt Antelme qui habitait « Passy » à Quatre Bornes auquel je succédai plus tard comme locataire de « Passy ». Le “Mauritius“ avait un seul employé : Ferdinand Pigneguy, qui jouait agréablement du violoncelle dans les différents concerts qui avaient lieu à Port Louis ou à Curepipe.
Ce fut un bon temps que celui passé dans ces Maisons de Crédit, et la cordialité la plus grande régnait entre Chefs et Employés.
Une rivalité existait pourtant entre Mr de Mazérieux et Monsieur Amédée Hugnin père due au fait que ce dernier avait compté que l’Hon. Célicourt Antelme père qui pendant un voyage en Europe fonda l’Agricultural lui en aurait donné la gérance alors que le père Célicourt rencontrant Mr de Mazerieux en Europe l’avait déjà nommé Administrateur et que tous les deux revenaient sur le même bateau.
Depuis la guerre de 1914 à 1918, ou plutôt pendant la guerre les sucres atteignirent des prix fabuleux, qui permirent aux propriétés sucrières de se liquider envers l’Agricultural et le Crédit Foncier. C’est ainsi que le Mauritius S.E. nous tira sa révérence, et quitta l’Immeuble de la rue du Rempart pour aller s’installer à un étage d’un immeuble à la Rue de la Reine donnant sur la Place d’Armes. D’autres bailleurs de fonds lui firent des avances d’entre coupe, et il y eut Nemours Raffray comme secrétaire, Pigneguy aux mêmes fonctions qu’avant, et je fus nommé comptable cumulant avec mes fonctions au Crédit Foncier. Les propriétés étaient : L’Etoile à Flacq, Riche Bois au Grand Port, la Rosalie aux Pamplemousses, et Asthrea au Grand Port.
Cette société fut longtemps prospère, et garnit pleinement la bourse des actionnaires. Mais survint un moment où les spéculateurs voulurent éventrer la poule aux œufs d’or en liquidant la société et il y eut alors une lutte entre spéculateurs et conservateurs pour décider du sort du Mauritius S.E. qui se termina à l’avantage de ces derniers. Il n’y a pas de doute que j’ai été pour beaucoup dans le maintien de l’existence de la Société par les nombreux articles de journaux que j’ai écrits sur elle, établissant de façon irréfutable la solidité de la Société au moyen de statistiques et de tableaux financiers et dévoilant la cupidité des spéculateurs qui voulaient jouir du présent en sacrifiant l’avenir de la Société.
La liquidation du Mauritius survint pourtant plus tard et elle ne fut pas faite par moi mais par un employé, Mr Lousteau, qui était d’abord comptable à Riche Bois puis nommé secrétaire à la mort de Neymours Raffray, et au retrait de Fernand Pigneguy et qui fit la liquidation à la lueur de mes pauvres lumières parce que quoique démissionné comme comptable j’ai bien voulu diriger Mr Lousteau à travers les méandres de chiffres, lui m’ayant demandé de le conseiller.
La pléthore d’argent dans le pays causée par les beaux prix des sucres amena fatalement les propriétés sucrières à faire elles-mêmes leur faisance valoir et à se passer de bailleurs de fonds. C’est ainsi que le Crédit Foncier dut entrer en liquidation en donnant à ses actionnaires un dividende énorme que la hausse du change était venue encore arrondir. C’était alors en 1920. Nous liquidâmes donc la Société d’abord Rue du Rempart jusqu’au moment où le bel immeuble fut vendu à l’Assets & Anglo Ceylon Cy et ensuite aux différents endroits où nous avons trouvé de l’emploi : Mr Gallet à son bureau de crédit, sur la chaussée, Camille Rey sur la place et moi à la Maison Stafford Mayer & Cie dont j’étais le chef comptable.
Pendant cette liquidation du Crédit Foncier j’avais été nommé comptable du « Comptoir Franco Mauricien » et au départ des deux bandits qui étaient à la tête de cette Société : Messieurs Justrabo administrateur délégué, et Brodier son adjoint. Ces deux Français ont fait des coups pendables dans cette société et Justrabo est parti en emportant 30 000 francs qui se trouvaient en traites dans le Coffre qu’il vida avant de m’en remettre la clé en disant qu’on lui devait des appointements qu’on ne lui avait pas payés.
Je fus, au départ de ces gens, nommé administrateur délégué en même temps que je conservai le poste de Comptable.
Raoul Noel me fut adjoint à un moment donné pour s’occuper des Ateliers de Charpenterie et Menuiserie de Curepipe composés de Français et de Belges et d’un Camionnage, d’un atelier de réparations d’automobiles.
Quel calvaire j’ai gravi en 1920 et 1921 avec cette administration, et la direction d’ouvriers français rebelles et rancuniers de l’aventure des Justrabo et Brodier chassés du Comptoir… J’ai même été menacé d’être frappé par un nommé Carvi, gaillard de plus de six pieds de haut bâti en force, qui croyait que le Comptoir ne lui paierait pas ses appointements à la suite de difficultés survenues dans la régularisation des pouvoirs à Paris, et qui s’en prenait à moi personnellement.
Enfin une solution se présenta et Mr Jean Mathieu le représentant des M. et M. Guillemin et Cie qui avaient vendu leurs magasins de Bijouterie et de Modes au Comptoir et qui l’avaient repris, Mr Mathieu dis-je, prit la suite et je crois qu’à part les Magasins Guillemin tout le reste fut liquidé.
Un des ouvriers français du Comptoir, Mr Toni, ne se fit pas rapatrier avec les autres : il demeura dans le pays, épousa une Curepipienne qui avait de l’argent, et acheta plus tard la belle campagne du Docteur D’Arifat à Curepipe, campagne que je voulais acquérir moi-même en 1921 et dont Mr Lamberty le propriétaire demandait Rs 35 000 ce qui dépassait de beaucoup mes capacités. Ce même Tomi trouva moyen de devenir grand constructeur et je le retrouvai en 1939 où il assista en qualité d’entrepreneur pour le Compte du Mauritius Building Cy, et adjoint à Messieurs Genève, Colin, et Auguste Essou directeurs de la « ferme » à une réunion de Fabrique de la paroisse de St Jean pour fournir des explications sur la marche des travaux de l’érection du clocher de l’Eglise de St Jean.
Maison Stafford Mayer & Cie.
En 1923, Wilfrid Mayer vint un jour me voir à Muneville (la campagne que j’occupe aujourd’hui (1941) et qui avait passé de mes mains à celles du Dr Jeetoo) pour me proposer de la part de son frère Stafford un poste dans la Maison de Commerce. J’étais à ce moment bien abandonné par la fortune, et commençais à compter mes sous. Mon pauvre petit benjamin Jacques venait de mourir, après une longue typhoïde qui avait entrainé de grosses dépenses pour sa maladie, sa mort, ses obsèques et se fut providentiel de recevoir cette visite de l’excellent cousin Wilfrid venant m’offrir ce poste de Rs 500 par mois qui était celui de secrétaire de Enyati Colliery Ltd, une compagnie d’exploitation de mines de charbon au Sud Afrique.
Mais je ne savais pas suffisamment l’anglais pour occuper ce poste et lorsque je me présentai chez Stafford, il y eut un moment d’ennui pour moi de lui avouer que je ne serais pas à même de faire une correspondance anglaise et je me préparais à m’en aller « gros Jean comme devant » lorsqu’une heureuse inspiration s’empara de Stafford et de Louis Adam co directeur qui me confièrent le poste de Chef Comptable de la Maison S.M. Cy Ltd, occupé par Maxime Bonnieux qu’on nomma alors secrétaire d’ Enyati Colliery Ltd qui était une des branches de la Maison.
Je restai sept années à ce poste et lorsque survint la débâcle occasionnée par la trop grande spéculation sur les sucres j’en fus nommé Liquidateur en même temps que de deux auxiliaires formées pour étayer la Maison renaissante qui malheureusement succombait de nouveau. Ces deux sociétés auxiliaires étaient le Mauritius Financing Compagny et le Stafford Mayer Financing Organisation Cy Ltd.
La liquidation de ces trois sociétés dura encore 3 années, de sorte que je passais 10 ans en tout dans ces occupations commerciales.
Puis, je fis différentes liquidations que me procura Louis Adam. Les Magasins du Printemps dont son père Henri Adam était agent à Maurice, le Mauritius Trading Cy, le Mauritius Import Cy, Cletrac Cy. La société des Logements à Bon Marché (procuré par Joseph de Mazérieux) et je fis aussi la Comptabilité des Mandants de Stafford Mayer, en l’espèce ses cousins, cousines, les Mayer et Chazal.
Mais tout « finit par finir » et bientôt je fus dans la plaine lorsque Henry Koenig qui s’occupait des livres de la Société Héritiers L. Rogers et de l’Etude Lacoste mourut. J’eus la chance d’obtenir ces postes après lui, et Louis Adam me pria de m’occuper du Commercial Agencies. Entre temps, et pendant que j’étais encore chez Stafford, je fus nommé co-auditeur du Mauritius Sugar Syndicate avec Camille Reyaux appointements de Rs 1000 par an.
J’obtins ensuite la comptabilité de la branche d’Assurances de la Maison Ireland Fraser Cy qui lui venait de la débâcle de Stafford Mayer et que je faisais alors que j’étais Chef Comptable de la Maison.
J’eus aussi quelques audits : La Société Commerciale Maurice Réunion (importation de riz de Saigon à la Réunion) et quelques autres de moindre importance.
On pourrait penser en lisant cette copieuse énumération de postes, que je devais me faire un argent fou me remplissant les poches et me hissant au sommet de la fortune et de l’aisance, il n’en était rien de semblable pourtant, et ce n’était que minces filets d’eau insuffisants à former un petit « canal » qui parfois tarissait dans les intervalles des occupations de postes.
La pauvreté avait pour moi la passion que moi-même, tertiaire de St François, je n’avais pas suffisamment pour elle … « Dame Pauvreté » s’installa chez moi et n’en bougea plus ! et ce n’est que dans le cours de mon existence que soumis à la Volonté Divine, j’acceptais progressivement de me vêtir de cette vertu pour acquérir quelques mérites pour le Ciel.
J’espère n’avoir pas fait trop souffrir ma chère femme et mes enfants pendant les 55 années que nous avons ensemble traversé l’existence, et je me console en constatant que la Providence a permis que j’aie élevé, fait instruire, marié, tous les miens, sans que je n’aie succombé à la peine.
Nous sommes en 1941, et je suis là encore à la veille de me trouver tout seul avec moi-même lorsque Claire sera mariée dans 6 mois d’ici et que Jean, qui quoiqu’il ait laissé passer le temps désirable pour convoler en « justes noces » semble s’éveiller à l’appel de cette mystérieuse nécessité de se rendre compte qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul !
Je serai donc tout seul ! Mais comme je viens d’écrire que ce n’est pas bon d’être seul, je tacherai d’être moi-même mon compagnon de solitude. A 81 ans avec une mémoire encore si bonne, je puiserai dans mon propre fond les éléments de distractions, en rappelant tour à tour les fantômes de tous ceux que j’ai connus pour causer avec eux du passé et revivre avec eux une longue existence.
Puis j’aurais mes Livres, mes archives, mes chers souvenirs ! Qu’il est doux de plonger au hasard ses mains dans un fouillis de lettres ou de récits pour vivre du passé… revoir des figures aimées, entendre des voix chères…
A chaque fois que souffre mon pauvre cœur, j’ouvre et relis certains carnets, certain journal qui le console et me redonne courage pour supporter la vie, et attendre la mort. Parce que je sais, enfin, que le Ciel n’est que le recommencement épuré de notre existence sur la terre, et que le Bon Dieu nous éprouve les uns et les autres pour nous faire mériter de vivre spirituellement en haut, dans toute sa beauté cette vie temporelle que nous n’avions pas su comprendre dans toute sa valeur. Oui, oui, au Ciel on se reconnaitra, au Ciel on s’aimera toujours dans la pureté des Anges du Tout Puissant….
N’ayant malheureusement plus suffisamment de travail maintenant pour occuper mon temps, puisque je n’ai conservé que quelques comptabilités qui n’exigent ma présence en Ville que quelques jours au début du mois, je suis plein de loisirs, et pourrais faire beaucoup de choses pour moi-même; mais la vieillesse (81 ans passés) m’a retiré beaucoup de moyens d’action et d’énergie corporelle. Il me reste alors de la force morale, et de la bonne volonté. L’esprit est prompt à comprendre les buts de la vie, et les moyens à employer pour mener cette vie à une heureuse fin !
Entre autres moyens que j’emploie maintenant pour attendre l’heure fixée par Dieu pour le grand voyage dont on ne revient pas, se trouvent les pratiques religieuses, qui affermissent mon âme, et me rendent prêt à répondre à l’appel qui me sera fait un jour. Ne pouvant exercer un apostolat actif, qui m’eut placé en meilleure posture pour gagner le Ciel, je tente de tout mon cœur à y tendre par l’oubli de moi-même et le désir de servir mon prochain à toute occasion : Mais qu’il est difficile de se dire qu’on fait toujours la Volonté de Dieu en toutes choses, et que votre prochain est toujours content de vous.
Dans les longues journées d’inactivité du corps mon esprit travaille de lectures, de méditations. Je me mets à jour de mes obligations spirituelles, remplis mes offices, et égrène longuement mon Rosaire. Ce dernier pieux devoir m’incite à penser et à prier pour l’âme de ma chère disparue qui m’avait enrôlé dans la Confrérie et qui m’avait toujours donné l’exemple de l’assiduité à la prière et poussé à une grande admiration pour sa piété sincère.
Tout accepter, ne se plaindre de rien, supporter la pauvreté avec tout le chagrin qu’elle vous impose de ne pouvoir secourir les siens et son prochain comme on le voudrait, subir les infirmités du corps inhérentes à votre grand âge, lesquelles vous cabossent de soudaines fatigues et paralysent vos bons mouvements, voir s’allonger la route, et raccourcir vos pas lorsqu’il s’agit d’entreprendre le chemin qui mène à l’Eglise ou bien au Cimetière, de visiter les siens et d’aller caresser vos petits-enfants qui grandissent éloignés de vous, que de privations à offrir à Dieu pour qu’il nous trouve un peu de résignation, un peu de mérite.
Que faire d’autre, Seigneur, que de m’écrier : Voyez où j’en suis rendu sur la longue route que vous m’avez tracée, voyez si je chemine comme vous l’entendez, si ma course vous plait, si j’arriverai au bout en gagnant le prix. Sinon O mon Dieu clarifiez ma marche, redressez mon attitude, donnez-moi courage et prenez pitié de ma faiblesse.
J’ai raconté ailleurs dans ce même livre, mes jeunes années et le moment où l’amitié puis l’amour m’avait transporté de l’adolescence à l’âge de l’homme qui s’adjoint une compagne pour traverser à deux une existence plutôt longue. J’ai parlé de mes fiançailles, de mon mariage, de la naissance de mes enfants mais je n’ai point parlé de cette période d’attente que subit toute créature entre le moment où elle aspire à la joie de vivre et voit l’avenir s’entrouvrir progressivement devant elle et le moment précis où cet avenir se fixe positivement pour elle…
Je me rappellerai alors les relations diverses que j’ai eues avec les gens divers que j’ai connus, les sociétés que j’ai fréquenté, les routes traversées qui m’ont en somme conduit là où ma destinée l’a voulu.
Au retour de Virginia je fus quelques temps sans emploi et libre d’un temps que je trouvais difficilement à employer et j’allais alors empêcher les autres de travailler en fréquentant leurs bureaux.
Abel et Alfred Chevreau mes cousins s’occupaient d’une Maison de représentation puis de fabrique de meubles et s’étaient adjoints à l’Hôtel des Ventes d’Edgar et Oswald Mayer, ce dernier devant épouser dans la suite Elisa Chevreau la sœur de ces Messieurs.
L’Hôtel des Ventes était le rendez-vous d’un tas de camarades qui traversant la Rue du Gouvernement entraient tout à tour faire la causette, annoncer une nouvelle ou en apprendre une. D’Emmerez de Charmoy, Félix Ducray, Joseph Ducray, Félix Ducler des Rauches qui devint plus tard le beau-frère d’Abel Chevreau en épousant sa belle-sœur Mlle Martin.Fassanges Trébuchet un pianiste amateur qui jouait toutes sortes d’airs sur les pianos exposés en vente au Magasin de Commission. Edouard Newton un frère à Sir William Newton – Henri Robert qui avec Paul Chevreau et Félix Ducray écrivaient des nouvelles dans le Cernéen, Robert une petite plaquette intitulée « Cousine aux pieds nus ». Cette phalange de jeunes littérateurs faisait le pendant à une autre société de jeunes gens cultivant les lettres dont je faisais partie, et nous avions formé un cercle littéraire sous le titre de « La Junte de Maurice ». Ce cercle se trouvait dans un pavillon qui était au fond d’une cour donnant sur la Rue du Gouvernement et tout près du théâtre de Port Louis. Les membres de la « Junte », en dehors de ceux nommés plus haut se composaient encore de Gabriel Rochery, Adrien Despercsis, Maurice Le Blanc et d’autres dont les noms ne me reviennent pas. Tous, d’anciens camarades du Collège St Louis, qui continuaient là une amitié que nous étions heureux de prolonger au-delà du temps de Collège.
Cela nous servit dans la suite car les frères Ducray devinrent de remarquables écrivains et d’habiles rédacteurs du journal le plus ancien de la colonie, le Cernéen. Henri Robert fut le rédacteur du Radical et les autres se tirèrent d’affaire au point de vue classique et littéraire. Pour ma part, je fus un collaborateur du Cernéen pendant de longues années, ce journal publiant mes Etudes sur les Cyclones et les nombreuses discussions scientifiques que j’eus avec Mr Claxton directeur de l’Observatoire de Maurice.
C’est de l’Hôtel des Ventes que partaient les projets de distraction et d’amusements, de diners et de réceptions. On s’y donnait rendez-vous pour un spectacle de théâtre, une soirée au Cirque Felix, un diner à l’Hôtel Massé sur la Place du Quai, Hôtel aujourd’hui transformé en Bureaux, en Boutiques de Chinois ou de Tabagies etc….
Il y avait aussi les promenades à travers la bonne ville de Port Louis; il n’y avait pas un coin de la Ville, pas une rue ignorée de nous. Xavier Le Vieux et moi nous avions entrepris de faire le plan de Port Louis rien qu’en traversant chaque rue et dessinant sur un plan. Les promenades au Champ de Mars à la tombée du jour étaient pleines de charmes. On rencontrait alors à cette époque de jolis équipages occupés par du bon monde de la société Mauricienne. Scarrisarish, évêque de Port Louis faisait chaque après-midi le tour du Champ de Mars en voiture découverte attelée de deux beaux chevaux blancs. Son profil impeccable se détachait de la voiture et il penchait sa belle tête sur son bréviaire qu’il disait en se promenant.
Nous jeunes gens allions nous asseoir au milieu des grandes herbes qu’on n’avait pas encore fauchées et nous devisions de l’avenir et de ses promesses.
Entretemps nous formâmes un « Cercle » installé dans le grand bâtiment de la Loge de la Paix devenue plus tard l’Union Catholique. On y faisait le billard et les cartes. Les Membres étaient Edouard Mathé le célèbre pianiste compositeur Eugène Le Guen, Jules Bonnin Rigaudaud, Felix et Joseph Ducray, d’autres amis du Collège dont je ne me souviens pas des noms.
Heureux temps de jeunesse à l’abri des soucis et des préoccupations tout adonnés aux plaisirs honnêtes et sans dangers.
Xavier Le Vieux et moi frais émoulus des cours de Minéralogie de notre professeur le père Jouan avions collectionné les minéraux de l’ile que nous allions chercher un peu partout. C’est ainsi que munis de petits marteaux et de ciseaux nous allions désincruster des cristaux de « Feldspath » des pierres du remblai d’un ponceau au Château d’Eau au fond du Cirque du Champ de Mars et ces pierres en contenaient en bonnes proportions. Puis accompagnés du père Jouan et munis de valises nous allions « trier » des minéraux au Caudan près de la rade. C’était là que les navires arrivés sur lest jetaient leur cargaison de roches de toutes sortes et nous avions ramassé beaucoup de pierres rares, de minéraux précieux qui furent l’objet d’une jolie collection aujourd’hui disparue.
Les Courses de l’époque dont je parle étaient à mon avis beaucoup plus intéressantes que celles d’aujourd’hui, parce que moins intéressées. On y allait pour voir les chevaux courir et non point pour s’enfermer dans le stand consulter la cote des dits chevaux et engager des sommes assez fortes sur leur valeur. Les anciennes loges étaient en bois et se montaient au moment des courses pour être démontées tout de suite après la « semaine des Courses » en dehors de laquelle il n’y avait plus d’autres courses jusqu’à l’année suivante. Tandis qu’on en abuse actuellement où il y a courses à Port Louis, courses à Floréal et cela deux ou trois fois par an.
Enfin il y avait le théâtre, les bals, les soirées chez les demoiselles Duvivier qui tenaient pension dans l’immeuble occupé aujourd’hui par l’Eastern Telegraph Cy à la rue du Rempart qu’on a eu la sottise de débaptiser de son nom et qu’on appelle maintenant Rue Edith Cavell en mémoire d’une anglaise assassinée par les Allemands pendant la guerre.
J’allais quelques fois en soirée et plusieurs fois à de grands bals. Je me souviens d’un beau bal donné par le vieux tonton Edmond de Chazal à des officiers d’un navire de guerre dans sa belle demeure de la « Maison d’Epinay » dans la rue du Rempart. D’un autre donné par M. Jules Dupin dans son superbe bâtiment de la Rue St Georges que Paul Chevreau a habité à son arrivée de France où il avait été se faire recevoir médecin. D’un autre à l’Union Catholique. Je crois avoir déjà parlé de celui donné aux Cassis donné par mon grand-père Furcy de Chazal à la majorité de ma cousine Elisa Chevreau. Ce fut grandiose. Un autre bal eut lieu à Haute Rive chez Rodolphe de Chazal qui avait épousé Louise Hardy mais ce bal me laisse un souvenir douloureux parce que j’en revins dans la nuit à Port Louis malade comme une bête. Et par-dessus le marché j’avais été chargé de reconduire Marthe de Rosemond chez elle et la souffrance ne me rendant aucunement aimable envers elle.
Un autre bal très réussi fut celui donné par je ne sais plus qui dans un immeuble à toucher la Flore Mauricienne. Beau monde, joli coup d’œil buvette soignée.
Il y avait aussi des petites sauteries « dilo disic » où on s’amusait à très peu de frais de façon à les répéter plus souvent; c’était la conséquence de souscriptions de » Sociétés de Vert » et autres associations, et il est sorti beaucoup de mariages de ces petites réunions dansantes.
Mon vrai plaisir était le théâtre… Cette lointaine époque était fertile en troupes artistiques de grande valeur et j’ai entendu à ce moment et vu jouer d’illustres acteurs que jamais plus on a entendus dans la suite des temps. Il serait trop long d’énumérer les noms des artistes entendus et je réfère ceux qui voudraient à tout prix le savoir la petite brochure de Mr Seymours Hitié « Le Théâtre à l’Ile Maurice » qui entre dans tous les détails voulus.
L’Incendie de la Chaussée
Je préfère faire des bonds dans l’espace et raconter ce qui se présente à ma mémoire à un moment donné. Cela manquera de suite dans la chaine des jours écoulés mais n’en aura pas moins de valeur historique, ce qui est le principal.
L’incendie de la Chaussée éclata en 1893 après le cyclone du 29 Avril, désastre inouï subi par la Colonie, cet incendie fut un autre énorme fléau qui détruit tout un quartier commercial de Port Louis, ruina beaucoup de commerçants, Français pour la plupart. De la gare centrale jusqu’au Jardin de la Compagnie, et ensuite le long de la rue du Rempart, il n’était plus resté pierre sur pierre. Il est vrai de dire que les Immeubles étaient en bois et vieux comme Port Louis.
Cette rue de la « Chaussée » contenait les plus anciens mais les plus beaux magasins de la Colonie, ceux du hight life mauricien. C’étaient ceux de Derouchy (français) de Modes et Merceries, Bideaux et Thenou Marchands Tailleurs (français aussi) et Mons Chrétien Mr Tournais (merceries); en face les Bijouteries et Joailleries Jaillet Guillemine, Mr Vidal et Anderson (français toujours) puis Marabal qui avec sa boutique de 10 pieds carrés contenant tout ce qu’on pensait désirer, fit une fortune assez respectable. Basset Opticien qui répara mon baromètre. Pomelet (français) qui à son magasin de merceries avait joint une bibliothèque et inauguré le « Livre Echange » ou pour « six pence » par mois je crois, ou 1 shilling on pouvait échanger quatre fois les livres.
Dans les rues adjacentes à la Chaussée, c’est-à-dire la rue du Rempart, la rue qui longe le ruisseau du Pouce, il y avait la Pharmacie Baschet, la Quincaillerie Harter, la lenimaderie dont j’oublie le nom. La Maison Elias Mallac – Sèvres Armurier, Bideaux Bronner fabriquant de meubles et d’autres beaux bâtiments, demeures privées etc.
J’habitais la propriété Médine à cette époque et je me souviens qu’allant prendre le train à la gare de Petite Rivière pour me rendre à l’Agricultural où je travaillais je voyais circuler dans l’atmosphère des tourbillons de papier calcinés que la brise chassait de Port Louis et sur ma question posée à un passager du train sur le motif de ce nuage noir il me fut répondu en créole cette phrase : « Na pi au port, tous la case fine bourlé ». Et je dus constater les terribles dégâts à mon arrivée en Ville.
L’Incendie de l’ « Hôtel de l’Univers ».
A l’endroit où se trouve aujourd’hui le bel Immeuble en pierre qu’on nomme l’Institut Bowen du nom d’un gouverneur de la Colonie qui en posa la première pierre se trouvait en 1877 ou avant, une rangée de beaux bâtiments formant un groupe de Magasins et Bureaux et au centre l’Hôtel de l’Univers qui faisait face au Jardin de la Compagnie et tournait le dos à une ruelle qui n’existe plus et forme le carré qui encadre l’Institut. La Maison Coutenceau formait l’angle du carré du côté de la rue de la Comédie aujourd’hui Rue Félicien Mallefille.
Or ce carré d’immeubles comprenant l’Hotel de l’Univers brula de fond en comble vers 1878. Je me souviens qu’on arrêtait les passants dans la rue pour aider à former la « chaine » qui puisait de l’eau dans le canal qui passe entre cet endroit et le Jardin de la Compagnie afin d’éteindre l’incendie et que mon père qui traversait la rue dut aider à faire cette « chaine ». Mais rien n’y fit et l’incendie fit son œuvre complète.
Le cyclone du 29 Avril 1892
Une petite Brochure sur ce cyclone a été publiée à cette époque par Raoul Ollivry avec ma collaboration artistique. J’ai en effet dessiné sur la pierre lithographique tous les dessins qui illustrent ce petit ouvrage qui est d’une grande valeur historique, car il se compose de récits publiés par les journaux à ce moment et d’observations diverses recueillies de partout de ceux qui avaient noté les différents aspects et incidents du météore. On peut donc se référer à ce petit appendice pour se rendre un compte exact des effets que produisit ce mémorable et épouvantable cataclysme. Ce que je veux noter ici, ce sont mes impressions personnelles et le récit de ce que j’ai vu et éprouvé.
J’habitais alors aux Vacoas une petite maisonnette couverte en chaume louée d’un propriétaire créole nommé « Trousquin », à l’effet de faire changer d’air à ma petite famille éprouvée par les fièvres contractées à Médine où nous habitions. Nous étions à la fin de notre changement d’air et devions rentrer à Port Louis dans les premiers jours de Mai. Certains effets avaient même été transportés en Ville, entre autres mon baromètre, qui aurait-on pu penser, n’était plus nécessaire à cette époque de l’année.
Ma femme et moi dinions la veille chez M. et Mme Léopold Draeger à une petite distance de l’Eglise de la « Caverne » aux Vacoas et certes pendant que nous prenions part à un succulent repas chez Mme Draeger (Mathilde Ducray, l’amie de pension de ma femme) on ne se serait pas douté qu’après diner vers les 9 ou 10 heures du soir Gabrielle et moi aurions les plus grandes difficultés à regagner notre maisonnette ou nous avions laissé nos trois ainés Marie, Emile et Jean sous la garde de la bonne et que pendant le cours de ce court trajet de chez Draeger a chez nous, nous serions obligés de cheminer serrés l’un contre l’autre, bousculés par les rafales commençantes et trempés de pluie.
La nuit s’écoula sans trop d’accentuation des phénomènes et le lendemain matin je partis prendre mon train à la gare de Vacoas dans une carriole en compagnie d’un autre habitant des Vacoas, professeur au Collège Royal, Monsieur Morin. Le voyage de la maison à la gare fut très difficile en raison des rafales plus fortes que dans la nuit, et de la pluie qui nous cinglait le visage.
Dans le train ce fut pire: tout le long de la voie ferrée on assistait du haut des wagons à Impériales à d’étranges manifestations du vent. La tête des arbres était décapitée sous nos yeux, fauchée par la brise qui devint de plus en plus violente à mesure que l’on s’approchait de Port Louis et lorsque rendu en ville je me dirigeai vers le Crédit Foncier ce fut sous une vraie tempête. Entre temps lorsque nous débarquâmes à la gare centrale nous vîmes le Docteur Meldrum directeur de l’Observatoire qui lui se rendait aux Pamplemousses et on l’entoura pour lui demander des nouvelles du temps. « It’s Trade Winds » répondit-t-il aux interrogateurs. « Ce sont les vents alizés » !!! et les profanes s’en allèrent sur cette réponse rassurante ne se doutant pas que beaucoup n’arriveraient pas à leur bureau comme Meldrum lui-même n’atteignit pas ce jour-là l’Observatoire ayant de plus perdu sa femme dans la tourmente, ne sachant plus ce qu’elle était devenue.
J’arrivai donc au Crédit Foncier au haut de la rue du Rempart près du Couvent de Bon Secours. Les employés étaient tous réunis dans une des salles et l’on écoutait M.de Mazérieux le directeur de l’Agricultural Cy exposer sa théorie de l’évolution probable du cyclone d’après la direction des vents observée. M. de Mazérieux voyait parfaitement juste lorsqu’ il nous prédit que la courbe du cyclone s’approchait de l’ile en ligne directe et que nous courions le grand danger de la subir dans toute sa rigueur. Il nous conseilla de repartir aussitôt pour chez nous et de saisir le premier train en partance. Sauve qui peut général, chacun muni de ses appointements qu’il venait de toucher partit tour à tour et je vois Mr Jules Bonnin, employé des Sucres mettre dans sa valise le baromètre du Bureau qu’il croyait pouvoir consulter en cours de route et même rendu chez lui sans avoir la notion que les fluctuations du baromètre varieraient avec les hauteurs de la route. Je crois du reste que le baromètre n’arriva jamais chez lui, l’ayant quitté en cours de route en même temps que sa valise…
Je me rendis à la gare Centrale vers 10 ou 11 heures; m’installai dans un wagon où s’entassaient tous les fuyards de la ville et attendis l’heure du départ du train…
Cette heure ne vint jamais !… Mes compagnons du train et moi nous subîmes toute la tourmente dans ces wagons de 3ème classe ouverts à tous les vents et je vois encore le pauvre du Trévou à la portière du wagon, supportant la rafale et la pluie cinglante en couvrant de son mouchoir sa tête chauve ruisselante d’eau de pluie.
Les réverbères de la gare volaient en éclats et chacun se garait pour ne pas être coupé par les morceaux de vitres s’échappant des lampadaires.
Un moment vint où nous nous crûmes en bateau !.. Un terrible raz de marée dans la rade avait gonflé le flot qui pénétrait jusqu’à la gare Centrale, soulevant les wagons chargés de passagers de cinq pieds d’eau au moins.
Nous restâmes dans cette situation de 10 heures à 2h pm moment où le Centre traversa Port Louis où se fit un grand calme. Ce calme qui toujours précède la tempête, trompa beaucoup de gens qui croyant le cyclone terminé, s’aventurèrent dans les rues ou quittèrent leurs maisons dans la ville pour « promener et voir les dégâts ». Ceux-là furent heureux dans un sens et malheureux dans l’autre sens, car ils échappèrent à la mort lorsque au retour des vents plus furieux qu’avant le Centre, les maisons s’écroulaient les unes après les autres, mais beaucoup trouvèrent cette mort écrasés dans les rues par la chute des arbres et des débris de constructions. J’aurai l’occasion d’en parler plus loin et préfère poursuivre le récit de mes propres aventures.
Le passage du Centre dura une heure. A trois heures des vents furieux de 110 milles à l’heure soufflèrent jusqu’au début de la nuit. Vers 8 heures du soir la violence du vent ayant sensiblement diminué chacun sortit des wagons comme les Noe de l’arche pour se dégourdir et essayer de se restaurer au « Symposium » de la gare. Un « rush » se produisit, chacun voulant passer avant son voisin lorsque je pénétrai à mon tour je me procurai une tranche de pain que je payai 25 sous. Il y avait aussi du jambon cuit mais je n’en voulus pas parce que c’était un vendredi et que c’était maigre quoique je pense qu’en cette unique circonstance la dispense nous aurait certainement été accordée.
Puis on se regarda, on chercha à se reconnaitre, à se compter. Des blessés commençaient à arriver de la Ville et je vois encore Ivannoff de Pitray soutenant son beau-père M. Daniel en costume de nuit et la tête bandée d’une blessure, transi de froid et trempé jusqu’aux os.
Tout à coup on entend tonner le canon ! Quelle ironie du sort ! Un incendie sous un déluge de pluie du côté du Champ de Mars. Nous montons à la galerie de la gare pour voir ce spectacle rare, et en effet le feu fait rage au pied de la Montagne des Signaux. Ce sont les restes de maisons écroulées qui brulent sous l’effet de lampes allumées pendant l’obscurité du cyclone, et qui ont éclaté sporadiquement.
Cependant le temps s’améliore et on ne peut plus rester plus longtemps à la gare Centrale lorsque, comme c’était mon cas on avait un domicile à Port Louis et des parents dans ce domicile. Je quittais donc la gare à 9 heures du soir pour me rendre à la Rue St Georges où nous habitions et où se trouvait mon père et ma mère. En enfilant la rue Jemmaps qui fait face à la gare et longe les Casernes, je cheminais péniblement luttant contre les dernières rafales lorsque rendu à mi-chemin j’entendis un éboulis derrière moi; je venais d’échapper à la mort peut être ayant dépassé quelques secondes plus tôt la chute sur le trottoir d’un pilastre de porte cochère en pierres que le vent aidé par la grande humidité renversait d’un bloc. Le chapiteau m’avait manqué d’une ligne au moment où rasant le trottoir je passai près de la porte cochère…
Un autre incident se produisit lorsque je m’engageai dans la rue St Georges. Il faisait une profonde obscurité et donc pour m’éloigner des bords des maisons je marchais à tâtons au milieu même de le rue lorsque rendu en face de l’Eglise de l’Immaculée je buttai contre un amas de matériaux que je reconnus bientôt pour être les poutres et bardeaux de l’Immaculée projetés par la violence du vent. Mais j’étais tombé sur ces démolitions et en me relevant pour poursuivre ma route je me sens retenu en arrière; je me projette en avant, je suis hissé en arrière comme retenu par quelqu’un… J’avais dans la poche de mon pardessus en billets de banque le montant de mes appointements de l’Agricultural Cy que j’avais touché le matin même et ma frayeur était que j’étais retenu par un détrousseur vagabond qui allait m’assassiner peut-être pour me dévaliser ensuite. Je l’ai dit la nuit était noire d’une profonde obscurité; on ne voyait même pas autour de soi de sorte que c’était facultatif de se figurer que l’on avait affaire à un malfaiteur ou à toute autre aventure. Je finis par me rendre compte que j’étais retenu par mon pardessus accroché à un gros boulon de la charpente de l’Eglise et que j’aurais eu beau tirer à moi que je n’aurais pas réussi à me dégager sans une vaste déchirure de mon vêtement…
Alors délicatement je me décrochai et libre cette fois de toute contrainte je continuai mon chemin.
Mais il n’était plus possible de distinguer les entrées des maisons, l’obscurité étant profonde et les grandes portes en bois des cours ayant chaviré partout. A force de chercher mon entrée, je finis par la trouver. J’entrai dans l’allée qui conduisait à la Maison en écartant les bras pour ne pas cogner contre des obstacles et lorsque je jugeai que j’avais atteint les colonnes de la varangue je tâtai les portes et cognai la vitre pour me faire ouvrir.
Aucune réponse… Je criai, j’appelai, pas de réponse. Que devenaient mon père et ma mère? Où s’étaient-ils réfugiés pour échapper à la tourmente ? Je brisai une vitre du salon de mon poing, tirai la targette, ouvris la porte… Chaos devant et autour de moi. J’appelle en vain, je pénètre à tâtons et me sens entouré comme d’une écume et enveloppé comme d’un manteau. Que pouvait être tout cela! et toujours la pensée que mes parents pouvaient bien être écrasés dans un coin de la maison par des décombres me faisait dresser les cheveux sur la tête.
Je ne pouvais m’éclairer d’aucune façon et pris un certain temps à me rendre compte de ce qui m’arrivait. J’avais pénétré dans 6 pieds d’écume provenant de l’infiltration de l’eau de pluie découlant de l’étage dont le toit avait été enlevé (je l’ai su le lendemain matin) et l’enveloppement dont j’avais été l’objet provenait du lambeau de toile et de tapisserie arrachés des cloisons et qui flottaient autour de moi lorsque j’avais ouvert la porte au vent qui soufflait encore.
Je sortis de la maison; et en regardant autour de moi, j’aperçus une lumière à travers le trou de la serrure d’une dépendance… Quelle joie de voir un phare dans la tempête mais aussi quelle crainte d’apprendre quelque mauvaise nouvelle de mes parents. La cuisinière qui logeait dans cette dépendance m’apprit que mon père et ma mère avaient fui la maison dans la journée et s’étaient réfugiés dans la maison voisine qu’occupait le Docteur Le Bobinnie et sa famille, qu’ils étaient à l’abri dans l’autre maison qui ne comportait pas d’étage.
La réaction se fit en moi. J’étais trempé jusqu’aux os, ne savais que faire de ma personne ni comment me réchauffer. Je me dirigeai vers le pavillon qui était debout encore et aidé de la cuisinière je réussis à me procurer un bout de chandelle et des allumettes. Je fis de la lumière et vis un lit avec deux matelas; sans plus tarder, car j’avais de grands frissons, je me dépouillai de tous mes vêtements et me glissai tout glacé entre les deux matelas cherchant à la fois la chaleur et le sommeil.
Je ne me souviens plus si j’ai fait un sommeil sans rêves. De bon matin je me rhabillai de mes guenilles détrempées et après avoir revu mes parents je parcourus les rues de la Ville pour me rendre compte des épouvantables dégâts qu’elle avait subi dans la journée du 29. Parmi des décombres informes circulaient des brancardiers transportant sur des civières des blessés gémissant de douleur et de chagrin d’avoir perdu un membre de leur famille écrasé sous les débris ou brulé par l’incendie.
Après avoir parcouru tout le Champ de Lort quartier le plus éprouvé car il n’y restait plus une seule maison debout je me dirigeai du côté de l’Eglise St James (protestante) à la rue de la Poudrière. A l’intérieur gisaient des corps carbonisés de policiers victimes de leur dévouement à sauver les autres mais que le feu avait frappés au cours de leurs fonctions de sauveteurs. Leurs corps étaient ratatinés et ne mesuraient que trois ou quatre pieds alors que leurs tailles devaient être du double. C’était pire qu’après un tremblement de terre: rues, maisons, se confondaient dans un horrible mélange. Passages obstrués par la chute des arbres en vaste chaos, grilles renversées, murs écroulés, portes cochères disparues faisant confondre les emplacements les uns avec les autres. Cris, pleurs, lamentations des enfants sans parents, des parents sans enfants, tous perdus, introuvables, peut-être morts.
Je poussai jusqu’au Champ de Mars pour avoir un peu d’espace devant moi mais là aussi des dégâts aussi grands, des détresses aussi poignantes. La Colonne Malartic, qui était tombée tout d’une pièce et ses pierres alignées à l’arrière du Tombeau de façon rectiligne. De même, l’aiguille fléchée du Temple Protestant qui mesurait deux pieds peut-être en dehors de la pyramide de maçonnerie a été tordue par le vent dans une inclinaison de 45 degrés ce qui est un phénomène inexplicable.
Mais l’heure s’avançait et il fallait songer à atteindre la gare Centrale pour savoir si l’on pourrait s’embarquer pour la campagne où se trouvaient nos familles dont le sort nous était inconnu et qui peut-être avaient péri dans le tourment. Pas de train… les lignes endommagées, des wagons renversés sur la voie, il faut se débrouiller autrement… Nous nous réunissons par groups d’habitants des différents quartiers et les caravanes se mettent en marche. On arrive sur la route de voiture de la Grande Rivière; rendus là, le sifflet d’un train se fait entendre sur le pont de chemin de fer !.. Un train a donc quitté Port Louis pour la campagne… Nous voilà prenant nos jambes à nos cous pour courir à la rencontre de ce bien heureux train et tacher de l’attraper à la gare de Coromandel. Nous y arrivons avant le train qui allait au pas depuis la Ville et qui ralentissait encore son allure en traversant le pont car il fallut s’assurer qu’il était encore solide et en état de supporter le poids du train. Pendant que le train haletait sur le pont nous étions à la gare de Coromandel, regardant anxieusement ce qui allait se passer et un silence de mort régnait partout….
Lorsque le convoi eut dépassé le pont ce fut une clameur formidable échappée des poitrines des voyageurs qui manifestaient leur joie de se dire sauvés d’une chute qui aurait pu se produire à une hauteur de plus de cent pieds peut-être du lit de la rivière.
Nous nous empilons dans le premier wagon qui se présente et le train reprend sa course d’escargot jusqu’à la gare de Rose Hill.
Là on fait descendre tout le monde car on ne peut aller plus loin. La voie ferrée à Rose Hill est bloquée par de nombreux wagons renversés d’un train arrivé de Moka dans la journée. Chacun se débrouille et s’engage sur la ligne pour continuer à pieds.
J’étais en compagnie de Nemours Desjardins qui comme moi habitait Vacoas. Arrivés à Phoenix la voie était obstruée par des filaos renversés et nous dûmes escalader ces troncs d’arbres sur un très long parcours ce qui nous paralysa vite les jambes et rendit notre marche des plus pénibles.
Nous sortîmes enfin de cette situation et rendus à la hauteur de la gare j’eus le bonheur de voir de loin le toit de paille de la « Bicoque » que j’habitais debout. Mais dans quel état se trouvaient les habitants ?
Enfin j’arrive chez moi … Je devais avoir la mine d’un rescapé car ma femme s’étonna de me voir cet air tragique que je me sentais avoir… Qu’as-tu me dit Gabrielle ? Pourquoi cet air farouche qui nous fait peur à tous ? Ce que j’ai, répondis-je, c’est la réaction d’un homme qui sort de l’empire des morts et qui ne peut croire encore que l’épouvantable ne s’est pas produit partout et que seul Port Louis a subi le plus gros désastre. Je lui raconte alors tout ému les événements qui se sont produits depuis le matin du 29 Avril jusqu’à l’heure présente et ma femme s’associant alors à mes émotions tombe dans mes bras qui l’entourent et tous deux nous remercions le Ciel d’avoir échappé au malheur !…..
Nous quittâmes la petite paillote des Vacoas quelques jours après. Mon beau-père nous envoya de Médine un débris de la grande voiture sans soufflet, victime elle aussi du cyclone. On ne put passer par « Cressonville » pour regagner la propriété les routes étant obstruées par les arbres abattus par l’ouragan et force nous fut de descendre la grand route royale jusqu’à « Chebel », de traverser par la gare de Petite Rivière pour regagner ensuite la route de Port Louis à Bambous.
A Médine nouveau désastre : le toit de la varangue de la grande maison s’était refermé d’un bloc sur la façade de la maison, et en bloquait toutes les ouvertures… Il fallut y pénétrer de côté. La serre abattue, notre pavillon endommagé. La famille avait comme nous vécu là-bas des heures angoissantes, et tous maintenant réunis nous remerciâmes le Ciel de nous avoir épargnés….
Je veux pour terminer ce récit qui n’est que sommaire car il s’y est passé tant d’autres événements pendant ce cyclone, qu’un volume entier pourrait être écrit sur ce sujet mais la plaisante histoire d’Elysée Fouquereaux comptable à Médine demande une relation.
Il était parti pour Port Louis le 29 Avril /92 chercher la paie et l’avait même touchée de l’Agricultural et de la Banque lorsque se déchaina rapidement l’ouragan. Ayant déposé son sac d’argent chez la famille Trublet rue Labourdonnais et voyant qu’il n’y avait aucun moyen de regagner Médine il se permit pendant le passage du Centre d’aller circuler dans les rues et se dirigeant à travers la rue Pope Hennessy en direction de la rade qui était démontée sous l’effet d’un furieux raz de marée tellement considérable que les chalands étaient transportés à travers les rues jusque devant la Banque Commerciale. Fouquereaux fut arrêté devant la maison Gourrège au milieu de la rue Pope Hennessy par de terribles rafales de la reprise du vent après le passage du Centre. Il s’accrocha à la grille du mur de la Campagne Gourrège et subit là toute la tourmente, ne lâchant pas prise pour ne pas être entrainé par le vent et fracassé contre un obstacle quelconque. Le vent “ l ’éplucha “ pièce à pièce de tous ses vêtements… son pantalon s’en allait par lambeaux ainsi que son paletot et lorsqu’enfin le vent se calma il n’avait plus que des tronçons de vêtements sur lui, rappelant de loin ceux qui recouvraient notre ancêtre Adam à sa sortie du paradis terrestre.
On le vit aux Bambous le surlendemain pénétrer en cet état à l’Eglise du St Sauveur pour remercier Dieu de n’avoir pas succombé dans le désastre.
Au bout de la Route
Ce qui précède est la réminiscence du passé ! De mon passé à moi qui comprend 80 années d’existence plutôt dépourvue d’incidents sensationnels mais … la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu’elle a … et je n’ai rien inventé, ni fait de roman ce qui n’aurait pas été l’expression de la vérité. Je m’aperçois toujours que je n’ai pas raconté bien des faits et des événements qui me reviennent en mémoire « en bloc », mais j’en parlerai incidemment dans la suite au courant de la plume : je re parlerai de Caselà, d’Eau Bonne, La Ferme, Wolmar, Tamarin, de Walhalla et de Carsenac, de Yemen et du père Alfred Koenig, de Chamarel et de la Case Noyale, du Barachois après mon mariage, et des pêches en pirogue. De la Mailleraie, de Versailles, d’Oswald Mayer, de Darlonville de Mesnil aux Roses, de Clary et de La Mauveraie. Des vacances à St Antoine, à Ste Marie, du Mondrin et de tant d’autres lieux et choses pour finir par une logique description des « Quatre Vents » et de l’impression que me laisse encore dans l’âme jusqu’à présent ce paradis de ma vie « bienheureuse ».
25 Septembre 1941
Calfeutré dans mes appartements pour cause d’une crise d’ `influenza ` qui me tient depuis plus d’une semaine dans un état de fièvre et de faiblesse, je me souviens que c’est la date anniversaire de mariage de ma sœur Mina avec Henri Koenig il y a 63 ans (1878). La noce eut lieu à Port Louis. Monseigneur .Scherisbrish qui était l’ami spirituel de toutes les jeunes filles de l’époque bénit leur union dans la Cathédrale de Port Louis et le « tiffin » eut lieu à la maison Rue Bourbon. Les parents de marque des deux côtés y assistèrent et les jeunes mariés s’en furent ensuite à Constance (d’Arifat) à Flacq propriété qu’administrait alors Henri. Ils n’y firent pas un long séjour car Henri prit quelques mois après l’administration de Virginia où je devais les retrouver en 1879. O mes frères affectionnés, où êtes-vous aujourd’hui et qu’il semble que l’éternité se soit placée entre vous et moi sans pourtant atténuer le si vif souvenir que je conserve de vous et des bons jours passés ensemble…
27 Octobre 1941
Tout arrive ! Qui aurait jamais pensé que Jean mon fils cadet se serait décidé à faire comme tant d’autres et à permettre que le petit dieu « amour » lui décoche une flèche de la part de Germaine Koenig et que cette flèche ait pu pénétrer son cœur… Et c’est pourtant la vérité…
Du moins si je dois quitter la terre un jour prochain j’aurais eu la consolation de voir que Dieu a pris soin de tous les miens en les plaçant sous l’égide d’anges consolateurs et terrestres afin que je puisse lui chanter maintenant le cantique de Siméon « Nune dimmittis servum tuum domine secundum verbum tuum in pace »… et partir sans regret de penser que après moi il y aurait eu des parties de moi-même à trainer dans l’abandon et la solitude…
29 Octobre 1941
Je possède dans mon salon et dans les différents appartements de ma maison quelques tableaux de famille qui ont besoin d’être expliqués pour aider ceux qui viendront après moi à en connaitre la nature, l’origine et les titres afin d’en conserver le souvenir et d’en transmettre la garde aux générations à venir de ma famille.
Hélas ! ma galerie a été amputée des portraits à l’huile de mon grand-père, de ma grand-mère et de ma tante Hortense… Ces trois portraits à l’huile figuraient dans le salon de mon père et de ma mère à Port Louis jusqu’en 1891. Par suite des outrages du temps qui les avaient lacérés et abimés, j’ai voulu sauver au moins leurs traits de l’oubli et les avais fait porter chez Rambert photographe pour en retirer des photos que j’aurais fait agrandir.
Peu pressé de nature, Rambert les garda près d’un an sans y toucher et lorsque survint le cataclysme de l’ouragan d’Avril 1892 Port Louis entier fut saccagé et mes malheureux tableaux avec le reste. On ne retrouva même pas les cadres et encore moins les toiles si périssables. J’en eus le cœur transpercé car jamais ces nobles figures de mes parents ne seront même soupçonnées de mes enfants et de mes petits-enfants.
Faisons pourtant leurs portraits aussi ressemblants que possible.
Mon Grand-père : Beau vieillard à la figure austère totalement rasée au regard droit et franc derrière des lunettes d’or. Il est assis sur un fauteuil rembourré et la main droite s’allonge sur un des bras tenant un livre. Il m’a toujours été dit que si je me rasais je serais son portrait…
Ma grand-mère: Grande figure distinguée de Parisienne du grand monde. Elle pouvait avoir trente ans au moment où on l’a peinte sur toile et ses habits rappelaient encore ceux que l’on peut voir sur une aquarelle contenant mon aïeule, sa sœur Mme Schneider et leur dame de compagnie « Tante Bœuf » dont je ferai mention ci-après. Elle est assise vêtue de noir et portant des mitaines noires.
Ma tante Hortense : Petite ange à la figure poupine avec des cheveux courts taillés à la garçonne. Elle est morte à la fleur de l’âge et l’artiste qui a reproduit ses traits délicats l’a peint au centre d’un flocon de nuages, un bras appuyé sur une couronne de roses blanches, l’autre levé vers le ciel et montrant dans un coin du ciel une vierge illuminée qui descend vers elle. Allégorie charmante et bien appropriée à l’état de bienheureuse dans lequel ma tante enfant se présentait aux portes du Ciel. Elle est vêtue de bleu et porte à son cou une chaine d’or supportant une médaille de la Sainte Vierge.
Voici maintenant ouverte la galerie des portraits qui existent chez moi de ceux qui ne sont plus :
Prenant du plus loin voici mon bisaïeul Guillaume Mazuel le Girondin qui épousa la jeune noble Jeanne Sophie Duplain de St Albine. On le voit dans l’attirail du temps de la Révolution avec sa perruque poudrée, ses anneaux et ses « carabis », il est assis sur un fauteuil de velours rouge et regarde complaisamment l’avenir.
Dans un cadre au-dessous de ce portrait se trouvent peintes à l’aquarelle ou à la « gouache », ma grand-mère Toulorge jeune femme, en compagnie de sa sœur Madame Schneider et de la dame de Compagnie « Tante Bœuf ou Beuf ? » Elles viennent de recevoir une lettre de France dont ma grand-mère a donné connaissance aux deux autres personnes présentes et à leurs physionomies plutôt satisfaites on doit conclure que les nouvelles reçues étaient bonnes.
Au-dessus de la cheminée du salon sont les photographies de ma grand-mère Toulorge mais déjà très âgée, elle porte sur sa tête une dentelle noire. A côté est, dans le même genre de cadre en plâtre peint le daguerréotype de ma grand-mère Claire de Chazal en grand costume de ce temps, qui rehausse son grand air de patricienne. J’ai déjà raconté précédemment l’histoire de ce portrait et pourquoi j’étais le seul à posséder les traits de mon aïeule qui fut aussi ma marraine. Je ne sais si mes deux grands mère ont été portraiturées à la même époque mais les dimensions pareilles et les cadres semblables le laissent penser.
Au-dessous de ces deux portraits se trouvent dans des cadres de bois d’ébène le portrait de Mademoiselle de Lamballe, qui semble être une peinture à l’encre de Chine exécutée par un artiste délicat. L’infortunée princesse était l’amie de ma bisaïeule de St Albine et ce col délicat que la peinture représente recouvert de folles boucles de cheveux, fut tranché sans pitié par les massacreurs de Septembre 1792.
Le même sort était réservé à Louis XVI et à Marie Antoinette monarques malheureux qu’on voit à gauche du portrait de Mlle de Lamballe dans un cadre rond avec un des dauphins entre eux deux. Ce portrait vient de la même source que celui de la jeune amie de Marie Antoinette et qui fut aussi l’amie de Mlle de St Albine.
En face de la cheminée du salon sous la toile d’Amande Fougère qui représente dans toute sa beauté un portrait de jeune femme tenant sa main appuyée sur un crâne et méditant sur cette antithèse de l’existence : La Vie et la Mort, la beauté rayonnante et la hideur du cadavre et de ce qu’il en reste après la décomposition finale du corps, se trouvent des tableaux non moins funéraires représentant l’un le caveau de la famille Toulorge à Bourbon contenant les restes mortels des Schneider, Mazuel, de ma tante Hortense et de mes autres parents que l’on voit représentés autour du caveau par un artiste en cheveux qui s’est servi des cheveux de ceux qui étaient couchés sous le mausolée pour imiter ou plutôt fabriquer, le monument, les cyprès, la montagne du Cap Bernard et les habits des personnages présents sur les lieux, mon grand-père, ma grand-mère, qu’un prêtre console et des trois jeunes enfants agenouillés autour de la balustrade du caveau, lesquels sont mes oncles Emile, Jules et le plus jeune mon père.
A gauche dans un cadre d’or un tableau en cheveux de Joseph Mazuel (Jacques Joseph Guillaume) mort en 1795. C’était le frère de ma grand-mère Toulorge. Ce travail en cheveux est un travail d’art merveilleux fait avec les cheveux du jeune enfant mort en très bas âge, et est une allégorie d’une vie aussitôt éteinte qu’éclose et dont le vaisseau qu’on voit faire naufrage à l’entrée du port donne une idée charmante.
A droite, dans un cadre d’or rond on a ma sœur Wilhelmine (Mina) qui est photographiée à l’âge de 4 ou 5 ans à la Réunion et j’ai hors cadre une photo de moi également prise à la Réunion où je suis debout sur une chaise veillant jalousement sur un joli petit chapeau qui se trouve sur un meuble à côté de moi. J’ai l’air un peu mécontent dans cette photo. Il parait que ce sont les dames et les demoiselles de Bourbon qui m’ont rendu maussade à force de m’embrasser parce que » j’étais joli comme un cœur ». (Cette dernière opinion m’a été racontée par ma mère plus tard).
Enfin sous le cadre du cimetière de la Réunion se trouve la miniature de Mlle de St Albine ma bisaïeule. Elle est habillée de bleu, le col dégagé, les beaux bras dehors, et assise dans un cadre frais et reposant. Cela ressemble à une peinture sur ivoire d’une jolie facture mais je lui préfère la miniature de ma bisaïeule faite par « Chatigne » et que mes parents avaient fait monter en « broche ». Quelle jolie femme que Mlle de St Albine et comme je comprends Mr Mazuel d’avoir tout fait pour l’arracher à l’échafaud et d’y avoir réussi. C’eut été bien dommage de voir tomber cette adorable tête en même temps que celle de son amie Lamballe. Cette « broche » a été donnée par moi à mon fils Emile lorsqu’il vint de Madagascar à Maurice pour épouser Jeanne Koenig, encore une jolie personne quoique d’un type différent.
A la droite de ces tableaux et portraits se trouvent les photographies de mon père et de ma mère faites à la Réunion; grandes photos où les personnes sont entièrement représentées et d’une certaine grandeur au-dessus des formats ordinaires. C’était du temps des crinolines et de la dentelle, et des cheveux en bandeau. Ma mère pouvait avoir 25 ou 26 ans dans cette photo et mon père 30 ans. Dans un petit cadre au-dessous de ces tableaux se trouve ma petite famille en 1907. Sauf Claire qui n’était pas née encore tous y sont. Je préside l’assemblée avec un air grave et fier qui avait touché ma chère épouse qui a raconté plus tard dans son Mémorial à propos de l’envoi d’un exemplaire de cette photo à M. Bertho Capitaine de Port à la Réunion avec lequel j’étais en grandes relations cycloniques, que mon correspondant avait dû se dire que son mari et ses fils étaient de « bien beaux hommes » ! …
Dans le même panneau se trouve un tableau au crayon fait par moi en 1884, représentant les campements du « Barachois » à la Baie du Tamarin, appartenant à mon beau-père Eugène Koenig et que j’avais dessiné pendant que se faisait chez moi le travail de l’emprise de l’amour sur un cœur tout neuf qui devait succomber deux ans plus tard aux attraits de celle qui fut mon épouse pendant plus de cinquante années.
J’avais pris mes points de repaire au moyen de ma chambre claire pendant des fins de semaine passées au Barachois invité par Eugène, Bernard et Michel Koenig et je terminai le tableau en Ville pendant mes loisirs, ombrant le tableau de souvenir. Lorsqu’il fut terminé je l’envoyai par Louis Koenig à Mr Eugène et je sus qu’on s’était mis à genoux devant cette merveille – tellement il était frappant et plein d’agréables souvenirs. Le Père Etcheverry, Jésuite qui était à ce moment l’hôte de Vincent Geffroy à la Meilleraye et qui avait assisté à l’arrivée du tableau était en pamoison devant la petite cuisine du Barachois, dont la minutie du travail lui sautait aux yeux.
A côté, un cadre contenant la photo de Pierrick et Hélène mes deux amours de petits-enfants qu’on n’a qu’à regarder pour en jouir pleinement.
Dans le dernier panneau du salon se trouve le tableau en cheveux de mon oncle Jules Toulorge représentant la scène de l’immersion du malheureux chirurgien de marine mort en mer à bord de la Frégate Française la « Belle Poule » qui avait transporté les restes de Napoléon 1er de Ste Hélène en France. C’était le bateau de mon oncle. Il y est mort et on voit dans le tableau entouré de la fumée d’une salve de coups de canons, la lente descente de son linceul de toile alourdi du poids d`un boulet de canon, dans les replis humides de l’Océan profond qui devait le garder à jamais !…
Au-dessous 3 daguerréotypes représentant mes jeunes oncles Emile et Jules et mon père. Ils sont en uniforme de lycéens de la Réunion.
Enfin un dernier tableau du même panneau: la photo groupe de toute ma famille directe, Père, mère, filles, fils, gendres, petits-enfants assis en grappe à nos pieds. Photo prise ici même il y a 18 ans lors de notre première occupation de « Munneville le Bingard ». Déjà des absents et des disparus dans le tableau et depuis, d’autres figures ont encore disparu.
J’oublie de mentionner la photo de mon grand-père Furcy de Chazal et celle de mon fils Joseph retour de l’Eglise en France, le jour de son mariage et accompagné des petites filles d’honneur qui tiennent la traine de la robe d’Andrée ma belle-fille.
J’aurai terminé en citant le portrait de ma sœur Mina (Wilhelmine) et celle de mes cousins le général Paul Toulorge et son fils Roger aviateur, qui se trouvent dans mon bureau ainsi qu’une toile malheureusement abimée, le portrait à l’huile de mon oncle Jules.
Solitude…. 6 Février 1942
Je ne croyais pas encore à la solitude absolue. Je pensais que l’homme que le malheur prive de sa compagne de plus d’un demi-siècle et plonge dans le chagrin, ou qui voit ses enfants se marier et quitter le toit paternel, sente le vide s’accentuer autour de lui, mais il résiste au dénuement progressif de toutes choses. Tandis que lorsque pour le simple plaisir de s’amuser en compagnie des autres les derniers enfants de la maison vous plaquent à domicile et s’en vont diner et passer la soirée ailleurs, sans souci de la peine qu’ils vous causent vous laissant « tout seul » en face de vous-même et cela de façon constante je dis que ce sont des enfants sans cœur et qui n’éprouvent pour leurs parents qu’une tendresse fictive qu’on ferait tout aussi bien d’appeler indifférence.
J’éprouve ce soir cette mélancolie du triste solitaire et je me dis que depuis quelques temps je suis « toujours seul avec ma peine amère » et qu’il est temps que les grands changements qui doivent s’opérer dans mon existence s’opèrent et que je me décide à prendre la grande résolution qui s’impose: fermer ma maison et aller habiter avec celle de mes filles qui m’offre si généreusement asile après le départ des deux derniers enfants mariés.
Le grand vide sera-t-il comblé ? Non. Mais du moins je pourrai répondre à d’autres qu’à mon propre écho et entendre d’autres voix que celle qui crie dans le désert qui m’entoure.
Je cherche dans mes souvenirs une situation semblable à la mienne et je n’en trouve pas, sauf celle qui y ressemble de très loin: de mon père après sa grande maladie vendant tous ses biens et allant habiter Caselà chez ma sœur Mina. Mais il avait encore ma mère à ses côtés pour quelques années encore tandis que j’aurai moi perdu mon bien le plus cher qui m’aurait tenu lieu de tout à la fin de ma longue existence…
Dieu ne l’a pas voulu, que Sa volonté soit faite.
12 Février 1942
J’écrivais ce qui précède le 6 février dernier comme d’une pensée qui m’obsédait et que je voulais traduire sur papier. Mais voilà que pour me contredire, une surprise m’avait été réservée pour le soir: une réunion de deux jeunes filles autour de ma table à diner. Françoise ma petite fille et sa cousine Marie avait combiné avec Claire qu’elles viendraient diner avec moi, et me tenir compagnie dans ma solitude jusqu’au moment où j’aurais eu peu de temps à attendre la rentrée de mes grands enfants énamourés qui avaient l’un été diner chez sa fiancée à Rose Hill et l’autre à une réception donnée chez ses amies de St Louis, accompagnée de son fiancé, puis terminer la soirée au Cinéma.
Je fus ravi de ma soirée, les deux jeunesses qui dinaient avec moi m’ont mis en train en me demandant de leur raconter le passé, ce que je fis volontiers à leur grand contentement…
Raconter le passé !… quel charme j’y trouve, lorsque les événements se présentent en foule à ma mémoire et que les chers tableaux de ces événements se déroulent pleins de vie à mes regards jetés en arrière. Je raconte alors pour plaire à mes auditeurs autant qu’à moi-même et je me sens récompensé lorsque je vois l’attention apportée à mes récits par ces jeunes qui n’ont pas connu les temps que j’évoque et qui semblent transportés dans un monde inconnu si peu ressemblant à leur existence actuelle…
Elles écoutent avec piété ce rappel de mes souvenirs, elles vibrent avec moi de mes grandes émotions, pleurent de mes chagrins ou de mes douleurs, rient de mes joies passées, jubilent des scènes comiques, s’enfoncent dans la réflexion lorsque j’agite des questions sévères et surtout acquièrent la connaissance des temps passés, ce qui est toujours un charme pour les jeunes qui, s’ils cherchent à deviner l’avenir, ne dédaignent pas de comprendre le passé tout en s’en étonnant…
Tout le monde n’est pas ma petite Françoise car elle est particulièrement friande des histoires d’autrefois et lorsqu’elle vous met sur cette piste, c’est pour écouter pieusement les récits qui sont faits et gouter sincèrement leur valeur historique ou familiale.
Il y a tant de gens indifférents qui jamais ne questionnent, se souciant comme d’une « guigne » de ce qui date d’avant leur naissance, qui rapportent tout à eux, le contenant dans le cadre restreint de leur petite existence, ne voyant comme on dit pas plus loin que le bout de leur nez. Je les plains bien sincèrement ceux-là qui se privent volontairement de bien des joies de l’esprit… et du cœur.
Effets de guerre :
19 Février 1942
Les anglais commencent à prendre les choses au sérieux: après avoir fait les détachés au début des hostilités, ne croyant pas possible une défaite anglaise, les voilà maintenant qui vont dépasser la mesure dans les moyens de défense et de protection de l’ile Maurice en prenant toutes sortes de précautions vexatoires qui n’empêcheront pas l’ennemi (Japonais ou autre) de nous bombarder par mer ou par l’air et de se faire un jeu d’enfant de prendre la « Perle de la mer des Indes » le jour et à l’heure qui lui plaira.
La prévoyance mère de la sureté n’a jamais été la vertu des peuples trop confiants dans leur force et leurs richesses et la perfide Albion est un modèle du genre. Elle croit toujours que sa livre sterling est l’arme la plus puissante du monde qui de plus peut se manier à très grande distance. Elle croit encore à la finesse de sa diplomatie qui a toujours roulé les Puissances qui avaient affaire à elle… Passé tout cela du moment qu’on a affaire à de jeunes gouvernements résolus à renverser les démocraties et à se substituer à elles dans la conduite du monde.
Alors il advient que l’Angleterre qui d’abord veille sa « petite ile verte » comme dit Hitler, et garde toute sa puissance pour empêcher une invasion de ce pays n’a combattu `qu’avec le sang des autres`, ne mettant en jeu qu’un petit nombre de troupes qu’elle retirait en une « retraite stratégique » aussitôt que l’ennemi se ruait sur elles. Ainsi Dunkerque, ainsi la Norvège, ainsi la Grèce.
Mais le danger est à nos portes. La porte d’acier du Pacifique vient d’être enfoncée par les Japonais et Singapour, le port puissamment fortifié est tombé en leurs mains. Le Pacifique est fermé à l’influence anglo saxonne, et de plus les ennemis envahissent l’Inde et se rapprochent de nous qui sommes placés sur leur route, pour s’opposer aux communications Britanniques par l’Océan Indien.
Alors à Maurice on creuse des tranchées pour échapper aux attaques aériennes, on oblige toute la belle jeunesse blanche du pays à former une « territoriale » négligeant de former un corps de mulâtres pour défendre aussi le pays, et on va la mettre en avant pour la faire faucher par l’ennemi car les Japonais sont rompus aux métiers de la guerre, tandis que l’Anglais n’en sait pas le premier mot, c’est lui qui instruit le territorial, qui lui sera encore inférieur.
Pauvres petits soldats d’un sou, dirigés la plupart du temps par des Officiers mauriciens qui ont vu pousser les gallons sur leurs uniformes comme on voit surgir les champignons après la pluie, qui se promènent en auto, fument la cigarette, et humilient leurs inférieurs pour se donner de l’importance.
Le résultat de tout cela est facile à prédire : En face de l’ennemi… ils prendront… la poudre… d’escampette et nous serons vaincus grâce à la « belle Angleterre » comme dit Agnès.
A quoi a servi la contribution militaire payée par la Colonie depuis un grand nombre d’années, contribution qui, si je ne me trompe, se chiffre à Rs 55 ou 60 000 Roupies par an ? Il n’y a pas de soldats anglais à Maurice (une cinquantaine en tout) il n’y a qu’un fort ébranlé, une citadelle désarmée et lézardée, pas un avion, pas une vraie mitrailleuse, pas de cavalerie, pas de canons, pas de fusils, puisqu’on est obligé d’emprunter aux chasseurs mauriciens leurs fusils, qu’on leur rendra après la guerre dans un « aussi bon état que possible ». On a recours à la bonne volonté de chacun pour former la « House Guard » qui défendra les villes, les villages, les propriétés privées etc…
Sans doute il faut se solidariser… mais j’eusse préféré des soldats entrainés pour faire face à des soldats de métier, en l’espèce l’ennemi Japonais.
Et alors ! la conclusion est facile à tirer : si vraiment les Japonais envahissent Maurice… nous sommes foutus !
1er Mars 1942
Maurice Piat qui a épousé Alix, la fille d’Henri, fils lui-même d’Henri Koenig qui épousa ma sœur Mina m’avait demandé de lui permettre de photographier tous les chefs de famille figurant dans ma galerie de tableaux.
Il est venu le 6 Février dernier accompagné d’un photographe chinois (à moins qu’il soit Japonais) pour prendre les clichés. Je n’ai malheureusement pas pu les recevoir, étant au lit avec de la grippe et de la température de sorte qu’ils ont eu affaire à Jean pour décrocher les tableaux, les tenir devant l’objectif du « Canula ». Je serais bien aise d’apprendre que les clichés soient réussis, autrement il faudra recommencer l’opération. J’avais cru que Piat aurait fait photographier tous les portraits de famille mais il tenait seulement aux ascendants directs et a laissé de côté tous les autres. Je le regrette pour sa galerie qui aurait été rehaussée du portrait de Mlle de Lamballe, des tableaux allégoriques en cheveux représentant le cimetière de la famille à la Réunion et de l’immersion du corps de mon oncle Jules Toulorge lancé sur une caronade de la Frégate La « Belle Poule » dans les abimes de l’Océan Atlantique par le travers des « Acores ».
Ce portrait allégorique me reporte à chaque fois que je le contemple, par la pensée, à la scène réelle qui s’est passée à ce moment précis à bord de la « Belle Poule » et qui doit être bien émouvante car mon oncle était adoré de ses collègues de la frégate qui d’après un récit de Dr Gelisseau chirurgien comme lui, l’avaient entouré de soins, disputé à la mort et pleuré comme un frère lorsque leur ami rendit son âme à Dieu. Ce qui leur fut surtout cruel ce fut de le voir mourir si jeune, loin de sa famille, et leur angoisse fut de s’acquitter auprès de mon oncle Emile alors à Paris de la triste mission de lui apprendre la mort de son frère à l’arrivée de la frégate en France.
Les amis de Jules chargèrent en même temps par lettre leurs parents à la Réunion d’annoncer avec tous les ménagements possibles la funèbre nouvelle à mon grand-père, à ma grand-mère et à mon père qui reçurent chrétiennement ce rude coup du sort. Le violon avec lequel mon oncle charmait les oreilles de ses auditeurs marins fut donné à un de ses amis les plus intime dont le nom m’échappe mais qu’on peut retrouver dans le journal de bord de mon oncle que j’ai conservé, et dans les lettres de ses amis, également en ma possession.
31 Mars 1942 (Mardi Saint)
La Mort vient comme un voleur qui parfois fait un gros butin dans la même demeure, dans la même famille. C’est ainsi que mes parents de Chazal se sont vu ravir trois de leurs proches en trois mois : Robert de Rochecouste qui avait épousé ma cousine germaine Alix de Chazal, Alix elle-même dont une dépêche annonce le décès en Angleterre il y a deux jours, et Pierre de Chazal, mort il y a une semaine ou deux à Nice en France.
Que restera-t-il bientôt de cette ancienne phalange de la famille ? Chacun tombe à son tour le long de la route, les survivants les regardent tomber et continuent leur chemin en se disant : Notre tour viendra aussi… quand ?.. Nul ne peut répondre. L’âge n’y fait rien car les plus jeunes s’envolent plus aisément encore que les lourds vieillards qui trainent le poids de la vie avec peine, aspirant au repos et pleurant sur ceux qui partent à leur place…
Pierre de Chazal était un cousin avec lequel j’ai passé bien des heures d’amitié dans ma jeunesse. Il était un peu frondeur mais un cœur excellent, cherchant toujours à vous faire plaisir et vous offrant tout ce qui lui appartenait, se dévouant pour vous. Je me souviens qu’étant en rougeole à St Antoine, propriété du vieil Edmond de Chazal au Mapou pendant des vacances de Décembre qui réunissaient tous les cousins, j’étais alité à l’étage du « Temple » Sudenborgien des Chazal en proie à cette pénible maladie mais en convalescence. Pierre vient me voir en me portant de beaux ananas qu’il avait chipé du jardin de mon oncle et entreprit de m’en faire gouter séance tenante. Ma foi j’étais fort peu versé à cette époque (j’étais si jeune) dans l’art de la médecine et plutôt porté à la gourmandise, que comme notre grand père Adam, j’étais sur le point de consentir à manger de ce « fruit défendu » lorsque ma garde malade se précipita vers nous en nous interdisant le petit repas qui aurait fait « rentrer ma rougeole », les crudités étant mortelles pour ce genre de maladie.
Alix sa sœur qui à son tour vient de mourir était à Maurice il y a 31/2 ans et vint m’offrir ses condoléances de la mort de ma tant regrettée Gabrielle à la Campagne Courchant de Sablon que nous habitions. J’ai dû raconter ci avant le pèlerinage que nous avions fait aux Cassis, demeure ancestrale des Chazal de ma branche, en compagnie de Marc son frère, et ses filles et nièces. Seul ! oui seul alors survivant des gens des Cassis pouvant les guider dans les méandres du passé. Je leur servais de guide avec le livre ouvert de ma mémoire : ici était la maison, là le vieux banc de pierre… là bas les vergers les parcs.. les Froberville habitaient ici… les Chevreau là bas… les Toulorge au point que vous voyez là bas. Et eux qui étaient nés bien après l’exode des Cassis regardaient et tachaient de comprendre ce qu’ils n’avaient pas connu.
C’est pourquoi maintenant que je vois mourir tant de monde autour de moi, je creuse ce problème profond et mystérieux.: nous reverrons nous en haut de façon à nous reconnaitre, nous tous qui vivons ensemble sur la terre mais que des différences de religion ont fait suivre des routes différentes au point de vue de la foi et de la Religion….. Ces routes, au terme de la vie, resteront-elles parallèles, ne se rejoignant jamais plus ou bien, par l’immense bonté de Dieu, les familles disjointes par les croyances différentes se rejoindront un jour après épuration et expiations nécessaires ?….
26 Mai 1942
Charité ! ne serais-tu qu’un vain mot ? Dieu en a pourtant fait une vertu primordiale, indispensable au salut de l’homme. « Si je n’ai pas la charité je ne suis rien. Acquérez tous les mérites que vous voudrez, avancez jusqu’à la porte du Ciel, si vous n’avez pas la charité en vous vous n’y entrerez pas… Cette parole est dure, mais elle est juste et nécessaire. Dieu voit dans vos actions ce que vous ne voyez pas. Il juge votre conduite à l’égard du prochain d’après les grâces, les richesses qu’il vous a consenties et qu’il ne vous a données que pour le soulagement des misères qui vous entourent. Il n’a pas dit: tu seras égoïste, tu n’aimeras que toi-même, mais bien: tu aimeras ton prochain comme toi-même; le verre d’eau que tu donneras au prochain c’est à moi que tu le donnes. Si ton frère a froid, donne lui ton manteau. Combien dans la vie n’observent pas ces commandements ?….
Un fils que la fortune méconnait s’adresse à vous dans la peine pour que vous lui soyez d’une aide, vous lui refusez le réconfort d’une main tendue qui le retirerait d’un mauvais pas, d’un danger, d’un malheur, vous lui refusez le geste qui ne vous coute rien à vous mais qui le sauverait du désespoir. Le retirer de la gêne est une gêne pour vous qui n’aimez que vos aises, votre tranquillité, votre paix qui est celle que donne le monde. Vous vous noyez sous des prétextes et des raisons d’abstention, pour vous justifier à vos propres yeux, de ne point vous occuper de ce frère ou de ce fils de votre frère malheureux. Vous faites mieux: vous l’incriminez d’un tas de défauts imaginaires pour le déconcerter et qu’il puisse penser que vraiment peut-être il manque de vertu, de sagesse et de force, et que rien n’est dû à un pareil coupable.
Sondez donc votre conscience, o homme au cœur sec, et si elle vous crie aux oreilles que vous n’aimez pas Dieu parce que vous n’aimez pas le prochain changez vite d’attitude parce que vous pêchez gravement et qu’il n’y aura pas de pitié pour celui qui n’en aura pas eu pour les autres…
29 Mai 1942
J’écrivais ce qui précède il y a trois jours et j’ai la satisfaction de relater aujourd’hui que le Bon Dieu a triomphé dans le cas auquel je faisais allusion plus haut. Une neuvaine faite par les intéressés finissait hier et le revirement dans l’attitude de ceux de qui dépendait le sort d’infortunés, s’est produit le même jour de la fin de la dite neuvaine ! Depuis nous sommes dans la semaine de la Pentecote et l’Eglise a répété toute cette semaine la séquence « Veni Sancte Spiritus » ou se trouve cette phrase qui s’applique si parfaitement au cas qui nous occupe et que les « interressés » ont répété avec elle, que il est bien évident que l’Esprit Saint a éclairé les obstructionnistes et leur a amolli le cœur :
« Faites plier toute rigueur, réchauffez toute froideur, redressez tout égarement »…
Et le tout fut fait ainsi…
Même jour…
Mes trois fils (ceux qui me sont restés des cinq fils que j’avais) sont maintenant mariés car Jean a convolé il y a trois semaines et habite maintenant chez sa belle-mère. Ils avaient passé leur lune de miel dans le campement Guichard à Souillac et nous avons, Pierre, Lily, Xavier et moi été les rejoindre il y a eu une quinzaine de jours, pour un bon déjeuner et une bonne journée à respirer la brise marine. Excellent campement, bien aménagé mais quel piètre rivage. Des remparts de tous côtés, pas de plage, pas de sable ou si peu ! La mer roulant paresseusement ses vagues qui déferlaient sans enthousiasme et dont les crêtes se blanchissaient à peine à cause de la vaste étendue qu’elles franchissaient. Ce n’était certes pas la mer de Tamarin aux vagues bondissantes qui se heurtaient les unes aux autres, se « crêpaient le chignon » et déployaient une magnifique chevelure blanche qui venaient s’évanouir ou plutôt s’étaler sur la plage au sable fin. Tamarin, il est vrai, est une baie et l’aspect que je préfère des vagues de la mer est sans doute dû à l’engouffrement de la mer dans cette baie.
Nulle promenade à Souillac sur la plage s’entend. Il faut descendre à pic un vallon du côté du « Gris Gris“ pour marcher un quart de mille sur un peu de sable ou dit-on, les tortues de mer viennent déposer leurs œufs.
Les nouveaux mariés n’avaient pas joui d’un temps clément pendant leur séjour là bas. Fortes brises du sud, raz de marée interdisant la pêche dans les rares petites anses du « Gris Gris », pluies constantes empêchant de mettre le nez dehors. Aussi ils n’y firent pas plus de quinze jours et rentrèrent dans le monde civilisé pour s’occuper de l’installation de leur « foyer ».
« Pensées dans la solitude » 5 Juillet 1942
Musset, pourquoi nies-tu que comme le dit Dante
Un souvenir heureux est la pire douleur
Qu’hélas un cœur éprouve en des jours de malheur ?
Le Ciel a donc toujours béni ton âme aimante
Pour qu’elle n’ait jamais ressenti la morsure
D’un grand déchirement ? et qu’aucune blessure
Ne reste encore ouverte au profond de ton cœur ?
Non ! il n’est pas humain qu’une pauvre mémoire
Se rappelle avec joie les bonheurs envolés
Lorsque l’homme succombe sous la douleur noire
Qui étreint à jamais de ses bras désolés,
Le pauvre qui fut heureux et puis malheureux !…
Eteignez-vous, mémoire, fuyez, doux souvenirs
Homme, ne pensez plus, c’est trop dur de souffrir…
G.T. (Pensées dans la solitude)
14 Juillet 1942
Aujourd’hui, la France, la vraie France, la seule France dans le monde, s’est couverte de silice et de cendre pour expier ses erreurs passées, en pleurant sur sa défaite et sur la nécessité ou elle se trouve d’assister tout en pleurs aux malheurs de la Patrie, à l’incapacité ou elle se trouve de se défendre contre un ennemi vainqueur qui lui lie les bras et confisque ses armes…
Elle assiste impuissante à l’humiliation de son peuple qui gémit de devoir supporter le poids du talon de ce géant sentore qui pourtant après la 1ère guerre était aplati de défaite et qui maintenant, grace à l’envie, à la jalousie, à l’égoïsme anglo saxons qui l’ont empêché de se garer de nouvelles attaques allemandes en occupant le Rhin, a relevé la tête, et infligé à celle qui l’avait vaincue un effondrement à son tour…
Elle pleure la France malheureuse et pendant ce temps d’autres rient de ses malheurs. Qui donc rit ? Qui rit ? mais l’Angleterre, mais ses propres enfants, qu’une lâche coopération avec l’Anglais sous la rubrique: Français libres, transformé par suite de scrupules sous celle de France Combattante, éloignés de la Mère Patrie qu’ils n’auraient jamais dû abandonner pour aller jouer cette belle comédie de vouloir défendre la France à l’Anglaise c.à d. en reculant sur tous les fronts ou en se terrant en Angleterre buvant et mangeant à leur faim et à leur soif pendant que leurs frères à coté se serraient le ventre de privations et se gorgeaient d’infortune…
Le Maréchal Pétain, Chef de l’Etat Français avait décidé de passer ce jour de fête Nationale dans le deuil. Pas de manifestation autre que des fleurs au Monument des Morts et des pleurs sur la route qui y conduit. Je suis même persuadé que l’ennemi, l’Allemagne maudite, aura respecté la douleur de la France endeuillée et qu’aucun sarcasme, aucune insulte n’aura été adressée à notre pays. Lorsque l’on respecte les autres, on se respecte soi-même; et il est triste de constater que tel n’est pas le cas de la perfide Albion qui par-dessus le marché a créé un mouvement parmi les français dissidents pour les faire agir ainsi que des marionnettes sur les scènes anglaises et faire croire au monde et à la France elle-même que ses intentions sont pures et qu’elle agit dans les intérêts de la France en exhaltant son courage dont elle ne peut se servir, et sa force qu’elle ne possède plus. Elle n’a réussi qu’à exciter les mauvais français contre leur noble patrie et son plus noble conducteur en les abreuvant de whisky et de cocktails.
L’empereur du Japon lui-même a envoyé au Maréchal un télégramme de sympathie à l’occasion du 14 Juillet, et pendant que Mr Eden, Ministre anglais des affaires étrangères dans un message aux embusqués français de Londres leur disait qu’ils étaient trompés (les français) par Vichy et les « politiquards » de Vichy. L’Angleterre n’a aucun dessin dit-elle contre les français et pendant ce temps elle occupe Diego Suarez et l’Ile Mayotte à Madagascar.
Qui pensera jamais que l’Angleterre si jamais elle est victorieuse dans cette guerre ne gardera pas pour elle les territoires brutalement violés qui sont à la France ?
Mais attendons la fin, la « justice immanente » ; c’est là qu’il y aura des « pleurs et des grincements de dents ».
J’ai fait là une large digression à mon but d’écrire au sujet du 14 Juillet 1942 à l’Ile Maurice, j’y reviens :
Qui a représenté la France, même libre, pensez-vous. Est-ce un vrai Français, même libre ? Pas du tout, c’est un Mr Paturau, Hector pour les dames. Surgi de je ne sais ou avec un grade de Capitaine, de quel ordre on n’en sait rien qui s’intitule le Délégué du Général de Gaulle « chef des Français Libres (comme si il pouvait y en avoir quand la Mère Patrie gémit sous les fers) et qui tient à Maurice un « Lever » et reçoit « les Français » les amis de la France Libre et les Autorités Anglaises ainsi que les députés. Vaste comédie tragi-comique qui fut jouée à sa campagne « Coin de France » à Moka. Et grandement, du moment qu’il s’agissait de blesser la vraie France, le Gouverneur de Maurice Mackenzie Kennedy et sa femme, les Officiels du Gouvernement de Maurice ont été saluer Mr. Paturau et sa femme, puis faire des discours puisés dans des coupes de Champagne (Français).
Il y eut en tout 57 personnes qui allèrent s’exciter sans profit pour les organisateurs de la Comédie, car demain, car dans un mois, dans un an, ou même d’avantage, la situation de la France n’aura pas changé du fait des fameuses intentions de l’Angleterre, de l’Amérique et des Français Libres de lui rendre la liberté, alors qu’eux-mêmes seront plongés dans la défaite.
J’ai relevé d’après un compte rendu de la « Fête Française » (Libre) » donné par le « Mauricien, Cernéen, Advance » trinité de journaux d’ici le nombre exact et la qualité des gens qui étaient présents à la représentation, les voici :
Français de naissance (ou descendant de Français) 1 (un seul !)
Mauriciens de descendance française 3
Mauriciens Anglais (Mulatres ou Métis) (28 mulatres et 15 blancs) 28
Officiels du Gouvernement (Anglais) 6
Officiels du Gouvernement Députés Mauriciens (dont 2 mulatres) 9
Prêtre Anglais 1
Prêtre Mauricien (de naissance) 1
Députés Mauriciens 5
Le Gouverneur, sa femme et leur fils 3
——
57
Représentation colossale et choisie
Et c’est ainsi que s’écrira l’histoire de France,,, Libre.
Vision 21 Juillet 1942
Je vois partout deux cœurs mais qui n’en font qu’un seul !
Je vois aussi deux âmes en une confondues
Deux corps, dont l’un fut mis dans un profond linceul
Et l’autre vieillissant de larmes répandues !
Je vois ces pleurs couler sur un visage austère,
Pendant que dans les Cieux, dans le profond mystère,
S’épanouit grandie, sans plus jamais pleurer,
L’âme qui fut à moi, qui maintenant à Dieu
Tend son souffle vers moi, me disant d’implorer
La bonté du Très Haut pour la rejoindre aux Cieux !… G.T.
Croyance 15 Aout 1942
Non, il n’est pas possible qu’un Dieu magnanime
Laisse tomber au fond du vaste et grand abime
L’homme à qui il a dit : Crois en moi, souffre, espère,
Il a dit ici-bas: aime, de tout ton cœur
Celle que j’ai voulu t’adjoindre sur la terre
Poursuivez de longs jours dans la joie ou le leur,
Ne séparez jamais ce que j’ai voulu faire ;
Car si j’ai pris de l’un quelque peu de sa chair
Pour former sa compagne si douce, il est clair
Que c’est afin que soient réunis dans les cieux
Leurs âmes et leurs corps devenus glorieux…. G.T.
15 Aout 1942
A quoi faut-il s’attendre, lorsque la mort viendra vous ravir de la terre pour vous mener aux Cieux ? Revoit-on celle qui a été la compagne bien aimée d’une longue existence dans les mêmes sentiments qu’on éprouvait l’un pour l’autre et la tendresse de celle qui vous aura précédé dans l’ »au-delà » vous sera-t-elle rendue comme vous lui aurez porté la vôtre, et cela dans la pureté de Dieu ?
Ou bien la mutuelle affection sera-t-elle changée en un amour angélique, qui ne sera plus exclusif mais partagé avec les autres élus, (l’amour du prochain) au point de ne plus vous appartenir en propre mais fondu dans un tout ? Et de quelle manière ?..
Mon épouse sera-t-elle mon épouse glorifiée, ou bien une connaissance au Ciel ?
Même jour : Ennui
Rien n’est plus insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passion, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, son impuissance, son vide. Il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. (Pascal)
25 Aout 1942
« La Saint Louis ! » Comme cette fête à chaque retour me renvoie toujours plus loin en arrière, me rappelant les jours passés et les doux souvenirs !… Ces temps heureux où j’avais auprès de moi une épouse attentionnée à fêter mon saint patron par quelque bon repas autour duquel se réunissaient mes enfants et mes premiers petits enfants avides de bonnes choses, ou par quelque cadeau auquel j’étais toujours sensible.
Hélas ! ces temps ne sont plus, et ne seront jamais plus… Je suis trop seul maintenant pour ne plus penser à trouver de la joie au retour de « ma fête », je n’y rencontre que chagrin et regret… Toujours ce vide béant qui m’environne et qui m’accompagne dans le reste du chemin que j’ai encore à parcourir me reportera en pensée à la grande douleur que supporte et doit supporter celui qui après avoir connu tous les bonheurs d’une saine tendresse, retourne la médaille et ne voit sur l’envers que la triste représaille du sort, l’abandon et la solitude du cœur.
Quelle expiation, Seigneur, que cette infinie misère de mon cœur ! Qu’ai-je donc fait au Ciel, pour que pèse sur mes épaules comme un lourd manteau, ce dur chagrin que je ne parviens pas à surmonter, et qu’au contraire chaque souvenir vient raviver en me remettant sous les yeux tout ce qui me fut heureux et qui maintenant me cause des regrets.
Nesssum magiore dolore che recordarse del tempo felici nella miseria….
7 Septembre 1942
Je viens de conduire à l’autel de l’Eglise de St Jean ma dernière enfant, Claire qui a vu bénir son mariage avec Claude Koenig par le Père Nadon Curé de St Jean au milieu d’une assistance composée des membres principaux des deux familles et de quelques amies particulières à Claire.
La réunion familiale a eu lieu chez Lili et Pierre dont la Maison spacieuse se prêtait mieux à une réception des 75 personnes qui y participaient. En effet moi, pauvre vieux solitaire aujourd’hui, je ne me serais pas permis de recevoir tant de beau monde dans ma simple simplicité et il a été bon que la fête se soit passée là-bas. Mais ce que je veux rappeler ici c’est la date du 7 Septembre…
7 Septembre 1942, 7 Septembre 1886 !…
Je ramenais de l’Autel de l’Eglise de St Sauveur aux Bambous, Rivière Noire, mon adorable et blonde épouse pour aller à Médine propriété de la famille recevoir les félicitations des invités et prendre part au tiffin succulent qui eut lieu dans la serre, puis prendre le chemin d’Ossere que M.Koenig avait fait installer pour notre lune de miel.
56 années se sont écoulées depuis cette date, et j’ai été seul aujourd’hui à contempler la joie de ceux qui fêtaient le 7 Septembre 1942. Ma bien aimée compagne n’a pas attendu ce jour pour assister elle aussi à la joie de sa dernière fille et je suis tenté de me demander : pourquoi ??… Oui Seigneur, pourquoi n’est-elle plus à mes côtés, la chère créature que je regrette de plus en plus ?…
Est-ce parce que vous aviez besoin d’elle dans votre beau Ciel, Seigneur ?!…
Patriotisme 10 Novembre 1942
Mon salon est devenu un centre de discussions politiques ou se réunissent des éléments disparates composés de Français, de Francophiles, d’Anglophobes ou plutôt de Francophobes, de neutres ou même de gens sans aucune opinion.
C`est la guerre qui me vaut cela et je constate que ces gens-là qui sont mes enfants, petits-enfants, parents etc qui sont d`opinions différentes des miennes ont la drôle de manie de venir… disputer chez moi et y apporter leur mauvais virus qu`ils feraient bien mieux de conserver chez eux se dispensant de venir faire étalage d`opinions et de gouts franchement hostiles à la vraie (je dis : vraie) nation française.
C`est une chose étonnante d`abord de voir que certains de mes propres enfants que j`avais élevés dans les pures idées et traditions françaises en leur mettant sous les yeux toute ma vie, les exemples de mes ascendants qui avaient toujours tenu haut leurs cœurs français, montré leur généreuse volonté d`aimer et de servir la seule et vraie France, que ces certains enfants aient maintenant des opinions diamétralement opposées à celles que j`aurais supposé leur être communes avec celles de mes ascendants et les miennes.
Pourquoi ?… Pourquoi ? Je vais le dire, et le marquer ici comme un testament qui me fait l`obligation de le consigner pour l`intelligence des générations à venir. Ceux-là de mes enfants (remarquez que je ne les nomme pas) qui haïssent maintenant la France et qui ont inculqué ces mauvais principes à leurs propres enfants sont des gens qui ont épousé des hommes à la solde du Gouvernement Anglais de l`Ile Maurice et qui par crainte de se voir sossés aux gages s`ils faisaient montre de patriotisme français courbent l`échine et s`éloignent du devoir sacré de maintenir leurs idées, aspirations et … don de soi-même a la mère patrie de leurs ancêtres !
Mes petits fils ne serviront pas la France car ils se sont enrôlés dans la Territoriale qui n`est qu`une fille naturelle de l`armée Anglaise. Ils n`auront pas le courage de résister à leur enrôlement dans cette phalange aujourd`hui ennemie déclarée de la France au service de l`Anglais détesté, qui par une lâche propagande a trouvé moyen d`arracher à leur devoir une poignée de traitres qui sous l`égide du Général de Gaulle font le plus grand dommage a la France, en même temps que son immense chagrin.
La France, malheureusement entrainée par l`Angleterre a déclaré après l`Anglais la guerre a L`Allemagne en 1939. Non préparée à faire cette guerre elle était insuffisamment armée et devait fatalement succomber sous la défaite, surtout lorsqu`elle se vit dans l`historique retraite de Dunkerque et que l`Amérique, qu`un membre du Cabinet Français avait été solliciter pour qu`un secours ou plutôt une aide en arme fut donnée à la France, refusa de se rendre à ce désir.
Elle proposa a l`Allemagne un armistice qui après discussion fut reconnu bien dur mais qui permit à la France de sauver son domaine et son Empire en s`humiliant sans déshonneur. Cette conduite qui maintient la patrie dans son intégrité et sauve la vie de milliers de Français n`eut pas le don de plaire aux Anglais et à quelques lardes et dissidents Français fuyards qui quittèrent la Patrie pour aller en Angleterre se mettre sous le commandement de cette nation traitresse et avec l`appui de leur Livre Sterling prétendre combattre l`Allemagne pour libérer la France.
Erreur grossière. Ce mouvement opéré par les traitres français ne servit qu`à créer un état navrant de contradiction entre vrais français métropolitains et les transfuges admirés et poussés par l`Angleterre a salir le gouvernement si digne du Maréchal Pétain Chef de l`Etat.
Dès lors ce ne fut qu`insultes, pamphlets, calomnies à l`adresse de la France par ceux qui restaient dans leur pays à soutenir leurs frères dans le malheur. Ils créent des journaux en Angleterre qui stigmatisent chaque jour ceux de France auxquels ils ne peuvent plus prétendre ressembler maintenant qu`ils ont lâchement fui devant le devoir et l`honneur. Une propagande infernale et d`insigne mauvaise foi ravale chaque jour leurs frères courageux qui sont tout simplement restés au poste d`honneur que l`honneur commandait de conserver. Ils ont préféré aller vivre grassement aux frais de l`Angleterre, manger leurs beefsteaks et boire leurs whiskies, à l`abri de l`éloignement du théâtre de la douleur et de l`abnégation pendant que leurs frères étaient privés même du nécessaire par suite du blocus anglais qui ne permettait pas aux navires venant de différentes parties de l`Empire de ravitailler la malheureuse patrie affamée.
Le plus terrible est l`approbation faite par cette horde de français traitres, transfuges, des agissements de l`Angleterre à l`égard de la France et de trouver bien fait pour les coups portés par l`Anglais au cœur saignant de la France.
Ils détruisent les navires de guerre Français à Oran de peur que les allemands s`en emparent. Ils envahissent la Syrie par crainte des allemands. Ils envahissent Madagascar par crainte de sous-marins japonais qu`on n`y voit pas. Ils bombardent avec le secours de cette autre nation pourrie de judaïsme qui a nom Etats Unis les ports de Casablanca, d`Oran, d`Alger, de Bougie, de Bonne, de Tunis parce qu’ils disent qu`il vaut mieux que ce soit eux qui occupent ces ports plutôt que les Allemands. Ainsi partout et toujours la France est la victime de la force brutale des anglo saxons qui se montrent plus barbares que les Allemands qui sont eux plus respectueux de la propriété d`autrui et de la neutralité déclarée. Et ces coups et ces meurtres sont perpétrés sous le fallacieux prétexte que c`est pour la libération de la France qu`ils agissent de la sorte, a la grande joie des `français combattants `qui eux ne combattent rien du tout ou du moins n`ont jamais rien fait de tangible qui soit profitable à la Patrie qu`ils ont si cruellement trahie et abandonnée.
20 Avril 43 (Mardi Saint).
Nous entrons depuis hier dans la “Semaine Sainte “! Changeons d`attitude, fermons nos romans, fermons nos portes aux “amis` trop vains qui ne nous visitent que pour nous apporter de dehors les nouvelles du jour avec leurs scandales et tacher de savoir s`ils ne pourraient rien récolter chez nous qui soit digne d`être rapporté ailleurs avec succès.
C`est un temps de pénitence et chacun en a besoin. Qui donne sur Terre n`a pas besoin de penser à la Passion du Sauveur pour expliquer ses propres souffrances et en comprendre la nécessité et la signification ! Ah Seigneur ! Je me plains de porter une lourde Croix que je traine pesamment sur mes épaules aujourd`hui affaiblies par l’âge et la maladie et je ne vous vois pas gravissant le Calvaire avec votre Croix si pesante des crimes du monde si lourde à porter que trois fois pendant votre parcours vous avez succombé sous son poids d`ignominie. Je ne vois pas vos appréhensions du terme fatal de votre `Chemin de Croix ‘où vous allez trouver la mort que vous avez acceptée pour le Salut du genre humain, et je me plais à vivre avec le plus de délices possibles, pensant que cet état durera longtemps, si ce n`est toujours mais ne pensant pas du tout à vous prendre pour le modèle qu’il faut absolument suivre si je veux arriver aux mêmes fins.
Le terme de mon voyage… c`est le Ciel ! Le Christ nous a enseigné ce qu`il faut faire pour y parvenir et l`y rejoindre. `Si quelqu`un veut venir après moi qu`il prenne sa Croix et me suive`.
Je prends la mienne, Seigneur, et je veux vous suivre fermement convaincu que vous me conduisez là-bas ou déjà se trouve et m`attend celle qui a porté une si lourde croix sur la terre et qui maintenant j`en ai la ferme espérance se repose de son long labeur dans la béatitude éternelle du Paradis !
Jeudi Saint 22 Avril 1943
Hier soir à 5 heures emportés par une auto, Claire, Claude et moi nous sommes allés nous confesser à St Jean pour le Jeudi Saint. Que de paroissiens de l`Eglise du Rosaire j`ai rencontré autour du confessionnal des Peres Thuet et Padon ! J`ai moi-même fait la réflexion devant Madame Hardy que le Rosaire était abandonné pour St Jean et que j`allais envoyer le curé du Rosaire (Père Guérin) constater la chose `de visu`. De quelle réprobation le confessionnal du Père Guérin est-il frappé ? Et pourquoi ? On n`aime pas ce confesseur, répond-t-on généralement ! Il n`y a pas besoin de l’aimer, il suffit de se dire qu`il représente Jésus Christ dans son confessionnal, qu`il y est placé pour entendre vos crimes et les pardonner si vous en avez le sincère repentir.
En tout cas cette avalanche de pénitents du Rosaire à St Jean doit bien étonner les prêtres de cette paroisse qui doivent se demander ce que cela peut bien signifier. En sortant de l`Eglise je me suis dirigé vers le Cimetière portant une corbeille de roses pour mes morts. `Mes morts` : quelle triste chose à dire et pourquoi faut-il le dire ? Le champ des morts venant d`être vidé d’un flot de gens qui assistaient à l`inhumation de Mr Eriston Bestel officier préposé au Service des Pompes de Quatre Bornes. Père de famille de dix enfants il venait de leur être enlevé par un accès hématurique foudroyant ! Que vont devenir ces jeunes malheureux ? Et leur mère, la fille de Marcel , ancien comptable ? Dieu est la !
Je pénètre dans l`Habitation des Morts`. Le temps est lourd de nuages noirs qui pèsent sur les vivants autant que sur les morts et parlent davantage à la tristesse et au chagrin que l`on ressent déjà pendant la Semaine Sainte si l`on a quelque peu médité la Passion du Sauveur. Vos pas résonnent sur l`asphalte qu`ils martèlent et ce bruit que les morts n`entendent pas vous remonte au cœur et vous oblige à avancer votre marche pour plus respecter ce silence qui émane de tous ceux qui sont la sous terre et dont ils ont l`air d`avoir une si grande nécessité !
Voici la tombe que je cherche… celle de mon épouse bien aimée, tant pleurée, tant regrettée ! Il y a déjà un certain temps que je ne suis pas venu prier sur cette tombe, empêché par de récentes maladies mais elle a toujours été entretenue et fleurie chaque semaine (le Vendredi) des fleurs de chez nous cultivées à cet effet. Je retire les dernières fleurs qui sèchent dans le vase sellé sur la tombe et y place les jolies roses que je viens d`apporter à ma bien aimée Gabrielle en les accompagnant de mes prières, autres fleurs spirituelles dont mon amie respire le parfum et dont assurément elle me remercie en élevant son âme à Dieu, et en abaissant son regard vers moi.
Quelle loque humaine voit-elle en moi et que doit-elle penser ? Peut-être pense-t-elle que Dieu m`accorde tant de jours pour me permettre d`acquitter bien complètement ma dette envers Lui et redouble-t-elle de supplications pour que je me presse d`expier ce que ma pauvre vie a pu commettre d`offenses susceptibles d`une longue réparation ?
Impressions de Procession 28 juin 1943
Invité par le curé de la paroisse de St Jean le Révérend Père Nadou (un canadien Français) a tenir un des cordons du Dais a la Procession du St Sacrement qui a toujours lieu le Dimanche qui suit le jour de la Fête du St Sacrement je me questionne sur les probabilités du temps qui s`était mis à la pluie toute la matinée compromettant notre Procession de l`après-midi. A deux heures le temps se remet selon mes prévisions car je voyais les nuages s`arrondir en cumulus et la brise commencer à s`élever et il fait beau soleil lorsque je pars de la maison pour aller en quête d`une auto à la gare de Quatre Bornes pour me rendre à St Jean. Un seul auto stationne sur la place de la gare dans lequel je m`empresse de m`engouffrer car on aurait pu me le disputer et nous partons. L`auto me dépose devant le cimetière. J`achète deux bouquets de fleurs car je n`ai pu en cueillir chez moi avant de partir et l`heure le permettant avant la Procession j`entre dans l`enclos des morts qui reposent doucement sous leurs tertres et qui ne suivront pas le cortège de tout à l`heure autour de Jésus. Le Cimetière est vide… ce n`est pas l`heure parait-il (2h1/2) des visites de parents et d`amis et je goutte ce silence autour de moi en me dirigeant vers mes tombes que je vais fleurir.
J`aurais voulu d`abord courir comme je le fais d`habitude a la tombe de mon épouse bien aimée mais vu l`heure qui s`avance je bifurque a la grille de mes trois enfants qui est plus rapprochée et y dépose fleurs et prières, les premières pour leur souvenir, les dernières à l`adresse de Dieu Tout Puissant qui les accepte en paiement du droit d`entrer au Ciel…
Pauvre tombe naguère tant visitée par Gabrielle qui ayant versé tant de larmes aux différents départs de nos trois enfants venait se consoler par la prière autour de cette grille de toutes ses souffrances morales, de tous ses chagrins, de tous ses regrets en même temps qu`elle y puisait l`espérance certaine de revoir un jour nos enfants au Ciel.
C`est dans cet ordre d`esprit, avec ces mêmes douleurs, et cette ferme espérance que je me dirigeai vers la tombe de celle dont je ne puis plus supporter l`absence, loin la bas, beaucoup plus loin que celle de nos enfants.
Pourquoi ne sont-ils pas tous ensembles mes chers disparus dont les restes eussent pu se trouver en même temps dans un grand caveau qui aurait même disposé de place pour moi-même.
Hélas ! La fortune n`a jamais été mon privilège et je ne dois pas songer à ces grandeurs funéraires que je n`ai pu atteindre. Modestement j`ai vécu modestement je mourrai pour aller occuper le petit tertre que j`ai acheté contre la tombe de Gabrielle et à moins que mes enfants ne fassent pour moi ce qu`ils ont fait pour leur mère je n`aurai que mon tertre envahi d`herbe… et peut être d`oubli !
Me voici déposant mes fleurs sur le mausolée de Gabrielle. J`ai assez de temps pour prier, pour méditer et pour me souvenir… pour pleurer aussi et pour tant regretter celle qui est la sous mes pas depuis plus de quatre années et à laquelle je pense de plus en plus avec le temps qui passe et dont je me rapproche chaque jour avec les infirmités qui me visitent et qui bientôt peut être feront de moi l`hôte de ce cimetière, le voisin immédiat de ma voisine dans la poussière du tombeau.
Nous serons réunis dans la mort mais aussi dans la vie future. Le Christ que je vais suivre tout à l`heure pendant la procession et que je vais accompagner au Reposoir dressé a Salency nous a promis la Résurrection si nous avons toujours suivi son exemple et ses enseignements et je sens la devant cette tombe que mon épouse chérie m`exhorte à éprouver les purs sentiments d`espérance chrétienne d`un éternel revoir, d`une réunion sans fin de nos deux âmes, de nos deux bonheurs futurs.
Et je poursuis mes méditations, mes prières, imaginant la joie que j`éprouverai de me retrouver avec tous ceux que j`ai aimés sur la terre dont l`épouse que Dieu m`avait donnée est la plus chère assurément.
Comme il me reste du temps, j`entre à l`Eglise St Jean pour dire d`autres prières. Là aussi je revois les jours écoulés. C`est là que Gabrielle conduisait nos enfants aux instructions de Première Communion, de Confirmation; la que l`absoute fut donnée sur les cercueils de Gabrielle et de nos 3 enfants, la qu`une intense émotion s`empara de moi le jour des funérailles de l`autre moi-même, pendant la messe solennelle qui y fut dite pour le repos de son âme, la que de nombreux parents et amis, frères et sœurs du Tiers Ordre pieusement agenouillés priaient aussi pour elle.
Cette Eglise de St Jean nous était chère a tous deux, car elle nous inspirait les mêmes sentiments religieux, relevait notre courage a tous deux dans les difficultés de notre vie, nous donnait la même espérance d`une récompense commune lors qu`auraient fini pour nous deux les peines de cette vie.
Et c`est en pensant à l`assiduité de Gabrielle à suivre les processions de St Jean avec tous nos enfants que je me disposais à me ranger au côté du Dais avec les autres Fabriciens.
Il est 3h1/2, le temps est éclatant après avoir été menaçant. Le cortège se met en marche, précédé et suivi de bannières et de pieux paroissiens qui psalmodient leurs prières et leurs chants liturgiques. A Salency le Reposoir est dressé aux 2/3 de l`immense rond de gazon bien tondu et que le soleil a déjà séché. Les bannières sont en ordre de préséance. Les religieux du Tiers Ordre et les différentes sociétés religieuses sont dans les allées circulaires; sauf le Saint Sacrement, les prêtres Thuet et Nadau, les membres de la Fabrique occupent la pelouse. Les chants se poursuivent et le `Tortum Ergo` entonné par de belles voix d`hommes termine la cérémonie. Le Père Thuet donne la Bénédiction et entonne le Te Deum et que les chanteurs continuent pendant qu`on se remet en marche pour le retour à l`Eglise une dernière bénédiction est donnée à l`intérieur de St Jean, et la foule se disperse; et je pense que c`est peut être ma dernière procession et ma dernière joie spirituelle d`assister à de pareilles réunions dans mon ancienne et vieille paroisse que je ne puis plus fréquenter maintenant à cause de l`éloignement et des difficultés de transport.
Le curé nous invite (les fabriciens) à aller à la cure prendre une tasse de thé comme d`habitude et je revois en esprit nos vieux curés morts aujourd`hui les Peres Haby, Planeix, Catones, Ditner, qui faisaient les mêmes gestes répétés aujourd`hui par les prêtres actuels. Quelles réminiscences et quels réconforts spirituels !
Puis le profane succède au religieux, on cause de tout, religion, société, politique, on parle de la guerre, de ceux qui s`agitent actuellement pour faire prévaloir leurs influences politiques. Pierre Couve me dit entre deux cigarettes quelle sont les opinions des pères Thuet et Nadau qu`il fréquente plus que moi: le Père Thuet qui était un partisan de l`ambitieux Général de Gaulle s`est maintenant retourné contre lui en constatant que ce brouillon est l`instrument des Anglo Saxons et l`homme qui veut rétablir le communisme et la République juive en France. Le Père Nadau est révolutionnaire dit-il et opposé au rétablissement de la royauté en France.
Ces messieurs croient à la victoire Anglo Saxone et ne pensent pas que les malheurs de la France ne cesseraient pas si ces deux pays gagnaient la guerre parce qu`ils assujettiraient la France a leurs propres ambitions qui se substitueraient à celles de l`Allemagne.
Non, la France doit se libérer de cette emprise Anglo Saxone avec autant d`ardeur que de celle des allemands. Il faut que la France se régénère dans l`ordre, la dignité et l`honneur comme dit le Maréchal Pétain. Qu`elle écarte de sa route les juifs communards, les ambitieux et les égoïstes jouisseurs de ce monde.
Elle devra vivre dans la paix et la tranquillité d`une saine morale, dans le sens chrétien des devoirs et des responsabilités de chacun dans le travail consciencieux et dans la fraternité de ses enfants.
Il faut que Dieu règne sur elle avec la Religion Chrétienne et l`amour du prochain. Autrement, rien n`est changé et il n`y aurait point de paix pour elle.
Une Visite à la Baie du Tamarin 7 juillet 1943
Dimanche dernier, Xavier, Francoise et Maurice qu`accompagnait Rachel ont passé me prendre en auto pour une promenade à la Baie du Tamarin. Il s`agissait d`aller retrouver Alix et ses derniers enfants au Campement du Gouvernement mis à la disposition de Xavier afin de faire une saison balnéaire pour la santé du petit Patrice qui avait été rudement secoué dernièrement au point de séjourner trois mois au lit.
Ce petit campement qui n`est autre que le Bureau des Travaux Publics qui a été aménagé aux fins de séjour et comporte quelques meubles tels que tables, bahuts, fauteuils, mais il faut porter tout le reste ce qui n`est pas le moindre.
Les communications avec Quatre Bornes sont journalières et grâce aux voyages journaliers des Koenig des Salines qui y vont pour leur travail, Alice pouvait recevoir un tas de provisions, l`auto des Salines s`arrêtant un moment devant l`entrée de ce campement. De plus, Paul Dussac, employé des Travaux Publics, surveille les travailleurs des routes de la Rivière Noire et tient ses assises dans ce bureau provisoirement dut s`installer dans le garage pour faire son travail pendant le séjour d`Alice. Dussac doit lui-même après le séjour passé par Alice et les siens un séjour du mois d`Aout dans le campement avec sa femme et ses deux fillettes.
Arrivés a 3 ½ Dimanche a Tamarin nous avons passé l`après-midi dans la varangue à causer et a luncher jusqu`au moment où les jeunes ont été prendre un bain de mer devant le campement du Barachois ou le bain est meilleur que partout ailleurs.
Au moment où le soleil allait plonger dans l`onde amère et ou le crépuscule assombrissait le jour, Alice, Xavier et moi avons promené sur la plage en nous dirigeant vers la passe de la Baie de Tamarin, et ce sont mes impressions que je veux consigner ici, pour faire comprendre au lecteur ce que signifie cette phrase d`Horace je crois : Quantum mutatus ab illo !!!
Oui combien changées toutes choses dans ce lieu béni, dans ce Paradis, comme je l`appelais, pendant ou plutôt avant mes fiançailles, c`est à dire il y a 57 années !
Je chemine sur la bande maintenant resserrée de sable qui part du Campement du Gouvernement et s`en va s`élargissant vers la Passe. Je cherche des yeux les campements que j`ai connus autrefois et ne les reconnais pas. Ils ont changé de physionomies, ils ont changé de formes, ils ont changé de…plans. Mon campement construit en 1913 et brulé en 1915 n`est évidemment plus, mais il a été reconstruit par Emmanuel Koenig sur des dimensions restreintes au-dessus même de mes anciens soubassements et ressemble à une modeste paillotte comparé aux confortables campements qui se trouvent à sa droite et à sa gauche. Autrefois en se tenant contre la Passe on voyait alignés dans la claire lumière du soleil et du jour tous ces premiers campements dégagés d`entrave et respirant l`espace on distinguait les campeurs sous leurs varangues ou sur leur plage respective. C`était un chatoiement de couleurs des costumes de bain des dames, demoiselles, enfants qui musardaient avant et après le bain sur le sable à courir derrière les carcassailles ou des tourlourous et tec-tecs ; on voyait les pêcheurs débarquant de leurs pirogues et portant leurs `lourds fardeaux de poissons sous le grand multipliant devant le Christ de la Mission ou le poisson se vendait sans `profitage`a qui voulait sans discernement comme présentement. Puis les pêcheurs s`enfonçaient dans l`intérieur du Village de Tamarin suivis par les regards des campeurs du Barachois qui les suivaient dans les méandres des sentiers qui sillonnent les abords des divers Campements. Rien de tout cela aujourd`hui, une végétation intense de filaos, de cocotiers, de pergolas de bougainvilliers cachent toutes les demeures et crée une ombre obscure autour et devant les campements. Je ne me reconnais plus et demande à Alice de me désigner l`emplacement de la Croix de la Mission et de me nommer les divers campements afin de me retrouver. L`ancien campement des `Georges` qu`on pouvait toucher du doigt se trouve au loin la bas, parce que la plage s`est considérablement élargie devant lui. Celui d`Alix qui n`était entouré que de 2 ou 3 gros filaos semble aussi éloigné et un rideau de jeunes filaos l`encadre.
Je ne me remets nullement le Campement Merle si en évidence autrefois et formant un angle du chemin qui mène à la Croix de la Mission. Il est presqu`invisible, caché par la végétation qui l`encombre.
La Croix de la Mission si en évidence aussi au centre de toute la plage et frappant les regards de ceux qui en mer ou sur la place se dirigeaient vers elle semble passer inaperçue dans son cadre de végétation luxuriante.
Puis c`est Monsieur Brouard, aujourd`hui Merle, qu`on ne peut constater l`existence qu`en passant devant mais qu`on ne voit plus de loin comme autrefois, dans le bon temps jadis…
Un nouveau Campement se trouve à la place de celui de Hily au centre du village qu`on ne voit plus à l`œil nu. J`ai déjà parlé de mon ancien campement que je soignais avec tant d`amour et que le criminel Àyo` mon gardien a incendié par vengeance. Celui d`Emmanuel est rudimentaire, et passe inaperçu.
Enfin le Campement Le Merle qui était naguère assez modeste est devenu le Campement Matcalfe agrandi, modifié, éclairé a l`électricité, avec pavillon, rotonde, gazon taillé à la tondeuse, entouré de fils barbelés entrelacés de lianes de bougainvillées, grande cour avec garage pour les camions de soda que fabrique le propriétaire aux Vacoas et qu`il vend a Tamarin. Lui-même est un grand consommateur de soda… additionné de whisky et Georges Koenig a quelquefois partagé ses rafraichissements pendant ses séjours à Tamarin.
Pendant que nous questionnons les alentours pour qu`ils nous restituent le passé, les deux baigneuses Francoise et Rachel rentrent de leur bain et se dirigent vers le campement, elles grelottent sous le tissu léger qui couvre à peine leurs jeunes poitrines et nous croisent en frissonnant.
Je jette alors un regard vers la Passe. Deux promeneurs viennent de la traverser car elle n`est pas profonde actuellement vu le cours des Rivière du Rempart, de Tamarin n`entraine pas le sable qui plutôt s`accumule vers le Barachois, ces promeneurs sont : Raymond Koenig et Mlle d`Argent que l`on dit sa fiancée. Ils se hâtent vers leur auto qui les attend dans le village car il fait déjà sombre. Le Campement du Barachois, notre ancien Campement du temps de nos fiançailles me regarde et ne me reconnait plus ! La plage qui lui fait face, témoin de nos ébats chorégraphiques de jadis, de nos longues promenades au son de l`accordéon s`étend à perte de vue sous un morne silence ponctué de temps à autre du clapotement de vagues légères et je songe à tous ceux qui se réunissaient autrefois à ce cher Barachois pour passer des weekends aussi agréables que possible. Ou êtes-vous mes amis, mes parents, mon épouse chérie et pourquoi suis-je la a contempler le vide que vous avez créé dans mon âme et dans mon cœur, comme autour de moi ?
Lentement nous reprenons le chemin du retour et les souvenirs des temps a jamais disparus m`accompagnent et me bercent…
29 juillet 1943
La mort d`Anna Koenig suivie de celle de sa sœur Alice en Religion Mère Marie de St Henri Religieuse du Couvent de Marie Réparatrice réveillent en moi des souvenirs qui me poussent à relater quelques faits de la vie passée se rattachant à ma jeunesse, à mes fiancailles, et de plus loin encore à mon existence a Virginia.
Celle, aux obsèques de laquelle j`ai assisté hier à l`Eglise du Montmartre Mauricien, belle église érigée sur les terrains du Couvent de la Réparation a Rose Hill, était entrée à ce Couvent il y a 49 ans. Elle a servi le Bon Dieu avec foi et amour, piété et dignité. En dehors de ses fonctions religieuses elle donnait des leçons de peinture et de dessin dans la salle d`œuvre du Couvent et a formé quelques bonnes élèves.
C`était comme sa sœur Anna, presqu`une sœur pour ma femme, ayant vécu cote a cote pendant de nombreuses années de leur enfance et de leur adolescence a l`Eau Coulée dans une campagne qui faisait face à la Meilleraie et aux Quatre Vents ou se trouvaient Gabrielle et les siens. Je les rencontrais souvent là-bas lorsque j`allais prendre des nouvelles de ma sœur Mina prise de typhoïde, et aussi plus tard pendant mes fiançailles.
La religieuse Alice était un jour allée à Virginia avec sa famille pendant mon séjour sur cette propriété et étant un peu espiègle a cette époque (elle pouvait avoir alors 16 ans) elle et ses cousines avaient profité de mon absence de la maison (j`étais allé engager des hommes a Mahebourg pour la Propriété) pour entrer dans ma chambre à l`étage et pour faire une farce aux parents du rez de chaussée, s`étaient affublées de mes vêtements et s`habillèrent en garçon. On en a beaucoup ri et aussi beaucoup gronde la jeunesse de cette indiscrétion innocente et de cette violation de mon domicile.
La pauvre vieille (77 ans) était bien changée à la fin de sa vie. Presque 20 jours après la mort d`Anna, elle est morte subitement d`une crise cardiaque. J`avais été voir ma fille Mina au Parloir et profité de la circonstance pour demander à la voir pour lui faire mes condoléances au sujet de la mort de sa sœur. Elle m`avait demandé une communion pour le repos de l`âme de celle qu`elle pleurait et certes on n`aurait pas pensé qu`une quinzaine de jours après j`aurais entouré son cercueil de mes prières dans l`Eglise du Couvent.
23 Juillet 1943
Un petit Bernard est né dans la nuit (Mercredi 10) à la Clinique du Bon Pasteur a Rose Hill. Ce petit homonyme de mon beau-frère est le fils de Claire ma fille et de Claude Koenig. Il est venu dans la vie dans des difficultés exceptionnelles d`accouchement et il a fallu l`intervention de deux médecins (Duvivier et Ithier) qui ont employé fer, chloroforme, points de suture et le reste.
Tout de même le Bon Dieu a préservé la mère et l`enfant et nous avons à lui rendre des actions de grâce car il aurait pu se produire ce qui est arrivé à la jeune Madame Desvaux, Lise de la Roche, qui dans la même nuit, dans la même clinique, prise de douleurs de l`enfantement fut portée sur la même table d`opération que Claire, et après les mêmes interventions chirurgicales et chloroformiques par Duviver et Lavoipierre fut délivrée d`un enfant déjà mort dans son sein et qu`on eut grand peine à lui arracher !
Pauvre jeune femme, pauvres parents éplorés, nous avons compati a votre chagrin quand Mme de la Roche venait à tout instant dans la chambre de Claire a côté pour nous dire les péripéties de l`accouchement, et enfin en dernière heure pour nous annoncer la perte du petit garçon qui était beau parait-il, et pesait 9 livres.
Bernard n`a pu être baptisé que 5 jours après, le 28 Juillet à Lourdes par P Lapeyre, son parrain est Pierre Koenig et sa marraine Rachel Koenig (Lundi à la clinique).
Mercredi 10 Aout 1943
Quinze jours après les couches de Claire c`est Lily qui se met en devoir de donner le jour a des jumeaux : un garçon et une fille, et cela avec toute la célérité et la prestesse qui lui sont coutumières. Quel contraste entre les deux sœurs : Claire des plus laborieuse dans l`accomplissement de sa tâche, Lily le faisant sans tambours ni trompettes et pour deux enfants alors que le petit Bernard arrivait tout seul.
On a baptisé les jumeaux à Lourdes le Dimanche 8 Aout à 4hres pm. Le petit garçon fut nommé Alain et eut pour parrain et marraine : Michel Koenig (dit Mico) et Wilhelmine fille de Cina. La petite fille nommée Chantal eut comme parrain et marraine : Claude Koenig et Geneviève Koenig ma petite-fille. Il y eut lunch à la clinique.
Lily avait dû aller à la clinique au lieu de faire ses couches chez elle à cause de l`impossibilité d`avoir la nurse Ladégourdie au moment de tomber malade alors que Lily comptait jusqu`au 14 aout ne l`avait retenue qu`à partir du 14. Il se trouvait que Ladégourdie était chez elle le soir des couches de Lily et se tournait les pouces à ne rien faire… Dans ces conditions Lily a préféré rentrer chez elle trois jours après la naissance de ses enfants par raison d`économie d`abord, et pour être plus à son aise chez elle et se rapprocher de ses trois ainés qui se désolaient de l`absence et de l`éloignement de leur mère sans compter que Pierre était mis à une rude épreuve, à faire la navette entre Quatre Bornes et Rose Hill chaque jour. Le voyage de retour s`est bien effectué, Lily étant transportée de la clinique en auto, sans toucher terre, et débarquée dans son lit a Quatre Bornes sans aussi mettre le pied à terre.
Les ainés de Lily entourent les nouveaux nés de leur sollicitude et de leur empressement plutôt trop grand. C`est à qui veut bercer les petits anges, et Rose Marie répète à qui veut l`entendre en parlant des nouveaux nés : Zoli ! Zoli !…
Villégiature de cinq semaines au Bord de la Mer.
15 Novembre 1943
Séjour merveilleux sur le rivage des `Grandes Salines `de la Baie de la Grande Rivière Noire, dans le campement des Koenig Frères. Cinq semaines de farniente passées en compagnie de mes enfants et petits-enfants : Lily et Pierre et leurs enfants, Claire et Claude et le petit Bernard. Partis le 11 Septembre, nous arrivons au Campement dans l`après-midi et la soirée se passe à emménager le campement pour le diner et la nuit. J`occupe une petite chambre à droite de la maison et ma cellule me plait complètement.
Le réveil du lendemain est joyeux, chacun a bien dormi, reposé des fatigues de la veille. Nous prenons nos repas dans la belle salle à manger flanquée de panneaux vitrés qui permettent de voir pendant les repas tout le mouvement des bateaux de pêche qui évoluent dans la Baie. L`œil se perd dans le vaste horizon bleu de la mer et suit le rêve que produit cet aspect enchanteur. J`y retrouve pour ma part des réminiscences émues de nos anciens séjours a la Baie du Tamarin au Campement du Barachois qui appartenait à mon beau-frère, ou j`ai été si heureux mon Dieu, ayant connu la ma fiancée et y ayant ensuite consacré mon bonheur jusqu`au jour où j`ai fait construire sur l`autre rive mon propre campement, bientôt incendié par la vengeance d`un gardien que j`avais congédié pour s`être permis d`habiter mon campement pendant mon absence.
Le temps passe doucement pendant notre séjour aux Salines. Promenades à pieds le matin à travers l`immense étendue de salines, la campagne herbeuse et jonchée de tamariniers, d`aloès et de filaos.
Perspectives charmantes de longues allées de filaos traversées souvent par des troupeaux de bœufs dont les longs beuglements vous effrayent ou par le bourriquet François qui sert de moteur au petit tramway transportant le fil à l`embarcadère pour être chargé sur le St Raphael et expédié en ville.
Une de mes promenades favorites s`accomplissait vers le campement de Jean Koenig, bâti sur une éminence qui servait de bastion aux Français d`avant la prise de l`ile par les anglais, non loin de la Tour l`Harmonie qui dresse dans la solitude du lieu son imposant stature. La Bastion a été créé par les Français et il a été remanié par les Anglais qui les ont flanqué de canons et d`obusiers, et il ne reste de Français que la poudrière dont Jean Koenig se sert comme de garage pour son auto lorsqu`il est en séjour à son campement, qui domine la mer de cent pieds et d`où la vue sur le Morne Brabant, le Piton de la Rivière Noire et la chaine des montagnes de Chamarel offre un spectacle vraiment grandiose.
Nous visitâmes un jour la Tour de l`Harmonie en compagnie de Jean Koenig, de Lily, de Melles Marthe Lesur et Bourgault et montâmes jusqu`au faite et jouîmes d`une vue circulaire splendide.
J`avais adopté un filao non loin de cet endroit dont les racines désensablées par la vague offraient l`apparence d`un bon siège pour lire ma Messe lorsqu`il n`y en avait pas a St Augustin, Eglise de la Baie de Rivière Noire. Commodément assis dans ce rustique fauteuil je lisais toute la Messe dans mon Missel et faisais pour moi-même le Commentaire de l`Evangile du jour en face de l`immensité bleue qui servait d`images a de saintes réflexions sur l`immensité de Dieu et le néant des hommes qui cependant se croient plus que le créateur de ces belles choses et tentent de détruire ses œuvres dans le monde.
Jean Koenig administrateur de la Société des Salines venait chaque jour en auto pour son travail et prenait ses repas du matin avec moi. C`est un compagnon charmant et intéressant à entendre, il a une culture générale assez complète et j`avais plaisir à converser avec lui sur toutes les questions littéraires, scientifiques et historiques. Il est un peu `cone tout`et sa famille le consulte même sur les questions médicales. Il conduit très bien son affaire des Salines et par des économies rationnelles procure des dividendes substantiels à ses frères et sœurs associés.
Les Salines sont le rendez-vous de la famille, on vient tous les Dimanches se promener, chasser, pêcher. Les Pilot sont les plus assidus ainsi que les Maroussem, alliés aux Pilot.
Voici les personnes que j`ai vues pendant mon séjour de 5 semaines : Marguerite Pilot, Paul Pilot et sa femme Aline Gourrege, René Pilot et sa femme Suzanne Raffray, Jacques Pilot et sa femme Josée Rouillard, Philippe Pilot et sa femme Zita Piat, Raymond Pilot et sa femme Melle Goupille, Philippe de Maroussem et sa femme Pilot, Paul de Maroussem et sa femme Margot Pilot, Marcel de Maroussem et sa femme Mignon Pilot, Babsy la femme de Gaston Koenig jeune, toute la smala des enfants Pilot et Maroussem qui se montait à une douzaine …ou plus. Parmi les étrangers j`ai vu M. et Mme Gustave Bourgault, Melle Marthe Lesur, Melle Bourgault et des enfants Bourgault, Stan Pelt et Thérèse qui étant en séjour dans leur campement sont venus aussi plusieurs fois. Ces derniers pêchaient régulièrement au large le matin dans leur bateau moteur et le soir vers 5 heures en face de notre campement. Ils nous ont plusieurs fois gratifiés de leurs pêches à notre grand enchantement.
Il y eut aussi une visite sensationnelle et officielle un jour. M. Parkisson, envoyé de Londres pour fureter a Maurice voir ce qu`on pouvait encore tirer des poches des Mauriciens, vint en compagnie du député de quartier Philippe Raffray, du député des Pl. Wilhems Pierre Hugnin, et de quelques sous ordre, visiter les marais salins … et le reste. Il y eut même un incident assez “cocasse“ : le Gouverneur inconnu de tous ne fut pas présenté à Jean Koenig, qui n`y prit garde étant tout occupé de Mr Parkisson et toute la visite se passa sans qu`on fit la moindre attention au Gouverneur Mackensie. Jean alla même dans son auto promener l`envoyé de Londres du côté de son campement et lui faire voir la Tour et le Bastion l`Harmonie laissant le Gouverneur assis sur un tronc d`arbre avec les autres visiteurs. Le bon Gouverneur dut attendre 20 minutes le retour des promeneurs et avait l`air ennuyé.
Ce n`est qu`au départ de ces messieurs que Jean sut que l`un d`eux était le Gouverneur. Il se confondit en excuses d`avoir ignoré sa grande excellence. Ce fut la faute du député Raffray qui aurait dû faire les présentations en arrivant.
- Parkisson voyant voler des chauvesouris témoigna le désir d`en gouter et Jean et son gendre Sauzier vinrent plusieurs fois chasser cet oiseau rat pour lui en procurer.
Nous eûmes aussi les visites de Marc et Raymonde, Sauzier et sa femme (fille de Jean), Lise et Ado Cayeux et leurs fils.
Le soir de la mort de Marie Robert ou plutôt le soir de son enterrement 13 octobre, Germaine ne voulant pas rester à Rose Hill après le départ définitif de sa mère vint aux Salines avec son mari Jean mon fils. Ils y demeurèrent jusqu`au lundi 8 novembre dans le campement de Marc. Ils ne veulent plus retourner dans la Maison filiale et cherchent une maison à acheter ou à louer à Rose Hill ou à Quatre Bornes.
C`était gai de promener avec les enfants sur le rivage et d`assister à leurs ébats dans l`eau. La petite Rose Marie surtout était intéressante à voir et à entendre. Ils étaient un peu bruyants aux heures des repas et faisaient les 400 coups dans la salle à manger. Leur grande distraction était de pêcher aux tec-tecs dans le sable ou ils prenaient parfois de quoi faire un bon bouillon.
Ce qui n`était pas agréable à entendre c`était le concert donné par les jumeaux de Lily chaque jour. Par une fausse théorie de leur père et mère on les mettait dès le matin dans leurs bers sous la varangue et puis on ne s`en occupait plus. Défense aux bonnes d`y toucher. Ces mioches se mettaient à brailler du matin au soir au grand dam de ceux qui étaient dans leurs environs. Le petit Alain braillait si fort que son nombril en sortait. Dr Dupré consulté avait déclaré que c`était mauvais pour sa santé et qu`il valait mieux tenir l`enfant dans les bras pour lui éviter un dérangement d`organe, ce qui fut fait dans la suite.
Pierre et moi visitâmes d`anciennes constructions françaises dans un lieu appelé la Maison Blanche, curieuses ruines encore solides. De là on jouissait d`une très belle vue sur la chaine des montagnes de la Rivière Noire. Les jours ou l`on disait la messe à St Augustin ou à la Petite Case Noyale, nous y allions par bateau ou dans l`auto des Pelte. Le Curé Egan officiait. J`ai revu l`emplacement de la maison de Popin `La Butte` a la Petite Case Noyale, il n`y a plus vestige de rien après vingt ans.
Les Bourgault, Lesur, Pierre et Claire sont allés a Chamarel dans l`auto des Bourgault, ils ont été reçus par le Curé qui leur a donné de la vanille de sa Cure. Il plante du mais, des haricots, de la vanille et chasse au cerf comme St Hubert lui-même.
Stan et Thérèse nous ont une fois donné place dans leur auto pour aller assister à la Messe à la Petite Rivière Noire. Nous avons rencontré là les Maurel (Léon), les Lagane, dont l`une a épousé Robert le Maire. Ces deux dernières sont venues faire visite au campement. Madame Le Maire est une grande partisane du Maréchal Pétain et s`est informée auprès de Pierre, avant d`entamer la discussion politique si Mr Toulorge était un `bien-pensant` ? Sur la réponse affirmative de Pierre elle a donné libre cours à ses réflexions qu`elle sentait appuyées par moi.
J`ai bien visité tout le système de travail des Salines depuis la prise de l`eau de mer par un moteur a double qui envoie l`eau par toutes les canalisations dans les différents bassins jusqu`au moment où ces eaux évaporées laissaient une récolte abondante de beau sel qu`on enlevait dans des paniers et emmagasinait dans de vastes hangars. J`avais porté labas mon télescope, et comme a Tamarin vingt ans plus tot j`explorais toute l et tous les horizons.
C`est ainsi qu`un jour de forte brise j`ai assisté a de véritables régates dans la Baie de la Riviere Noire. Sept ou huit cotiers renoncant a poursuivre leur route sur le Morne ou Bel Ombre sont entres dans la Baie pour y passer la nuit. Ils se livrerent a de curieuses maoeuvres pour entrer dans la Baie par la passe. Les memes vents leur faisaient prendre des bordées differentes et les dirigeaient en sens tantot direct, tantot contraire avant d`atteindre la passe d`ou alors ile entraient directement a leur mouillage. Ce fut un tel chassé croisé que je crus d`abord que ces cotiers étaient poursuivis par un sous marin japonais et qu`ils fuyaient en desordre.
Gustave Bourgault est un pecheur passionné. Il venait souvent débaucher Pierre ou Claudepour une peche aux chevrettes et aux crabes, ou pour un coup de senne devant le campement. Seulement, par suite de politesse échangée entre eux il repartait toujours avec tout le produit de la peche pendant que nos marmites restaient vierges de toute friture.
Les pionniers de la Coastal Defense dont le poste est contigu au campement de Jean, qui allaient chaque jour prendre leur poste de surveillance en mer passaient leur temps à pêcher et sont souvent venus vendre le produit de leur pêche au campement. Ils partaient sur un petit bateau moteur du nom de Marlon que j’entendais mettre en marche tous les soirs vers six heures et rentrer le matin à 7heures. Ils emmenaient avec eux un petit singe qui faisait fonction de mousse à bord.
1er Janvier 1944 (Samedi)
Il pleut ! Depuis huit jours nous sommes sous l’influence d’un cyclone qui vient de se manifester dans l’Ouest et nous tient encore sous ses effets par la continuité de la pluie et de la chaleur.
A ce temps sombre et triste viennent s’ajouter les soucis de “guerre“ sous forme de privation alimentaire, difficultés de transport, malaise politique et social. Oui social car le virus de la démagogie s’infiltre et fermente dans les basses classes et parmi les Indiens. On sent la révolte proche, non pas de la part de ces classes noires qui n’ont à se plaindre de rien, mais de la part de la société blanche qui est frappée d`ostracisme par le gouvernement anglais qui la sacrifie aux gens de couleur et aux Indiens.
J’entrevois le moment où toutes les vexations vont déclencher un sursaut de mécontentement à l’égard du gouvernement et si le vieux sang français coule encore dans les veines du Mauriciens on assistera à de violentes réactions de la part des descendants de Bayard et de Du Guesclin.
Je me suis toutefois écarté de mon sujet. Je voulais simplement raconter les événements de ce triste début d’une nouvelle année et retracer l’horaire de cette journée. Ce matin messe au Rosaire, Communion. Ma visite au cimetière de Saint-Jean. Je suis obligé d’acheter des fleurs au marché de Saint-Jean car plus une fleur ne se montre dans mon parterre dépourvu pas suite de mauvais temps. Longue prière auprès de Gabrielle et des enfants dont la grille qui enveloppe leurs restes vient d’être repeinte. Un saut règlement des autorités a obligé tout le monde à retirer les vases a fleurs de sur les tombes à cause des moustiques et de la malaria. Les bouquets sont disposés à même les tertres et les fleurs mourant elle-même bien vite pour se confondre avec ce dont elles symbolisent un moment par leur présence la renaissance à nos yeux et à notre cœur.
Les visites de mes proches commencent : Alice, Xavier, Françoise, Elsie et Marelene. Pierre et Lily et leurs deux aînés, Bernard qui précède Claire et Claude et qui se fait admirer et embrasser à la ronde. Henri, Madeleine, Poppin, Hedwige arrivent en auto et à 11h tout le monde est parti pour mieux permettre de déjeuner.
Aucun `Fla-fla, il n’y a rien à manger dans ce pays -ci à cause de la guerre, à cause des réfugiés juifs, à cause des troupes blanches, noires et café au lait, à cause aussi du marché noir et à cause encore des contrôles de Food, lisez nourriture, qui sont strictement les obstacles à la possibilité de se procurer de quoi se mettre sous la dent. Tout est vendu au prix fort et la famine est là qui guette nos squelettes, et cela durera longtemps encore, le temps de compléter la destruction progressive de nos corps qui permettra à nos ames de s’en échapper pour le plus grand bien. Mon dieu faites cesser cet état de choses. Il y a trop de gens qui souffrent par la volonté d’un groupe de Seigneurs de la guerre, qui eux vivent comme des rois d’un bien-être payé par la sueur, les larmes et la mort du plus grand nombre, dont les poches sont fouillées, dont les estomacs sont vides, dont le deuil est éternel et qui n’attendent que Votre grand geste qui fera renaître la paix et qui confondra les égoïstes jouisseurs juifs qui n’arrêtent pas la guerre parce qu’elle aimerait parce qu’elle les sert et les enrichit, leur fait croire à la domination ambitionnées du monde.
Faites que ce soit la France qui règle maintenant l’ordre dans le monde et non l’anglo-saxon. La France, généreuse et pitoyable à tous ceux qui souffrent d’injustice, la France qui accomplit toujours vos gestes (Gesta Dei per Francos) et qui a toujours été l’ange de la paix dans le monde.
O 1er janvier 1944 quelles triste réflexions tu m’obliges à faire ! En sera-t-il de même tout le long de ton existence et arriverai-je moi-même au bout de ta longueur ?….
23 novembre 1943 (mardi )
On a dit ce matin au Rosaire la messe pour Gabrielle, je sortais de l’église et cheminais sur la route du retour à la maison lorsque je rencontre au détour du chemin un couple de jeunes adolescents qui revenait aussi de la messe et tendrement rentraient chez eux. C’était deux jeunes fiancés, le fils d’Antoine Koenig et Mademoiselle Le Merle. Ces tous jeunes enfants revenaient d’un long séjour à Médine que Monsieur Le Merle administre. Ils m’intéresserent au point que je m’enfonçai dans mes souvenirs du passé, et que longtemps après les avoir dépassés je rappelai dans ma mémoire ce temps heureux de mes fiançailles aux mêmes endroits qui viennent de les voir étaler leur jeune bonheur.
Oui ils étaient il y a huit jours encore à Médine là-bas où il y a 57 années je me trouvais moi-même et dans les mêmes conditions. Je me revoyais jouissant du même bonheur ayant à mes côtés celle qui comme la jeune fiancée du fils d’Antoine répondait à mes tendres sentiments avec tout l’amour dont elle était capable.
C’était nous que je voyais devant moi et c’était la répétition de la même tendresse, et la vision du même bonheur. Les pas dans nos pas ils ont parcouru tous les endroits de Medine, se disant les mêmes paroles se jurant le même amour entrevoyant le même avenir.
Medine il est vrai est totalement transformé et beaucoup de témoins de notre amour ont disparu avec le temps. La maison qui nous abritait, là serre où nous passames des heures si heureuses, n’existe plus mais c’est le même sol, les mêmes grands arbres, les mêmes sentiers pas lesquels comme dit Victor Hugo nous repassions cent fois.
Les mêmes échos ont répété les mêmes mots, les mêmes silences ont enveloppé de leur mystère les mêmes extases.
O jeunes gens que vous nous avez rappelé nous-mêmes et combien vous m’avez touché par cette similitude de tendres sentiments. Vous saurez apprécier comme nous naguère la bonté de Dieu qui permet que deux êtres se fondent en un seul dans le plus vaste bonheur de ce monde qui est d’aimer une fiancée puis une épouse avec toute la sincérité que deux coeurs peuvent contenir.
Vous aimer comme nous jusqu’à la mort et au-delà car tout ne finit pas ici-bas et recommence ailleurs après une transformation nécessaire qui promet l’immortalité. On s’aime dans la vie, on s’aime mieux dans la mort, lorsqu’on est certain qu’un jour ceux qui se sont saintement aimé se retrouveront dans une éternité de bonheur.
Et c’était ce que je venais de demander à Dieu dans la communion que j`offrais pour la chere àme de mon épouse et pour la mienne aussi lorsque mes jours bientôt révoluent elle se lancera vers Dieu, qui ne permettant pas que ce qu’il a unis soit séparé voudra bien confondre nos deux ames dans la profondeur de son amour.
Soyez heureux, jeunes fiancés, et que Dieu vous accorde comme a nous un grand amour. Hélas un jour viendra où de vous deux il n`en restera plus qu`un sur la terre.
En cela aussi votre cas sera semblable au nôtre, et alors puisez dans la foi de Dieu et dans l’espérance Chrétienne la force de supporter comme moi avec résignation la volonté sainte de celui qui nous éprouve.
Campement de la baie de Tamarin – ( Barachois)
14 août 1944
Ce matin sont partis pour le Barachois Alice, Lily, Claire mes trois filles, et Suzanne fille d’Étienne. Elles vont déjeuner chez Elisa qui est en séjour là-bas et passer la journée. Elles vont s’amuser, rire, jouer au Mah-jong, se baigner, prendre le thé, tourner, virer dans le Campement aujourd’hui réduit à sa plus simple expression mais je suis bien sûr qu aucune de ces d’un jour ne pensera, pas quelle l` ignore, quel fut le rôle que ce paradis terrestre a joué dans notre destin et de quelle existence il fut le prélude. Elles vont passer par des sentiers qui ont été suivis par d’autres pas, fouler une plage qui nous vit marcher la main dans la main, le cœur ému, la pensée confondue et le bonheur dans nos àmes.
La vague bruyante déferlera a leurs pieds en leur racontant les serments échangés, l’atmosphère encore saturée de nos invisibles présences les entourera de notre effluve mais ils n’en sauront rien ! Une commune indifférence les possédera parce que les enfants d’aujourd’hui ne sont pas attachés aux choses, aux souvenirs.
Et pourtant voyez les ces chers souvenirs, ils sont là sous vos pas, et ils sont là sous vos yeux, vos oreilles en perçoivent l`écho. Seulement les guides qui auraient pu vous en instruire ne sont pas à vos côtés. Le grand-père est mort, les oncles, tante, cousins sont morts, la jeune génération ignore. Vingt témoins des jours heureux de 1884 à 1886 et des années subséquentes sont morts aujourd’hui et le silence plane sur cette terre heureuse qui voit aujourd’hui d’autres hôtes si indifférents à mon souvenir et si étrangers à ce qui fut nous !…
Moi seul ici dans ma solitude je revois ces scenes passées et ces brûlants souvenirs.
Qu’il serait doux de se retrouver ensemble dans l’autre séjour, celui que Dieu prépare a ceux qui l`ont connu, a ceux qui l`ont aimé, et quelle belle récompense pour ceux qui pleurent le passé et qui voudraient le faire revivre, que de longer les rivages éternels.
Retraite du Tiers Ordre 13 septembre 1944
Mercredi dernier 6 septembre s`est ouverte à la chapelle de Notre-Dame du Bon Secours, (Belle Rose) la retraite annuelle du Tiers Ordre de St-François-d’Assise à laquelle j’ai pu assister.
L`année dernière j’étais en villégiature au bord de mer des Grandes Salines de la Riviere Noire, et n’ai pu suivre cette retraite, à mon grand regret car on en retire toujours un grand bienfait spirituel qui vous prépare doucement à améliorer votre vie et à vous mériter des grâces si nécessaires pour votre sanctification.
Cette année-ci, libre de tout empêchement, je me suis abandonné au courant religieux qui nous entraînait à nous isoler du monde et de ses invitations pour me joindre a mes frères et sœurs en Saint-François, et réaliser cette rentrée en moi-même pour permettre à mon ame de se laisser pénétrer des pensées divines et religieuses, dont les effets sont la transformation de vous-même en un sujet apte à mieux comprendre le but final de votre vie et à vous prêter à cette réussite de toujours reformuler votre état de chrétien appelé à travailler à son salut.
La retraite dura trois jours, les 6, 7 et 8 septembre et comporta une série de conférences faites par le Père Claude Sauzier, jeune prêtre mauricien qui fut vraiment à la hauteur de sa tâche. Il faisait trois conférences par jour :
La première eut pour sujet la nécessité de faire son salut.
La deuxième fut l’explication de Dieu, du Saint Esprit et de Dieu le fils dans la Sainte Trinité .
La troisième roula sur la bonté.
Le quatrième sur la tiedeur dans le service de Dieu.
Le cinquième sur l’obligation de participer à la convertion des hommes.
Le sixième sur le caractère de chacun qu’il faut changer et améliorer.
Le septième sur la mortification, la ferveur, l’absence ou l’abandon des scrupules.
Le huitième sur les mêmes sujets que le 7eme.
Le neuvième et dernier : nul ne peut servir deux maitres à la fois.
Entre-temps on récitait l’office et se livrait aux méditations et à la prière, on récitait le chapelet ou examinait sa conscience. Chaque jour de retraite se terminait par le salut du Saint-Sacrement. Le jour de la clôture le Pere Nadou, curé de Saint-Jean et directeur spirituel de la Fraternité est venu faire la `Coulpe` puis a donné la `Veture` a une novice (Madame Roger Giraud). Les Professes ont fait le renouvellement de leur profession. Pendant le temps libre de la journée j’ai été deux fois prier sur la tombe de Gabrielle. La deuxième fois (le 7 Septembre) qui était la date anniversaire de notre mariage. Je suis sûr qu’elle a prié Dieu pour moi pendant la retraite et moi je me souviens toujours de sa présence aux heures des retraites qu’elle effectuait avant sa mort, et j’espère fermement que Dieu a déjà reçu sa fervente Tertiaire dans son beau paradis.
Meme jour :
Claire, Claude et Bernard sont partis pour le Poste Lafayette ou les Koenig ont un campement pour passer les 15 jours de congé que Claude a obtenus de sa banque. Ils sont partis samedi et doivent rentrer le dimanche 25 prochain. L`auto qui les emportait était chargée à sampré : paquets, nénene, cuisinier etc. immobilisaient les occupants qui ne pouvaient plus faire un mouvement. Moi je reste ici, ne pouvant bouger de la maison cette année à cause de l’audit du Syndicat des Sucres qui n’est pas terminé par suite de la quantité assez importante de sucre non expédié, faute de bateau. Alors Françoise, Sibylle et Léon, mes petits-enfants, viennent me garder de peur que je ne m`évade. Rachel se joint quelques fois à Françoise pour rendre sa tâche moins monotone et aussi j’espère pour m`etre agréable.
Mais je suis privé de mon petit Bernard est le cherche souvent, c’est mon petit compagnon de solitude et lorsque son papa et sa maman sont en promenade, ce qui leur arrive tous les jours, lui il vient me tirer la barbe dans mon bureau ou dans ma chambre ou bien il écoute la radio avec moi. Il danse même lorsque la musique joue.
Souvent je suis seul lorsque que Léon est parti pour la ville et que Francoise et Sybille s’absentent. La première est partie pour trois jours à Tamarin avec Rachel chez Elizabeth et Zanise, et Sybil fait l’école la journée chez Cora et Agnes. Mais je ne me plains pas, je suis habitué à la solitude et la trouve quelques fois nécessaire quand ce ne serait que pour transcrire sur papier ses impressions du moment .
2 novembre 1944
Cette triste date est venue cette année sonner la mort d’un membre de la famille : Coralie, Cora comme on l’appelait ordinairement, a quitté ce monde pour aller rejoindre ceux de Medine qui nous ont devancé dans le grand départ éternel. Il s’en est fallu de 10 minutes pour qu`elle s`en soit allée à la date anniversaire de la mort de son frère, qui a succombé le 3 novembre 1903.
Ainsi de toute cette phalange groupée naguère à Médine, famille si unie, si attirante par la grande affection qu’elle m’avait inspiré au point que je me suis associé à leur sort en épousant l’une des plus charmantes créatures qui composait ce groupe ; de toute cette phalange il ne reste qu` Agnes et moi. Comment ne pas pleurer en constatant ces vides nombreux et cet isolement où nous nous trouvons maintenant Agnès et moi. Quel déchirement de l`Etre, quelle force morale aussi pour se dire que rien ne demeure, et qu’il faut faire suite à un moment donné et partir à son tour pour l’éternité.
Car c`est là-bas qu`on se retrouvera, là-bas qu’on sera consolé de tous ses chagrins.
La vieille sœur est partie avec toute la résignation chrétienne dont sa vie était remplie. Elle ne résista pas à l`apel divin, nulle résistance, nul regret mais l’abandon complet à la volonté divine, assurée de son salut après avoir mené une existence toute remplie de l’amour de Dieu. Sa mort est donc pleine d’espérance.
Mais elle laisse Agnès tout éplorée et seule, oui seule au monde. Seule à lutter contre les misères de cette vie après avoir partager ces misères avec elle pendant bien des années.
Recevez l`ame de la disparue et donnez à celle qui lui survit la résignation et le courage nécessaires pour atteindre un but que vous lui avez assigné.
19 janvier 1945
Deux nouveaux deuils sont venus nous frapper depuis la mort de Coralie le 2 novembre : la mort de mon neveu Henri fils de Mina d’une péritonite consécutive à une opération d’appendicite le 26 décembre 1945 et celle de ma cousine germaine Noémie de Froberville le 7 janvier 1945 à l’age de 82 ans. Henry était agé de 63 ans. En eux disparaîssent les liens qui me rattachaient au passé et je vois s`écrouler ma vieille famille dont il ne restera plus rien car des 34 membres de la famille des Cassis il ne reste plus que quatre survivants : Marc, Laurence de Chazal, Henri de Froberville et moi-même. Je suis de beaucoup le plus agé, des quatre, il est dans l’ordre des choses que je les laisse derrière moi sur la terre.
Cyclone du 10 au 17 janvier 1945
Un très grand ouragan vient de s’abattre sur nous, le plus violent depuis celui du 29 avril 1892. Paraissant à notre N/NE est le 10 janvier il a évolué sur une trajectoire 12/4 NE à Sud ¼ SO et a pris contact avecl`ile le 17 à 11h45 pm. Le centre, large d’une quarantaine de milles, a duré 2h1/4 et quitté l’ile à 2h1/4 du matin le 17. Les dégâts sont considérables maisons endommagées, toitures enlevées, cases d’indiens complètement détruites. Quatre Bornes a bien souffert mais pas autant que Port Louis et Curepipe. On n`a pas encore de détails complets sur les dommages éprouvés, mais d’après ce que j’en ai vu à Port-Louis en faisant une tournée dans la ville en auto avec Stafford Mayer, Dayot et Bertie Mayer, jusqu’à Sainte Croix il y a eu de sérieuses destructions d’immeubles, mais nullement comparables à 1890.
J`avais avisé mon fils Jean par le téléphone de Xavier chez l’hôtel Bodes que d’après mes observations le centre du cyclone nous traverserait dans la première partie de la nuit du 16 au 17 vers 10 heures du soir et le centre nous atteignit 1 3/4 heure plus tard que prévu.
L’observatoire avait envoyé un télégramme vers midi le 16 pour nous dire que le cyclone courbait et passerait à l’est de lile, nous donnant des vents du Sud. Grossière erreur, le centre suivait bel et bien la même trajectoire N1/4 NE, S1/4 SO sans dévier de sa route et me donnait pleinement raison dans mes pronostics.
Les rafales pres du centre et tout de suite après son passage furentt des plus violentes 100 miles a l`heure, et nous avons des heures angoissantes jusqu’au matin du 17. La maison de Jean subit des avaries et Germaine affolée passa toute la durée du centre à égrener son chapelet. Les pauvres Campements de la famille n’existent plus. Baie du Tamarin (Elisa et Fifi), Poste Lafayette et ailleurs sont complètement écrasés. Ces Campements ne seront certainement pas relevés car il n’y a ni clous, ni bois, ni ouvriers pour le faire.
18 janvier 1945
Je fais une conférence sur le dernier cyclone au bureau Denyali. Étaient présents : Stafford Mayer, Bertie Mayer, Lionel Dayot, Sr Guillaume Foucault et Mlle Collard. A la suite Stafford m’invite à une promenade dans son auto à travers Port Louis pour visiter les dégâts et dire si ce cyclone ressemble à celui de 1892 dans ses effets. Mais il est facile de voir que 1892 a été beaucoup plus désastreux. Nous allons jusqu’à Sainte-Croix. Dayot et Bertie nous accompagnaient.
L’après-midi en me rendant à la gare centrale je suis arrêté par Monsieur Tournoi du Chantier qui me demande si ce cyclone a été aussi violent que celui de 1892, et lorsque je lui réponds qu’il n’en approche que de très loin, il saute de joie en me disant que je confirme son opinion discutée entre plusieurs personnes à ce sujet, et qu’il est bien content de voir que nous sommes d’accord car lui aussi a vu 1892.
2 février 1945
Un nouveau cyclone visite la colonie. Son centre à passé sur Rodrigues le 31 janvier vers midi, puis poursuivant sa trajectoire a rencontré un cyclone qui descendait du NE et ils ont fusionné le 1er février, intensifiant instantanément leurs effets. Le baromètre a baissé plus rapidement et les vents sont devenus furieux quoi que maniables pour lile Maurice qu’il a tengenté le 2 vers 4h du matin. Beaucoup de dégâts à Quatre Bornes. La varangue du côté de Pierre Koenig s`est éffondré, brisant les grandes vitres de sa salle à manger, ce qui a occasionné une inondation dans la pièce. La colonne d’angle de sa varangue de devant a été écartée à sa base, descellant la pierre sur laquelle elle reposait. L`irruption du vent et de la pluie était telle que Pierre se disposait à s’enfuir chez le voisin avec toute sa petite famille. Même accident chez les Adrien Koeing : varangue à l’ouest écrasée, dégâts ailleurs. Nuit tragique ou tout le monde dans la maison à travaillé à se mettre à l’abri.
10 février 1945
C’est parfois assujettissant de s’occuper de cyclonerie et surtout d’avoir la confiance de beaucoup dans votre science et votre expérience des cyclones. J’ai été envahi par les questionnements sur l’évolution des deux derniers ouragans, et des demandes de tracer des trajectoires parcourues. J’ai dû répondre et donner satisfaction aux suivants: d’abord tous les membres de ma famille. Puis au directeur du collège du Saint Esprit (Père Lyston), la Supérieure du Couvent de Lorette Mere Ursula, l’ingénieur de l`Amirauté ( Monsieur Clark), Camille Rey, Jacques Dupont, Alan Mayer, Monsieur Dursina, Lily de Gercigny ( Mme Desvaux), Roger et Pierre Lacoste qui venaient plusieurs fois par jour aux nouvelles. Madame Kemane, C Bathfield (de Trianon), G. d`Hotman, Louis Lambert, Père Guérin qui me dit qu’il voudrait un jour visiter mon observatoire. Philippe d’Unienville de “Beau Plan“ , Alfred Koenig fils d’Henri, Elisa et les demoiselles Marot, Mme Lalanne, Gabrielle Harel, les Georges Koenig. Je crois bien faire de dire par modestie que “leur crédulité fait toute ma science“.
16 Février 1945
Hier soir, à une réunion des membres de fabrique de Saint-Jean, nous avons remplacé le regretté Mr Émile Laval fils, secrétaire, par Mr Paul Henri. Mr Laval est mort ces temps derniers des suites d’une congestion cérébrale. Homme très instruit et droit, d’une très bonne éducation, il nous captivait par ses conversations et sa haute tenue. A la suite de la réunion (vers 19h) nous avons été visiter les dégâts du dernier cyclone dans les vitraux de l`Eglise. Ceux du chœur ont particulierement souffert et la rosace du chœur a perdu un morceau qui justement représentait la tête du Christ. Cette rosace était pourtant protégée par des vitres extérieurs et on se demande comment ce morceau s’est détaché, s’écrasant sur le sol du chœur (à l’intérieur). Je crains qu’il ne faille attendre longtemps pour le remplacement de ces morceaux détruits, longtemps peut-être après la guerre.
Avant la réunion j’ai passé voir et prier pour les miens au cimetière, qui est envahi d’herbe. Les deux cyclones ont déclenché une végétation inouie parmi ces tombes qui sans doute offraient un terrain bien engraissé pour son développement et ce n’est qu’un tapis vert d’un bout à l’autre du “nécropole“, chemin compris.
Les Anglais de Maurice, fonctionnaires du Gouvernement surtout, ne vivent plus depuis la visite des deux récents ouragans et ne comprennent pas qu’on puisse habiter un pays aussi dangereux.
Le fait est que ces insulaires, comme nous, n’avaient jamais assisté aux “performances“ de cyclones dévastateurs et ces bon anglais qui traitaient les Mauriciens d’incapables de mettre de l’ordre dans leurs maisons et réclament toujours des dons et des prêts de la Métropole pour se relever après le désastre, se rendent compte maintenant “de visu“ de ce que l`habitant peut souffrir d’un violent , de ce que les habitants de Maurice peut souffrir de la guerre et du peu de sollicitude de l’Angleterre a leur endroit en ne les ravitaillant pas, alors que la Réunion et Madagascar nous envoient (en cadeau) des cargaisons de pommes de terre et de pois. Ces beaux Messieurs vous fouillent dans les poches pour remplir la caisse du Toll Tax et de l`Income Taxe, et vous arrachent violemment les mêmes profits qui vous sont laissés pour satisfaire à l“ Exess Profit Taxe“.
Si encore ils vous donnaient un prix équitable de vos sucres vous pourriez en sortir mais ils vont fixer vos prix qu’on ne peut ni ne doit discuter àfin que les pertes que vous subissez soient les profits que fait la Métropole. En bon français cela s’appelle… voler.
Que sera la fameuse réorganisation de l’après-guerre. Je voudrais bien me tromper en disant que l`anglo et le saxon tireront la couverture a eux et mettront au grand jour le fait qu’ils ont déclenché et poursuivi la guerre que dans ce but égoïste.
En tout cas tout ce qui est Français à Maurice leur “ pue au nez“ et ils voudraient bien s’en débarrasser à leur profit et a celui des “Malabars“, qu’il poussent en avant pour nous dégoûter de vivre dans ce pays de Maurice qui fut l’ancienne Île-de-France.
dimanche 18 février 1945
Le temps.
Quelle drôle de saison nous avons depuis septembre dernier ! Il y a eu la présence dans nos environs de six cyclones qui ont évolué dans nos parages dont deux nous ont fort maltraités. Le baromètre, depuis l`ouragan du 16 et 17 janvier n’est pas remonté à la normale et il est depuis le dernier ouragan des 1er et 2 février resté dans les environs de 755 millimetres.
Il n`y a eu aucun orage. L’air est agité par de nombreux cirrus, une certaine fraîcheur nou caresses les matins et soirs malgré la chaleur des journées. Les vents se maintiennent à l`Est et au Sud 1/4 Est avec des frissons de brise légère.
Je n’aime pas cet équilibre instable de l’atmosphère qui peut être rompu défavorablement à tout moment.
Il est évident que le cadran Nord ou NO est “déprimé“ , ce qui cause la hauteur barométrique au-dessous de la normale et un état propice a l`éclosion d`un cyclone.
4 mars 1945
Un nouveau deuil de famille : Marcelle Cheveau, la fille de ma sœur Augusta est morte ce matin à 7h du diabète avec complications aux poumons. Elle habitait seule dans sa petite maison construite par Alfred et qu’elle legue par testament à son frère Rivalz. Elle fut bien entourée par la famille pendant sa maladie. Ses nièces Châteauneuf lui furent bien dévouées passant journées et nuits à la soigner.
La messe de 7h30 au Rosaire finie j’étais allé comme tous les Dimanches faire ma visite à Agnès et la quittant vers à 9h30 je suis allé savoir des nouvelles de Marcelle. Rendu à sa maison je suis frappé du silence qui règne autour de la maison et pénètre sous sa varangue. Son lit avait changé de place et était paré de fleurs. Je m’approche, étonné, et je la vois étendue les mains croisées sur sa poitrine entourées d’un chapelet. Elle est morte, demandais- je à la nurse Ramiah qui était seule à son chevet. “Oui “ dit elle. Personne de la famille n`était là car les Châteauneuf étais parties pour Moka avec l’intention de revenir plus tard.
La nurse l`avait assisté dans son agonie et après sa mort fait tout le nécessaire en attendant les membres de la famille qui arriverent un par un ensuite.
Pauvre Marcelle ! c’est une délivrance pour elle car son existence était devenue bien misérable. Completement ,aveugle elle ne pouvait plus rien faire, ce qui lui était extrêmement pénible dans sa solitude, soumise à la garde de sa servante Odette, fille bien dévouée mais qui n’était pas sa famille. Les dames de l’Oeuvre des malades s’étaient occupées d’elle et les exhortations chrétiennes ne lui ont pas manqué dans la circonstance. Il ne reste plus que Rivalz et Marc de toute cette famille d’Augusta qui se composait de huit membres jadis. René Châteauneuf fut un modèle d’affectueux dévouement s`offrant jour et nuit à tout faire et montrant une sincère affection à Marcelle.
Elle repose au cimetière de Saint Jean, non loin d’Alfred et d`Eva et aussi de France. “ In Aeternum “.
5 mars 1945U
Une épidémie de paralysie infantile importée par avion du Sud Afrique se déclare à Maurice. La frayeur s`empare de toutes les meres de jeunes enfants et les plus rigoureuses dispositions sont prises pour écarter la contagion.
On licencie les écoles, les jeunes serviteurs sont mis en congé et il y a des pessimistes qui comme Gribouille ferme les portes du jardin pour empêcher les oiseaux de s’enfuir, ont placé des barrages dans leur cour.
Comptons plutôt sur la Providence qui veille sur ses enfants et qui ne permettra pas que le mal s`étende si on lui demande secours en l’occurrence.
Officiellement 185 cas ont été reconnus au 17 mars. De remède, il n’y en a pas. Cependant on parle de succès pas l’application de rayon violet à l’hôpital Candos. ?
4 juin 1945
La lecture d’un fragment du Journal du vieil Alfred Koenig de 1878 à 1881 procuré pàr ma fille Lily a provoqué en moi un grand ressouvenir des événements dont j’ai été témoin à l’époque où ils sont relatés, et réveillé ma muse qui veut chanter le passé, les lieux et les gens que mon cœur regrettera toujours : Virginia et les Quatre Vents, et ceux qui y habitaient.
Vous venez du passé, Pensée qui me poussez
Irrésistiblement à ressaisir le temps !
Revenez, souvenirs de mes premiers printemps
Gardés toujours parmi les choses effacées.
Images, revenez en foule à mes yeux
Ne laissez pas ternir ces lointains bienheureux.
Il serait si doux de voir Henri et Mina
Apparaître a nouveau au Ciel de Virginia !
Le temps s`enfuit bien vite a l`horloge du Monde
Et quand il a passé il ne reste rien
Si ce n’est l’empreinte de la douleur féconde
Quel bonheur fut égal à celui qui fut mien !
Une maison qu`entouraient des jardins fleuris
Abritait l`ange que bientôt Dieu m’a repris
Trésor qui maintenant est bien évanoui
Regardez maintenant : ce qu’il en reste hélas !
Est dans le silence profondément enfoui
Voyez le vide affreux des choses de ce monde
Etendre sur ces lieux où respirait ma blonde
Ne cherchez plus maison, jardin fleuri ou cœur
Tout a sombré dans le gouffre de la douleur
Seul je subsiste encore effondré tout en pleurs
Triduum du Montmartre de Rose Hill pour la Fête du Sacré-Cœur
vendredi 20 8 juin 1945
Je peux dire que j’ai passé ma demi-journée en prière est en visites au Saint-Sacrement. Parti de Quatre Bornes à midi et demi en auto j’ai d’abord passé à Lourdes comme à chacun de mes voyages à Rose Hill, dire un tiers de Rosaire à la grotte en attendant d’aller au Montmartre rejoindre mes confrères tertiaires et commencer l`Adoration qui s’est prolongée jusqu’à 2h30 ou je me suis rendu au parloir pour voir la Mère du Saint abandon (Mina) que j’avais fait prévenir de ma visite en arrivant au Montmartre. Longue causerie avec ma fille sur tous les sujets : famille, santé, perspectives d’avenir pour tous les miens. Ces conversations avec ma douce religieuse sont un précieux auxiliaire à ma vie morale, à ma foi, mes espérances, ma charité et j’en reviens toujours avec un réconfort pour continuer ma route et prendre des résolutions conformes à toute vie chrétienne. Après ma visite (2h30) je suis retourné à la Basilique où j’ai fait une autre adoration qui s’est terminée à 4h30. A ce moment les religieuses qui étaient agenouillées devant le Saint-Sacrement se sont retirées et on a ouvert les portes du cœur pour permettre aux membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et de l’Union Catholique de se tenir pour le sermon et le salut. Mina m’avait dit : mets toi dans le chœur à la place que j’occupe d’habitude (au milieu du second banc) mais par humilité j’étais resté à ma place au tiers de l’Eglise vers la sortie et je voyais les membres des deux Sociétés se diriger par groupe vers le cœur et je me disais : il y a un précepte de l’Évangile qui dit : quand vous serez dans une assemblée ne prenez pas la première place, de peur que quelqu’un de plus important que vous ne vienne à l’assemblée, mais occupez la dernière place afin que vous ne soyez pas obligé de descendre de la première place pour la céder à celui qui est plus important que vous. Attendez que l’on vous dise Montez plus haut, ce qui sera un honneur pour vous. A peine m`étais-je fait cette réflexion que je vois sortir du chœur un des organisateurs de la réunion Mme d`Arifat, qui se dirige vers mon banc pour me prier d’aller rejoindre le groupe des adorateurs dans le chœur. Ce que je fais aussitôt en remerciant notre Seigneur de sa tendre invitation.
A 4h30 le père Chanert, jésuite, a fait un sermon sur le Sacré-Cœur qui m’a fort touché et dont j’espère retirer de bons fruits. Les Religieuses étaient à la tribune où les chants et l`orgue, habilement tenu, nous ont remué. Dans le Choeur j’ai remarqué Émile Pilot, d`Arifat, Jean et Marc Koenig, Mrs Duvivier, de Vilaine, Rault, Commarmond, Drusina etc.
En retournant j`ai offert place en auto à Pierre et à Lili qui assistaient aussi à la fête. La Mere Sr Liesse (Mlle Lamiot) une française, était partie depuis 15 jours en avion pour Madagascar et l’Afrique du Sud pour visiter les couvents de ces lieux en qualité de Supérieure Provinciale. On a déjà recu de ses nouvelles de Tananarive. Son voyage s’est bien effectué, un peu de mal de mer ou d`air à cause du temps défavorable. La basilique était remplie, et le Bon Dieu comme l`Eveque a du être satisfait de tant de dévotion parmi les amis de son cœur. La fête du premier jour s’est terminée à 5h30 et doit reprendre demain et Dimanche pour d’autres Congrégations.
Même jour.
un soldat indigène “Ascari“, noir de l’Afrique Est, sème la terreur dans les environs depuis quelques temps. Ces jours derniers il est entré dans la maison des Oxenham au fond de l’avenue où nous sommes et a voulu caresser Mme Humbert la fille de Monsieur Oxenham. Il paraît que c’est un colosse et lorsque Monsieur Humbert le mari a voulu l’en empêcher, le soldat en un tour de bras l`a envoyé promener. Ce n’est qu’aux cris de terreur poussés par les gens de la maison que les voisins sont accourus pour leur prêter main forte, ce qui a eu pour effet d’obliger l’africain à prendre la fuite.
Un autre jour le même individu à traversé la cour de la campagne occupée par Alice et Xavier pour aller dans la dépendance habitée par Julie la servante, qui était absente. Il a cassé le cadenas, s`est goulument jeté sur les aliments qui étaient sur la table, a saisi quelques objets et est reparti.
D`autres méfaits ont été rapportés des Vacoas sur son compte. Chacun en a peur et Claire depuis ce moment barricade les portes la nuit avec des meubles.
Pour ma part j’attends de pied ferme avec l’épée (de mes pères). J’ai chargé Claude de m’acheter des cartouches de revolver chez Clauzel. On ne sortirait pas vivant de chez moi si l’envie lui prenait d`y entrer.
Je préférerais ne pas tuer cependant, cela répugne et donne du remords, mais on ne doit pas hésiter à sauver la vie des siens et la sienne propre contre un ennemi qui lui n’hésiterait pas à vous envoyer Ad Patres.
Journal
mardi 12 juin 1945
Nous parlions Agnes et moi pendant ma visite hebdomadaire de dimanche dernier du Journal qu`avait tenu le vieille Alfred Koenig pendant 40 ans de son existence, avec beaucoup de régularité et d’assiduité, et elle me demandait si j’en tenais un moi-même. J’en ai écrit un de 1882 à 1885 étant jeune homme, mais ce n’était plutôt qu’un agenda contenant de breves notes de mes déplacements de Port Louis à Casela ou à Médine, de mes visites à droite ou à gauche,, de mes petites impressions de jeunesse sur les gens et les choses, de mes illusions et de mes désillusions qui n’étaient guère intéressantes que pour moi.
Ecrire un vrai journal quotidien maintenant c’est un peu tard. Ma vie est achevée, je ne crois pas que ma route soit longue à 85 ans ! Cette vie solitaire ne comporte pas beaucoup d’événements susceptibles d’être rapportés ; elle est plutôt régulière et monotone, et occupée à lire ou relire mes auteurs littéraires ou scientifiques, à méditer ou à prier, à me distraire parfois des évolutions développées chez mon petit-fils Bernard qui vit dans mon giron et absorbe beaucoup de mon temps !
Le temps j’en ai beaucoup, ne travaillant que peu à mes anciennes occupations, maintenant bien réduites à mon grand age. Je ne vais plus à Port Louis que trois ou quatre fois par mois, et chome le reste du temps.
Mais je veux essayer d’écrire ce que je pense et ressens chaque jour, cela me distraira peut-être, en tout cas ça ne pourra que me faire du bien. J’aurai ouvert sous les yeux un livre de conscience dont l’examen me sera facilité pour discerner le bien du mal, heureux si je ne puis y trouver que du bien.
Ma chére Gabrielle était bien douce pour cela et avait la bonne habitude toutes les semaines de raconter ce qui se passait autour d’elle. Elle avait composé 15 cahiers entre sa sortie du Couvent et le moment de ses fiançailles. Quatorze de ces cahiers que nous avions relus en 1886 ont été détruits et je conserve encore le 12e qui contient les bases de notre roman à tous deux.
Son style était joli et ses impressions bien rendues, toujours empreintes de bonté, découlant d`un coeur parfait.
Après sa mort j’ai lu et relu cent fois ce dernier cahier, qui à force d’avoir été manipulé tombe maintenant en poussière, et j’ai du le recopier en entier pour que mes enfants en aient connaissance après ma disparition de ce monde.
Allons ! à l`œuvre, et demain je raconterai la journée du 12 qui ne fait que commencer, si elle en vaut la peine.
mercredi 13 juin 1945
J’ai commencé ma journée par un manque de charité : Marceline, la fillette de Bengali mon ancien domestique, était venue me demander de la part de son père quelques cashs pour manger parce qu’il ne travaillait pas, ayant la fièvre. Comme je connais Bengali pour un vaurien paresseux, j’ai renvoyé Marceline les mains vides en lui disant : dis à ton papa ale travaille.
A peine elle partie, j’ai regretté fortement mon indifférence à son égard et aurait voulu courir après elle pour réparer ma dureté mais elle avait disparu. J’avais pourtant pris la résolution de ne jamais refuer à qui me demandait. Comme c’est difficile de bien faire du bien !
La petite fille de Lili, Chantal a été mordue par un petit chien chez Marie Adrien et sa petite joue porte les traces des dents du chien. Manque de surveillance des bonnes et manie d’avoir un tas d’animaux. Visite de Pierre Koenig vers six heures du soir. Promenade dans le potager de Claude (de 20 pieds carrés) qui ne contient que des petits pois assez bien venus, quelques salades, quelques carottes et petsai.
Aujourd’hui le 13 je suis allé en ville pour l`audit du Syndicat des Sucres que je fais en collaboration avec Camille Rey. Séance de 3h30 chaque Mercredi. Rencontré ma fille Alice au train de trois heures.
Ce matin j’ai passé chez Guillemin pour avoir des lunettes de myope pour Mina la sœur du Saint-Abandon. Elle m’avait donné ses numéros mais avait oublié l’écartement des yeux. J’ai alors écrit à la petite Mère de m’envoyer ce renseignement le plus vite possible.
Lili se charge de faire mon pain tous les jours. Avec Claire c’était la croix et la bannière, les proportions étaient capricieuses, le levain n’était pas bon, bref cela ne marchait plus après avoir très bien marché au début et il a fallu se résoudre à cesser le jeu et confier à Lily, qui est de meilleure volonté, la fabrication de cette précieuse base de mon alimentation.
Rentré chez moi avec une semaine de congé, la prochaine séance d’audit ne devant avoir lieu que mercredi prochain.
Jeudi 14 juin 1945.
Congé public pour l’anniversaire du Roi anglais Georges VI. Claude en profite pour se plonger dans la culture de son potager et Claire fait un extra en nous donnant à déjeuner un carry de volaille et du riz créole, le tout arrosé de vin blanc. Par les temps de privation alimentaire du moment c’est une bonne aubaine, donc je ne suis pas faché de profiter, quoi que je ne sois pas un gourmet.
Le temps est froid et humide ce qui me gèle les doigts et prive le petit Bernard de prendre ses ébats dans la cour. Il n’est pas facile à distraire quand il est enfermé et sa grande joie est de farfouiller dans mes livres pour voir des images et y mettre du désordre. Il est étonnant d’intelligence et connait mon Larousse Illustré sur le bout des doigts. On dirait qu’il est avide d’apprendre et j’en profite pour lui apprendre les Lettres, les Sciences et les Arts. Le plus drôle c’est qu’il s`applique à vouloir comprendre ce qu’on lui explique tout comme un Polytechnicien ou un élève de l’Ecole Normale, et il n’a pas tout à fait deux ans !
Sa marraine Rachel Koenig est venue le voir cet après-midi et il en a profité pour lui faire voir ses petites gentillesses. Agnes sa tante lui a envoyé un chandail bleu et blanc qui moule son petit corps et le fait ressembler à un marin en herbe.
Vendredi 15 Juin 1945
Jean m’a envoyé ce matin un morceau de cerf tué aux Salines Koenig. C`est la deuxieme fois que nous en mangeons depuis l’ouverture de la chasse qui a eu lieu le 1er juin.
C’est encore heureux que Jean et Pierre en reçoivent de droit quand on chasse aux Salines, et qu`ils partagent avec nous, car nous sommes bien oubliés pas les amis et parents chasseurs qui naguere nous envoyaient des quartiers de cerf qu à notre tour nous partagions avec d’autres.
Alice est venue nous faire une courte visite pour payer son compte d`œufs. Elle a fait du tricot dans mon bureau avec Claire et nous avons causé de choses et d’autres puis Claire est partie en auto avec Madame Claude de Gercigny (une petite fille à Amédée Hugnin) pour Vacoas où elles faisaient le tennis avec comme partenaire Ado Cayeux et Paul Nairac qui a épousé Cici de Chazal, la fille d’André. Elle a été reconduite dans la soirée par Lily de Gercigny et le couple Nairac qui dînaient chez Gercigny. Cici de Chazal lui a rappelé qu’elle était proche parente a nous, son frère étant mon cousin germain. On ne se douterait pas de la parenté étant donné le peu de relations qui existent entre nous. Après des relations très suivies dans notre jeunesse par André et moi nous avons fini par ne nous voir que très rarement et la belle dame n’est jamais venue nous faire visite de noces.
Vers six heures Elsie la fille d’Alice et Mimi la fille d’Antoine et de Odette sont venues écouter la radio. La petite d’Antoine sera jolie quoi qu` un peu brune de peau, ce qui la fait ressembler à une Andalouse.
vendredi 16 juin 1945
Mon petit Bernard s’est réveillé ce matin avec de la fièvre, température 38.2. Ce sont probablement ses dents de deux ans qui lui valent cela, il est maussade et garde le lit. Pendant que je l’amuse auprès de son petit ber il se tient un cours de broderie à côté, tenu par Mlle Baudot. Les élèves sont Claire ma fille et Claire et Geneviève mes petites-filles. C’est autant un cours de bavardage car les langues travaillent autant que les aiguilles et piquent le prochain autant qu’elles, mais sans toutefois le blesser.
C’est le jour où Lily va conduire sa petite Hélène au Couvent de la Réparation pour la faire catéchiser par Mina en vue de sa première communion en octobre. J’espère que la Mère du Saint Abandon pourra m’envoyer les renseignements demandés au sujet des mesures de lunettes de myope que je la priais de remettre à sa sœur.
Il fait froid, les alizés soufflent fortement depuis le large ce qui nous oblige à nous calfeutrer. Jusqu’à ce qu’il plaise à mon propriétaire de faire remettre en place un des chassis de la varangue on ne pourra s’y tenir tellement elle est exposée au vent et à la pluie. Ce lascar de Judoo est un fameux pingre qui ne veut rien dépenser et met son abstention sur le compte de manque de matériaux sur place pendant la guerre.
Les jumeaux de Lili Alain et Chantal sont venus nous voir cet après-midi. Ils ont contemplé Bernard emmitouflé et assis sur les genoux de sa bonne.
Dimanche 17 Juin 1945.
Réveil à 5h pour me préparer à la communion de 6h30, messe a 7 heures et demie. Après la Communion je vais comme à chaque fois prendre mon café au lait chez Lili et écouter la Radio de la Réunion et après la Messe je passe comme tous les dimanches chez Agnes qui me sert une tasse de café au lait, et nous causons du temps passé, de religion et de pédagogie. Elle avait été aux Bambous il y a une quinzaine de jours avec Jean et Germaine visiter au Cimetière de ce quartier la tombe de Madame Geffroy qu’Agnès veut habiter après sa mort et ils ont chargé le Curé de faire faire le nécessaire pour remettre le caveau en bon état. Agnes sera dans la paix la, endroit désert, calme, parfait ou l`on doit dormir d’un sommeil parfait. Seul le souvenir de ceux qui habitaient Medine flottera auprès de sa dépouille et elle saura par eux à quel degré de gloire ils sont parvenus au Ciel. Mais c’est bien loin pour permettre à ceux qui lui survivront d’aller la visiter à la fête des morts. J’aurais aussi aimé cette derniere demeure car les jours les plus heureux de ma vie se sont passés à Médine et j’aurais été content d’habiter non loin de ces lieux pour toujours.
Mais ma petite propriété funéraire se trouve a St Jean a toucher la tombe de ma chere Gabrielle et c’est là que nous serons réunis dans la mort.
Il y a eu aujourd’hui les 13 Heures à l’Eglise du Rosaire, j’ai fait une adoration de 3h30 à 4h30 à laquelle on a donné la bénédiction du Saint-Sacrement. Marie, la mère de Claude, Agnès, Rachel et les deux derniers garçons sont partis à 1h pour Tamarin passer plus d’un mois pour la santé de Marie. Ils sont dans le campement des Emmanuel qui fut autrefois le mien mais reconstruit sur mon ancien terrain et mes memes soubassements. Mon pauvre campement avait été incendié (tout porte à le penser) par “ Ayo“ mon gardien en 1915 à la suite de son renvoi parce qu’il s’était permis de l’habiter pendant la saison d’été.
Lundi 18 juin 1945.
Claire a écrit au docteur Duvivier de venir voir Bernard qui cependant est rétabli. La précaution n’est pas mauvaise car il faut toujours prendre garde a ces petites indispositions infantiles quand elles proviennent de la dentition ou des amibes, qui sont un peu je crois la cause de la maladie du petit en ce moment. Je profiterai de la visite du Médecin pour le consulter au sujet de mon estomac dont je souffre depuis quelques temps. La vieille machine se détraque avec l`age et comme on ne peut la réparer comme on le ferait d’un moulin à vent et même après le docteur pourra peut-être l`huiler ou la graisser pour en permettre le bon fonctionnement pendant le temps qu’il me reste encore à vivre.
Le journal a annoncé Vendredi la mort de Sybil Mayer en Afrique du Sud. Elle avait épousé Edgar Piat, qui raconte t-on, était mourant lui-même a Maurice ces jours derniers et avait reçu les derniers sacrements. Sybil était ma cousine issus de Germains étant la fille de Georges Mayer et de Berthe de Chazal tous deux cousins germains de ma mère. J`’ai reçu aujourd’hui un faire-part du mariage de Gilbert de De Chazal fille d’Olivier fils d’Evenor, cousin germain de ma mère avec Mr Georges Toudre, adjudant chef mobilisé a Maramanga (Madagascar). Le domicile du marié est à Belfort, France.
Le docteur Duvivier est arrivé dans l’après-midi, il ordonne des injections d`Emétine à Bernard. Puis il est venu me palper l’estomac et me donne de la noix vomique pour relever l`atonie de cet organe qui est paresseux. Pas de frites, de sauces longues etc. Je connais tout cela depuis mon enfance et reste persuadé qu’il n’y aura pas grand changement dans mon état.
Une grande joie m`est échue aujourd’hui ! Une lettre de 4 pages d’Emile ! Elle est arrivée par avion, mais passant encore par la censure militaire. Quelle indiscrétion de la part des autorités, même les hostilités terminées. Tout de même il me donne quelques détails de la vie et d’abondantes nouvelles d’Adrien parti depuis déjà une année pour rentrer à l’Ecole Aéro Navale en Algérie. Il se comporte bravement, il se trouve actuellement à Casablanca. Ses parents reçoivent souvent de ses nouvelles. Toute la famille est bien et Emile me propose de m’envoyer quelques colis alimentaires pour compléter nos menus Mauriciens si précaires dans le moment, ce que j’accepte avec reconnaissance. Il me demande les adresses de Joseph et du Général Toulorge pour en faire de même à leur égard. Je vais lui répondre demain.
Cet après-midi visite de Françoise, Hervé et les deux frères de Claude. Hervé me raconte ses excusrsions autour de l`ile faites en compagnie de Paddy (Alfred) fils de mon neveu Henri Koenig. Ils parcourent les cotes de l`ile par fragments hebdomadaires et samedi et dimanche derniers ils ont parcouru là région de Savinia jusqu’à Mahebourg, puis de Mahebourg au Poste Lafayette. Ils font le trajet tantôt à pied, tantot à bicyclette.
Mardi 19 Juin 1945
J’ai répondu aujourd’hui à la lettre d’Emile, elle partira sans doute par la voie des airs dimanche prochain. Je lui dis de m’envoyer du riz, des lentilles, des pois délicieux de Madagascar et espère qu’il n’aura pas de difficulté à s’exécuter
Mon bureau par son exposition au soleil couchant attire les habitants de la maison qui fuient l’autre aile sombre et froide pour venir y coudre, broder etc. ce qui me gêne un peu dans mes occupations. Francoise y est venue rejoindre Claire et Bernard et il viennent de s’en aller trois jours pour chez Alice, ce qui me permet de m’asseoir à ma table pour écrire mon Journal. Geneviève et Sybil sonnent vers six heures, la première vient me demander d’écrire sur une gravure le mot “Bouquet Spirituel“ pour l’offrir à une des Laurette de Moka dont c’est la fête.
Mercredi 20 juin 1945
Je vais à Port-Louis pour la cinquième séance d’audit des comptes du Syndicat des Sucres. Au retour dans l’après-midi je voyage en compagnie d’Alice et Francoise qui étaient allées chez le dentiste. Allain le fils de Lili lui a donné des inquiétudes dans la nuit, elle a cru qu’il avait la diphtérie, mais Duvivier venu ce matin lui a dit que c’était le faux croup, ce qu’avait eu Bernard il y a quelques temps. Quel soulagement pour tout le monde!
Jeudi 21 juin 1945
Claire, Bernard et moi allons en auto à Rose Hill dans la journée. Les premiers à la clinique du bon Pasteur pour une piqûre d`émétine a Bernard et moi pour mon heure de garde bimensuelle au Montmartre Mauricien. Claire et Bernard sont venus ensemble à l’Eglise après la séance à la clinique. Bernard a bu son biberon devant le Saint-Sacrement puis a parcouru toutes les nefs allant de Claire à moi puis à sa bonne.
Nous avons ensuite passeé au parloir voir Mina qui a été enchantée de voir son petit neveu. Mina m’a remis les mesures de ses lunettes que je dois prendre.
En retournant à Quatre Bornes nous avons rencontré Jean et Germaine qui allaient prendre le train pour je ne sais où. Dans l’après-midi visite de Lili, Pierre, Pierrick, Alice, Françoise et Patrice. Claire et Françoise ont été à St-Jean se confesser. Francoise a reçu un câble de son fiancé Robert Noël pendant sa visite à la maison, il lui souhaitait bonne fête pour le 22 juin.
Vendredi 22 juin 1945.
Francoise a aujourd’hui 24 ans. Elle a invité Claire à déjeuner.
J’ai reçu hier soir un billet de Gabriel Harel me disant que les réunions du Tiers Ordre recommencaient après une interruption de deux mois causée par l’épidémie de paralysie infantile, et comme les réunions se font à la Chapelle du Couvent de Bon Secours à Belle Rose qui hospitalise les enfants abandonnés, il avait été jugé prudent de ne pas les exposer à la contagion du dehors, et les réunions avaient cessé momentanément. La reprise a lieu samedi 20 demain.
Madith et Simone Noël sont venues prendre le thé chez Alice pour la fête de Francoise. Madith se marie le 2 juillet prochain. C`est l`Archeveque Evêque Monseigneur Leen qui bénira son mariage à Curepipe. Rachel qui est en séjour à Tamarin est venu aussi à la fête et est repartie dans la soirée pour son bord de mer. Bridge sous la varangue à 5h entre Claude et ses frères. Jean mon fils passe prendre la lettre d’Emile pour la lire et part avec Marc Koenig pour dîner chez ce dernier avec Germaine.
Samedi 23 juin 1945.
Réveil à 5h du matin pour la confession au Rosaire, et puis assister à la messe de 6h30 qui se dit pour Gabrielle. C’est aussi le jour de réunion du Tiers Ordre au Couvent de Belle Rose, mais mal disposé je ne m`y suis pas rendu, d’autant plus que j’aurais couru le risque de ne pas trouver une auto à la Gare, ce qui m`aurait contrarié. Je suis très assidu aux Réunions mensuelles et regrette le contretemps d’aujourd’hui, d’autant plus que notre fraternité de Saint-Jean c’est restreinte par le fait que les Tertiaires qui habitent Rose Hill qui en faisaient partie se sont joints à la Fraternité de ce quartier, ce qui diminue notre bloc de Saint-Jean de plus de la moitié et lui fait perdre de son importance.
A Maurice on mange du bœuf le Dimanche seulement alors que nous en mangions tous les jours autrefois. Mais ce matin par un caprice des autorités nous en sommes privés ce qui met Claire dans tous ses états pour savoir que servir demain à table.
Elle imagine d`y mettre du riz du pays (ce qui est une rareté), accompagné d’un carry de volaille. Eh bien ce n’est pas si mauvais de changer un peu et c’est même avantageux car la volaille est encore plus introuvable que le bœuf.
Quand donc finiront nos tourments comme dit la chanson des deux canards.
Il est quatre heures, Bernard vient de partir avec Claire en auto pour sa deuxième piqûre d`émétine. Pauvre chou, il ne se doutait pas de ce qu’il attend et s’était fait bichonner et parfumé de mon eau de Cologne avec beaucoup de grâce, croyant à une promenade.
Nous avons un hiver capricieux, hier il faisait beau et chaud et ce matin il bruinait et puis la brise s`est élevée, mais sans diminution sensible de la température.
J’ai regretté que mon à disposition de ce matin m`ait privé de course à St-Jean, j’aurais ainsi fait mon pèlerinage mensuel à la tombe de Gabrielle et à celle des enfants. Là je retrouve plus sensiblement mes souvenirs des derniers jours de ma chère épouse et lui parle plus intimement.
Dimanche 24 Juin 1945.
Nouveau réveil à 5h du matin pour ma communion hebdomadaire à 6h30 au Rosaire, la Messe de 7h30, cafés chez Lili puis chez Agnès.
Le temps est maussade, il pleuvaille, il vente, c’est une haute pression qui se dessine et qui fait croire au profane qu` il y a du cyclone dans l’air. Mais c’est tout le contraire.
On a encore chassé hier aux Salines Koenig, et lorsque je suis allé chez Pierre ce matin j’ai cogné contre une énorme cuisse de cerf qui s’étalait sous la varangue de derrière. Lili m’a envoyé quelques tranches qui sont venues avantageusement remplacer le bœuf qu’on na pas débiteé cette semaine.
Pierre raconte une réception donnée à Yémen des autorités locales, Gouverneur en tête, et des aviateurs Français qui font les voyages postaux réguliers du moment, par René Maingard propriétaire de Yémen. Au cours du déjeuner, parmi les diverses conversations qui se sont déroulées, Monseigneur Moody, Gouverneur intérimaire, a parlé des événements actuels en Syrie et au Liban et à blâmé la France de sa conduite envers ces deux pays, en les attaquant au lieu de vider les lieux comme elle avait promis de le faire pour mettre un terme à son mandat. Les aviateurs Français ont pincé les lèvres pour ne pas entrer en discussion avec le chef du pays, mais ce dernier s’adressant aux aviateurs leur demanda leur opinion. Alors ceux ci ont vidé sur la tête du Moody le sac débordant d’indignation de la conduite des Anglais dans cette affaire, soulignant que c’était eux qui poussaient les Syriens à mener campagne contre la France pour qu’elle vide les lieux, qui seraient alors occupés par eux. Que la France loyale agissait loyalement envers la Syrie et que s`il y a eu des troubles, des escarmouches suivis de combats sanglants c`est que les Syriens avaient attaqué les premiers. Ils ont paraît-il rivé le clou au Gouverneur qui est resté coi.
Oh ! Les salauds d`anglais ! Et dire que le Gouvernement actuel français trouve encore un moyen de les cajoler et de les inviter aux fetes du 14 juillet à Paris ! Faut-il que la pauvre France soit bien dégénérée pour ne pas discerner la fausse moitié que semble lui montrer l’Angleterre et lire dans son jeu et deviner ses projets. L’Angleterre vous serre la main, vous caresse l`épaule de la main gauche mais vous fouille les poches de l’autre. Elle rejettera toujours la France de son chemin, et on parle d’alliance, elle vous déboulonnera de partout grâce à sa Marine et à votre faiblesse actuelle, et vous parlez d’amour… Pauvre France nouvelle !
Lundi 25 juin 1945.
C’était bien la haute pression atmosphérique que je pressentais hier. Le baromètre à 9h marque 764 millimetres et il y a un fort courant de l`Est. Cependant il ne fait pas froid !
Il y a eu aujourd’hui une éclipse partielle de lune que nous avons parfaitement observé sous la varangue dans mon télescope. Les observateurs étaient Jacques, Léon, Claude, Christian et Eddy et Georges. L’éclipse a commencé à 6h45 pm et c’est terminé à 7h30. Il était resté une petite calotte lumineuse à gauche de la lune a son maximum de l’éclipse.
Ce matin comme tous les 24 du mois la Messe a été dite à St-Jean pour Gabrielle. Lorsque j’ai envoyé les honoraires du curé (P. Madon) il était parti pour la ville de sorte qu’il faudra renvoyer le petit Jean demain les lui porter.
J’ai souffert de l’estomac aujourd’hui malgré la mixture du Docteur Duvivier que je prends depuis plusieurs jours. Je vais cesser la cigarette pendant quelques temps.
Mardi 26 juin 1945.
Visite d`Hervé dans la journée. Il a des amibes comme Bernard et s’est fait piquer d`émétine aujourd’hui. On doit lui faire trois piqûres, puis il suivra un traitement d`Epica.